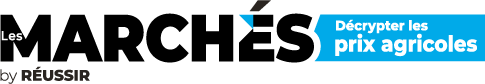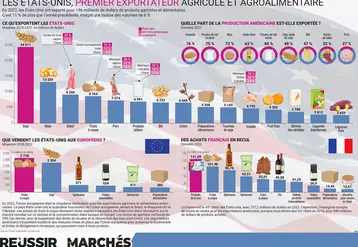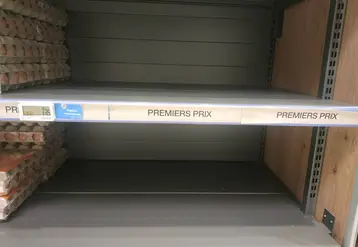Chronique
Cotisations interprofessionnelles : précisions de la Cour de cassation
La Cour de Cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020, vient de préciser, en cas de contestation du paiement d’une cotisation interprofessionnelle par un opérateur, quelle justification l’interprofession devait apporter.


La Cour de cassation a déjà eu à connaître de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme aux rapports entre les organisations interprofessionnelles agricoles – les interprofessions – et les opérateurs économiques assujettis aux cotisations interprofessionnelles étendues. Elle a, en règle générale, rendu des décisions favorables aux interprofessions.
La Cour, en dernier lieu, avait validé les cotisations au regard de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention, qui garantit la protection de la propriété. Après avoir jugé que cet article oblige à établir l’existence d’une justification d’intérêt général aux fins de l’extension par l’État d’un accord interprofessionnel prévoyant le paiement de cotisations, elle avait validé plusieurs arrêts de cours d’appel ayant jugé l’extension des cotisations en cause justifiée par un motif d’intérêt général.
Pour la haute juridiction, « réunir les acteurs de la filière afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques » autorise à qualifier d’intérêt général l’action d’une interprofession – et, surtout, l’intervention de l’État aux fins d’étendre ses accords de financement.
La Cour de cassation avait signalé à l’occasion de certains arrêts l’exigence, issue de la jurisprudence européenne, de proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et les mobiles d’intérêt général qui doivent la justifier. Elle n’avait pas tiré de conséquence particulière de cette exigence.
Équilibre entre moyens employés et but visé
C’est chose faite depuis un arrêt du 23 septembre 2020, mais, cette fois, moins dans le sens des interprofessions que des assujettis aux cotisations.
Dans cette affaire, un opérateur demandait le remboursement de cotisations versées, en mettant en doute les contreparties obtenues.
La Cour rappelle d’abord qu’une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et l’impératif de sauvegarde des droits fondamentaux, même lorsque se trouve en cause le droit de l’État d’adopter les actes qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement de cotisations. Il doit donc exister un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé.
La Cour, cependant, précise qu’il n’appartient pas à l’assujetti, victime prétendue d’une atteinte au droit de propriété, de démontrer l’absence de ce rapport, mais à l’interprofession de démontrer l’existence d’un tel rapport.
C’est donc, en cas de contestation des cotisations, sur l’interprofession (appréhendée cavalièrement comme un prolongement de l’État) que pèse la charge de démontrer l’existence « d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l’interprofession ».
Cet arrêt ouvre-t-il la voie à des contestations en cascade des cotisations interprofessionnelles, car confortables en termes de régime de preuve ? Il est permis d’en douter, ou du moins de douter de l’issue favorable de telles contestations.
Un « rapport raisonnable de proportionnalité » à prouver
Ce n’est, en effet, pas la preuve, par l’interprofession, d’un étroit et rigoureux rapport de proportionnalité qui est requise, mais seulement celle d’un « rapport raisonnable de proportionnalité ».
En d’autres termes, c’est seulement lorsque pourra être constatée une disproportion déraisonnable du montant des cotisations avec les buts poursuivis par l’interprofession que les cotisations seront remises en cause.
C’est heureux : les interprofessions n’ont pas vocation à devenir de simples prestataires de services qui facturent chacun des opérateurs de leur filière au centime. C’est justement parce qu’elles agissent dans l’intérêt général de la filière – autre exigence de la Convention européenne des droits de l’homme, rappelons-le – que les opérateurs économiques ne sont pas en droit d’attendre d’elles un retour sur investissement arithmétique.
Le cabinet Racine
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents avocats et juristes dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), il réunit près de 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Samuel Crevel, associé, y traite des questions relatives à l’agriculture et aux filières agroalimentaires. Magistrat de l’ordre judiciaire en disponibilité ayant été notamment chargé des contentieux relatifs à l’agriculture à la Cour de cassation, il est directeur scientifique de La Revue de droit rural depuis 2006. Olivier-Henri Delattre est avocat au cabinet Racine