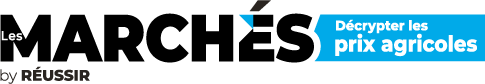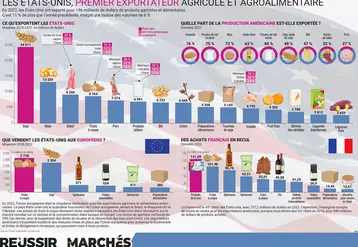Chronique
Textes d’hiver pour les coopératives
Un peu plus d’un an après la loi Egalim et six mois après l’ordonnance relative à la coopération agricole, a été publié le décret d’application de ces différentes dispositions législatives le 8 novembre 2019, puis, le 29 novembre, l’arrêté du ministre de l’Agriculture homologuant les modèles de statuts des coopératives agricoles. Décryptage.

Il importait que des modèles de statuts reflétant la nouvelle réglementation soient édictés pour permettre aux coopératives de modifier régulièrement leurs statuts en conséquence. Sans surprise, décret et modèles de statuts installent les nouvelles règles destinées, dans la philosophie des entretiens généraux de l’alimentation : à rééquilibrer les relations entre les coopératives et leurs membres, réputées déséquilibrées en défaveur des seconds ; et à donner plus de pouvoirs de contrôle aux instances tutélaires en contrepartie d’un plus grand encadrement de leur action.
Rééquilibrage
En premier lieu, le lecteur se rappelle que pour les pouvoirs publics, les coopérateurs ne seront en possibilité de faire davantage le poids face à leur coopérative que s’ils sont mieux informés qu’actuellement sur la vie et l’activité de celle-ci.
Trois innovations sont marquantes à cet égard.
Au moment de son adhésion, le coopérateur se verra désormais remettre, outre la liste des dirigeants, des informations sur les règles et principes coopératifs, la rémunération des apports et les conditions de fonctionnement de la coopérative.
Avec sa convocation à l’assemblée générale annuelle, il se verra envoyer une importante documentation décrivant en bref les éléments de rémunération des apports et les ristournes prévisibles et pourra consulter le rapport du conseil d’administration, lequel devra contenir dorénavant des explications sur les éventuelles différences entre la rémunération à venir et les prévisions de rémunération avancées lors de la précédente assemblée.
À tout moment enfin, il pourra consulter certains documents parmi lesquels un état des filiales et des sociétés contrôlées par sa coopérative.
Nouveau dispositif de retrait
Il reste à savoir si le coopérateur prendra le temps de prendre connaissance de cette masse de documents qui va s’abattre sur lui.
Il est certain que cette obligation d’informer constituera une contrainte supplémentaire pour les coopératives en même temps qu’une éventuelle nouvelle source de responsabilité de la part de coopérateurs qui, à la lumière de ces chiffres et annonces, dans un contexte général de volatilité des cours des productions agricoles, seront, à tort ou à raison, déçus ou persuadés que les dirigeants ont failli dans leur mission.
En second lieu, les nouvelles dispositions réglementaires instaurent le nouveau dispositif de retrait anticipé voulu par le législateur : obligation pour le conseil d’administration d’accepter le retrait en cas de force majeure (auparavant, ce n’était pour lui qu’une faculté), limitation de pénalité en cas de retrait motivé par un changement qualitatif de production non assuré par la coopérative…
Les coopératives devront avoir adopté les statuts intégrant toutes ces modifications avant le 1er juillet 2020.
Redimensionnement
Deux institutions coopératives ont fait l’objet d’importantes modifications.
Le Haut Conseil de la coopération agricole est désormais doté de pouvoirs « de police » renforcés : le retrait d’agrément, en cas de manquements graves, fait l’objet d’un régime et d’une procédure plus étoffés ; possibilité de saisir plus fréquemment les assemblées générales des coopératives en cas de manquement de leurs dirigeants, mise en demeure envoyée aux dirigeants sur dénonciation des réviseurs.
Enrichi par une commission consultative composée de différents membres qualifiés, le Haut Conseil devra publier chaque année un rapport plus détaillé que par le passé ainsi qu’un guide de gouvernance à l’intention des coopératives.
Le médiateur de la coopération agricole voit également ses attributions un peu étendues. D’une part, possibilité lui est ouverte de saisir le Haut Conseil des manquements qu’il est susceptible d’observer dans le cadre de sa médiation. D’autre part, il a dorénavant pour mission de proposer dans son rapport annuel les modifications textuelles qui lui paraissent nécessaires.
Ajoutons qu’à l’issue d’une médiation infructueuse, les parties pourront bénéficier d’un traitement judiciaire accéléré de leur différend.
Entre le contrôle de leurs organes de tutelle et le regard de leurs propres membres, les coopératives vont se sentir sans doute davantage sous surveillance.
LE CABINET RACINE
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents avocats et juristes dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), il réunit près de 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Samuel Crevel, associé, y traite des questions relatives à l’agriculture et aux filières agroalimentaires. Magistrat de l’ordre judiciaire en disponibilité ayant été notamment chargé des contentieux relatifs à l’agriculture à la Cour de cassation, il est directeur scientifique de La Revue de droit rural depuis 2006.
Racine - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris - www.racine.eu