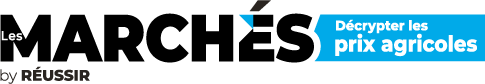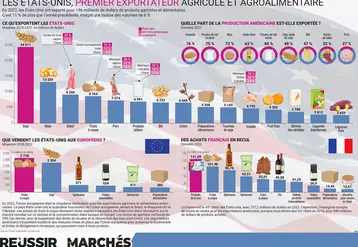CHRONIQUE
Suspicion de contrefaçon : comment informer les tiers ?
Il est de principe que toute personne qui fait un usage indu des droits de propriété intellectuelle d’un tiers expose sa responsabilité pour contrefaçon. Par un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation vient de réaffirmer son attachement à ce que les termes de la lettre de mise en connaissance de cause soient objectifs et mesurés, dans la stricte finalité d’une information loyale.

Peuvent être qualifiés de contrefacteurs non seulement le copieur lui-même, mais également, le cas échéant, toute personne qui profite de ladite contrefaçon, comme un revendeur, par exemple. Il s’agit donc souvent, dès le début d’une situation de ce type, pour le titulaire du droit, de définir le périmètre de son action.
Si, à l’égard du contrefacteur principal, l’action en justice et très souvent engagée, il n’en va pas toujours de même vis-à-vis des tiers, comme, par exemple, les distributeurs du contrefacteur. En effet, la pratique a largement repris à son profit la technique dite de mise en connaissance de cause des tiers contrefacteurs, héritée du droit des brevets, qui est le seul droit de propriété intellectuelle à offrir une telle faculté. L’article L615 - 1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que : « L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contre faisant, n’engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Des plateformes promptes au déréférencement
Autrement dit, en droit des brevets, la mise en cause du revendeur n’est possible que si celui-ci est informé de ce que les produits qu’il commercialise sont litigieux. Le fabricant du produit breveté va donc informer le tiers revendeur de la situation, à une période où, par définition, la question de la contrefaçon n’est pas jugée et n’a donc rien de définitif. Bien souvent, de telles lettres sont envoyées à des acteurs majeurs de la distribution, pas nécessairement alimentaire, et sont réceptionnées par leurs plateformes.
À ce stade, la préoccupation de ces plateformes n’est pas tant de savoir si la contrefaçon sera, ou non, retenue par le juge, car cela peut demander beaucoup de temps, et le temps judiciaire n’est pas le temps des affaires, que de comprendre que la commercialisation des produits en cause présente un risque pour elles qu’elles préfèrent ne pas courir, on les comprend.
Dès lors, sans autre forme de procès, elles retirent les produits de la vente, bien souvent à titre conservatoire, sans avoir recueilli les observations de leur fournisseur. La lettre produit donc l’effet voulu par son rédacteur, à savoir que la concurrence qui, à ce stade, l’affaire n’étant pas jugée, n’est que présumée déloyale, disparaît immédiatement.
Vigilance quant à une concurrence déloyale
La jurisprudence surveille donc d’un œil discret, mais attentif, le contenu de ces lettres de mise en connaissance de cause envoyées sur le fondement de l’article L615 – 3 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, par un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation vient de réaffirmer son attachement à ce que les termes de la lettre de mise en connaissance de cause soient objectifs et mesurés, dans la stricte finalité d’une information loyale.
Elle a confirmé la sanction infligée au rédacteur d’une de ces lettres qui n’avait pas craint de présenter les produits argués de contrefaçon comme étant le résultat d’informations volées par d’anciens salariés avec lesquels elle était en procès, en faisant état d’infractions pénales ayant permis le résultat contrefaisant, alors que ces procès étaient en cours si bien que la présomption d’innocence profitait aux mis en cause.
La Cour de cassation, comme la cour d’appel, a vu dans cette rédaction une volonté de porter le discrédit sur les produits de la concurrence, qui s’analyse en un dénigrement fautif. Cette solution n’a rien de novatrice car déjà, au mois de mai 2015, la Cour de cassation avait retenu cette qualification de dénigrement.
Cette vigilance doit être saluée, car, comme nous l’évoquions, la pratique de ce type de lettre s’est généralisée bien au-delà du droit des brevets, et même, dans certains cas, dans des affaires ou seule la concurrence déloyale est invoquée à l’exclusion de tout droit privatif. De tels abus organisent incontestablement des cloisonnements de marchés qui doivent être sanctionnés.
Maître Didier Le Goff
Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années, dont près de vingt ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire. Il a fondé, en 2018, avec quatre confrères de spécialités et barreaux différents, une plateforme dédiée aux segments de marché de l’agroalimentaire, parfums, fleurs et leurs produits dérivés : www.leschampsdudroit.fr.