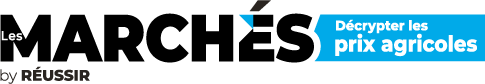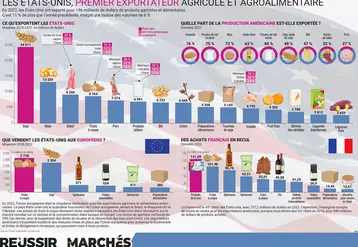Sécurité Alimentaire - Les autorités veulent consolider les plateformes d’épidémiosurveillance
Au-delà des dispositifs déjà mis en place pour observer les risques émergents dans la chaîne alimentaire, les autorités décident de construire de nouveaux systèmes de vigilance.

ont signé un accord au dernier Salon de l’agriculture pour la
création de plateformes d’épidémiosurveillance. Objectif : mieux
anticiper les risques en matière de sécurité alimentaire.
Depuis mars dernier, un accord-cadre, signé à l’occasion du Salon de l’Agriculture à Paris, engage trois signataires — le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’Inra et l’Anses — à poser les fondations de plateformes d’épidémiosurveillance dont la vocation est de mieux anticiper les risques concernant la sécurité sanitaire des aliments. À partir des résultats des autocontrôles réalisés par les producteurs, qui seront remontés dans des banques partagées de données, les signataires veulent en effet construire un dispositif qui permettra de réaliser une analyse, non pas dans une démarche rétrospective, mais dans une logique de surveillance des risques émergents. Le constat est en effet que les crises sanitaires proviennent presque toujours de risques qui n’avaient pas été identifiés antérieurement. « En croisant les informations tirées de ces plateformes avec les cas de maladies chez l’homme, on devrait parvenir à améliorer la sécurité globale de la chaîne alimentaire », estime Gilles Salvat, directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses. Le premier comité de pilotage a eu lieu en février, pour un projet qui comprend la surveillance des risques microbiologiques classiques comme Salmonella, Campylobacter, Listeria ou Escherichia coli mais aussi celle des risques associés aux matières toxiques présentes dans l’environnement comme les biocides ou les pesticides. Les signataires visent un objectif pratique et concret. « Grâce à la remontée des informations, on pourra connaître le niveau de contamination de l’ensemble d’une filière, et les producteurs pourront se comparer à ce niveau moyen », résume Gilles Salvat. D’après les signataires, ce sera une avancée car, aujourd’hui, lorsqu’un producteur obtient 10 % de résultats positifs sur les tests de recherche de salmonelles par exemple, rien ne lui permet de savoir ce que cela représente par rapport au reste de la filière.
LES RÉSULTATS NÉGATIFS, AUSSI, SERONT REMONTÉS
Pour aboutir, le projet nécessite que soient collectés non seulement les résultats positifs mais aussi les contrôles négatifs. C’est de fait la condition pour pouvoir établir des données de prévalence, comme l’explique le directeur de la santé et du bien-être animal de l’Anses : « aujourd’hui, il existe déjà des systèmes de surveillance des Salmonella puisque toutes les souches isolées dans le cadre des autocontrôles réalisés par les producteurs remontent dans notre laboratoire de Maisons-Alfort. Mais cela donne seulement une indication sur la typologie des produits dans lesquels ces souches ont été isolées. Il manque tout le champ des résultats négatifs. Or, on comprend bien que les mesures à prendre ne sont pas les mêmes si la prévalence d’une bactérie pathogène est de 0,1 % ou de 10 % ».
Les producteurs de poulets labellisés sont de ce point de vue précurseurs puisque, depuis vingt-cinq ans, ils remontent volontairement à l’Anses l’ensemble des résultats de leurs autocontrôles pour tous les critères obligatoires dans le cadre de la labellisation. À Ploufragan (LNR Salmonelles), l’Anses possède donc un historique complet pour cette catégorie d’aliments. « C’est ce type de dispositifs que nous souhaitons mettre en place pour la chaîne alimentaire dans son ensemble. Cela représente évidemment un travail colossal », ne cache pas Gilles Salvat. Les signataires ont pris la décision d’avancer par étapes : ils bâtiront des plateformes domaine par domaine. « Par exemple, nous avons actuellement un atelier dédié à la surveillance de Salmonella Dublin dans la filière bovine laitière, où l’objectif est de mieux anticiper les risques de contaminations des fromages au lait cru, notamment ceux produits en Franche-Comté et en Auvergne », indique-t-il. Les signataires ont ainsi commencé le travail qui doit leur permettre de démontrer la faisabilité de leur projet.
EXPLIQUER LES MESURES PRISES
L’accord-cadre du 2 mars a été signé alors que le début de l’année a été marqué par de nouvelles crises sanitaires. « Soit pour des raisons de fraudes, soit à cause de défauts de surveillance, on connaît encore des alertes malgré la qualité du système français de vigilance. Le rôle de l’Anses dans ce contexte est plus que jamais d’expliquer les mesures prises pour sécuriser la chaîne alimentaire, et toujours renforcer le système », a déclaré Roger Genet, directeur général de l’Anses lors d’une conférence de presse donnée à l’ouverture du Salon de l’agriculture.