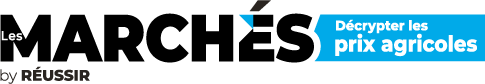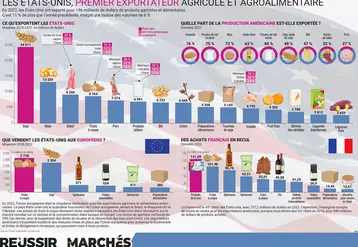Chronique
Les mécanismes de la contractualisation inversée
La loi Egalim réforme en profondeur la contractualisation instaurée en 2010. Décryptage de ses mesures phare.
La loi Egalim réforme en profondeur la contractualisation instaurée en 2010. Décryptage de ses mesures phare.

Depuis la disparition des mécanismes de gestion de marché, aucun outil juridique n’est apparu efficace pour permettre aux agriculteurs de stabiliser leurs revenus : ni le droit civil (droit commun des contrats), ni le droit commercial (qui interdit les pratiques abusives imposées à un partenaire en état de faiblesse), ni le droit de la concurrence (qui prohibe les ententes et les abus de position dominante).
Face à ce constat, le législateur avait instauré, avec la loi du 27 juillet 2010, un mécanisme de contractualisation entre les producteurs agricoles et leurs premiers acheteurs. Rappelons que cette contractualisation était obligatoire dans certains secteurs (notamment le lait de vache et les fruits et légumes frais). Ce mécanisme prévoyait que c’était l’acheteur qui devait adresser au producteur une proposition écrite de contrat. Bien qu’ayant connu des modifications, il n’a pas fait ses preuves et a été vivement critiqué en raison à la fois de sa complexité et de son inefficacité.
Le producteur à l’initiative
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », vient réformer en profondeur la contractualisation dans le but de parvenir, enfin, à un rééquilibrage des relations au profit des agriculteurs. Deux mesures phare dans cette loi : confier au producteur, et non plus à l’acheteur, l’initiative de la proposition initiale de contrat et donc de la construction du prix – notamment à partir des indicateurs des coûts de production – ce que l’on a appelé la contractualisation inversée et imposer que la suite de la chaîne – c’est-à-dire les contrats de revente – prenne en compte ces indicateurs, ce que l’on a appelé le transfert en cascade.
Le champ de la contractualisation s’étend à « tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français […] conclu sous forme écrite * ».
Les CGV comme socle unique
C’est donc désormais l’offre du vendeur qui constitue le point de départ obligé de la négociation dans le but d’inverser le mécanisme de construction des prix, mais le vendeur a aussi la possibilité de demander à l’acheteur de lui transmettre une offre de contrat écrit. Il convient de noter que cette logique est celle du droit commun des relations commerciales : l’article L.441-6 du Code de commerce prévoit en effet que « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale ».
Dans un souci d’efficacité, la loi prévoit, d’une part, que l’acheteur qui refuserait cette proposition ou ferait des réserves sur un ou plusieurs de ses éléments devra motiver sa position auprès du producteur « dans un délai raisonnable », et, d’autre part, que la proposition de contrat devra être annexée au contrat définitif (afin de pouvoir comparer les modifications que l’acheteur a pu imposer au producteur).
Parmi les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de vente, celle relative « au prix ou aux critères et modalités de détermination du prix » est évidemment essentielle. Les critères et modalités de détermination du prix devront désormais « prendre en compte » des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole et aux prix des produits concernés sur le marché qui devront être élaborés et diffusés par les interprofessions. Et, comme indiqué ci-dessus, ces indicateurs devront être pris en compte dans le contrat de revente. De plus, le premier acheteur devra communiquer au producteur « l’évolution des indicateurs relatifs au prix des produits » concernés.
Ces nouveaux mécanismes apparaissent bien sûr positifs. Encore faudra-t-il que les acteurs s’emparent réellement de la contractualisation, ce qu’ils n’avaient pas fait à l’occasion de la loi de 2010. Enfin, comme les difficultés d’application seront certainement nombreuses, le législateur a prévu le renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles à ce titre.
* La loi ne s’applique pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions effectuées sur des marchés de gros, aux relations entre les coopératives et leurs associés ainsi qu’entre les OP et leurs membres.
Le cabinet Racine
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires, qui regroupe plus de 200 professionnels du droit dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), dont 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Valérie Ledoux, associée et co-managing partner du cabinet, y traite des questions relatives à la concurrence, la distribution, aux contrats et à la propriété intellectuelle et industrielle, auprès de grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la distribution, du luxe, du e-commerce et des médias. Avocate au barreau de Paris et de Bruxelles, elle est membre de l’Association française d’étude de la concurrence et membre de l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence.
Racine - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris - www.racine.eu