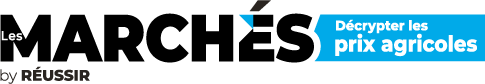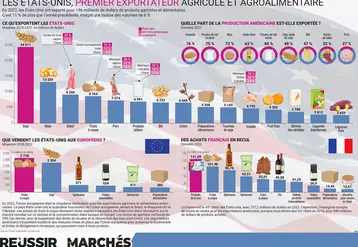La microflore du fromage à la loupe
Une journée d’étude organisée par le Cniel a permis de présenter les récents travaux de recherche sur les écosystèmes fromagers.

«Le voyage au coeur des écosystèmes fromagers constitue un vrai challenge pour la filière », a introduit Joëlle Reitz-Ausseur (Soredab-Savencia) dans son mot de bienvenue à la journée du 3 novembre organisée par le Cniel à la Maison du lait. « Malgré de nombreux travaux de recherche menés depuis de nombreuses années, il reste encore beaucoup à découvrir. » Les experts de l’Inra ont présenté les récents progrès scientifiques, avec notamment l’avènement des nouvelles technologies de séquençage à haut débit qui ont conduit à la mise au point de nouvelles méthodes dites méta-omiques. Ces techniques permettent désormais d’appréhender l’étude des écosystèmes microbiens avec une profondeur d’analyse incomparable.
La métagénomique
Parmi ces méthodes, la métagénomique est utilisée pour déterminer la liste et la répartition des espèces dominantes et sous-dominantes présentes dans un fromage sans le risque de passer à côté de certaines communautés non cultivables, non détectées par la microbiologie classique. Ceci est possible grâce à l’exploration du contenu génétique d’un échantillon de fromage. Les récentes avancées dans ce domaine ont permis par exemple de montrer que 60 % des bactéries et 25 % des levures et moisissures retrouvées sur 137 croûtes de fromages n’étaient pas ensemencées au départ. Cette approche permet également de mettre en évidence les potentialités technologiques des microorganismes présents. Le projet « Food Microbiomes », porté par Pierre Renault, de l’Inra de Jouy-en-Josas, a testé la validité de la métagénomique dans l’exploration des écosystèmes fromagers. Un autre projet commun Inra-Cniel, « Food Microbiomes Transfert », vise à rendre cet outil disponible auprès des industriels.
La métatranscriptomique
La métatranscriptomique est utilisée pour obtenir des images instantanées de l’expression de l’ensemble des gènes portés par les différents microorganismes qui composent l’écosystème fromager. Une approche intégrative combinant les analyses méta-omiques et de microbiologie classique a été développée dans le cadre du projet « Execo » porté par Pascal Bonnarme, de l’Inra de Grignon, et son équipe. Les grandes fonctions métaboliques intervenant au cours des différentes étapes de l’affinage d’un fromage modèle ont été identifiées. Des marqueurs d’intérêt technologique ou permettant de mieux caractériser l’état physiologique des microorganismes dans les fromages ont été développés. Ces outils pourront par exemple être utilisés industriellement pour la sélection des souches ayant un intérêt technologique ciblé. L’approche métatranscriptomique pourrait également être utilisée comme outil de diagnostic en réponse à une question spécifique (ex: défaut d’affinage). Une présentation de Philippe Bessières, de l’unité Mathématique et informatique appliquées de l’Inra, a rappelé le rôle essentiel joué par la bio-informatique, les mathématiques et les outils statistiques pour l’exploitation et l’interprétation des données générées par ces nouvelles technologies. Le métier de microbiologiste est en pleine phase de mutation.
De nouveaux outils
Le projet Dephy, porté par Marielle Bouix, de l’Inra de Jouy-en-Josas, a également été présenté. Il s’intéresse à l’identification des étapes critiques du procédé de préservation et de production des souches d’intérêt technologiques. Bien que les travaux aient porté sur une seule souche de Lactococcus lactis issue de la collection Savoïcime (Annecy, France), les protocoles développés seront validés sur d’autres souches. L’identification des leviers clés pourra servir à améliorer la résistance à la conservation d’autres espèces bactériennes d’intérêt. Ces nouveaux outils, permettant une sélection à « haut débit » des souches, seront la clé pour les ferments de demain et le développement de nouveaux produits. Ils seront aussi d’une aide précieuse pour étayer les questions et les freins d’ordre réglementaire.