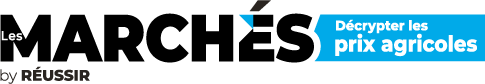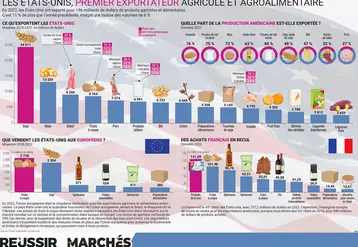Interview de Jocelyn Raude, sociologue à l'EHESP « Nous sommes tous des nutritionnistes profanes »
Alors que les cas de toxi-infections sont de plus en plus rares, nous enregistrons un niveau de peurs alimentaires inégalé.
Le sociologue Jocelyn Raude apporte quelques éléments de lecture.

Comment naissent les peurs alimentaires ?
Jocelyn Raude - Les crises alimentaires ont toujours existé. Elles sont observées et documentées dès l’antiquité et jusqu’au siècle dernier. Il nous faut cependant prendre en compte un facteur psychologique important : on a surtout peur de ce que l’on ne connaît pas. Si, jusqu’aux années quarante, la majorité de la population active était constituée d’agriculteurs qui produisaient leur alimentation, l’urbanisation et l’industrialisation ont radicalement changé notre rapport à l’alimentation. Nous avons vu à cette occasion se multiplier les rumeurs de fraudes ou d’empoisonnement... Aujourd’hui, alors que les cas de toxi-infections sont de plus en plus rares, nous enregistrons un niveau de peurs alimentaires inégalé. Le Syndrome de la tache sur la robe blanche apporte une bonne explication. Au fur et à mesure qu’on sécurise une activité ou un produit, le risque résiduel devient de plus en plus visible, et il est de moins en moins accepté. C’est le paradoxe de la modernité alimentaire.
Sommes-nous tous des nutritionnistes en herbe ?
J. R. - Nous sommes tous des nutritionnistes profanes dans la mesure où nous acquérons au cours de notre vie un ensemble de croyances alimentaires et de croyances nutritionnelles. Ces croyances se développent à partir de deux sources d’information : notre réseau personnel et l’espace public médiatique. Les théories nutritionnelles que nous construisons peuvent cependant être déconnectées des réalités scientifiques car elles résultent d’une forme de bricolage. Depuis une dizaine d’années, nous assistons à l’émergence de nouvelles phobies alimentaires qui touchent notamment le lait et les produits laitiers. Il ne faudrait toutefois pas réduire ce phénomène à l’existence de pro- et d’anti-lait. Il existe plutôt une gradation, un continuum, dans les attitudes ou la méfiance face aux aliments. Ces attitudes se rapprochent de celles observées vis-à-vis de la vaccination. Sur les questions nutritionnelles, les profanes font appel à des simplifications, des méthodes de pensée rapide pour catégoriser les produits en sains et malsains. Elles reposent notamment sur deux critères : d’une part, la nature végétale ou animale des produits, d’autre part, le degré de transformation des produits. Les produits végétaux peu transformés sont presque toujours considérés comme plus sains que les produits animaux industrialisés.
Comment peut-on décrypter ces comportements et apporter des réponses adéquates ?
J. R. - Il y a une hypothèse de travail intéressante. Ce comportement est à mettre en regard de phénomène de construction identitaire qui, dans ce cas, se fait par opposition aux normes médicales et nutritionnelles dominantes, et à l’alimentation produite par l’industrie agroalimentaire. Nous remarquons depuis plusieurs décennies un recul significatif de la confiance dans les institutions, et les institutions médicales en font partie. Les nutritionnistes qui participent à ce discours normatif font eux aussi l’objet de critiques de la part de ces populations. L’idée qui se répand dans ces groupes est qu’on ne peut pas faire confiance à l’élite médicale, notamment les nutritionnistes, car ils sont corrompus par les groupes pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans un contexte où la confiance est rompue, les croyances alternatives et les discours dénigrants s’installent plus facilement. Il nous faut comprendre l’émergence de ces phobies qui se construisent en opposition à un ordre établi. Une thèse a démarré sur cette thématique sous l’égide de l’EHESP et du Cniel. Elle devrait nous aider à mieux appréhender cette problématique qui affecte de plus en plus de consommateurs, et qui les détournent de produits qui peuvent s’avérer être essentiels pour la santé.
IDENTITÉ
Jocelyn Raude est sociologue, enseignant chercheur à l’École des hautes études de santé publique (EHESP). Ses thèmes de recherche touchent à l’épidémiologie et la nutrition profane, les stratégies de prévention et de promotion de la santé, les représentations, croyances et comportements alimentaires, les épidémies et maladies infectieuses émergentes et les déterminants psychosociologiques de la santé. Il connaît bien le monde des filières animales pour avoir longtemps travaillé sur la viande. Il a d’ailleurs été lauréat en 2008 du prix « Animaux, aliments et société » de l’Académie vétérinaire de France.