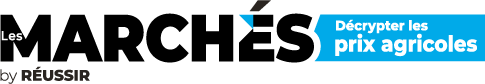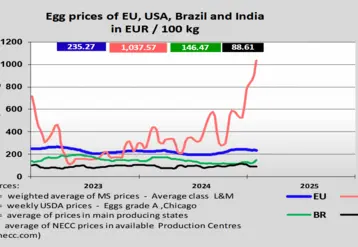Un cadre européen encore inefficace face aux fraudes alimentaires
Depuis plusieurs années déjà, la contrefaçon a cessé de se concentrer sur les produits de luxe pour s’étendre au secteur alimentaire, assurant ainsi aux organisations criminelles un bénéfice comparable1, voire supérieur, pour un processus de falsification bien plus aisé et pratiquement intraçable.
Rédaction Réussir
Les 13 000 bouteilles d’huile d’olive, 12 000 bouteilles de vin, 30 000 barres de chocolat, 30 000 tonnes de sauce tomate et 77 000 tonnes de fromage saisies au cours de l’opération de contrôle « Opson »2, qui s’est déroulée du 28 novembre au 4 décembre 2011 aux frontières de dix États européens 3, à l’initiative d’Europol 4, témoignent de l’ampleur d’un phénomène encore inconnu il y a quelques années seulement.
Alors que les préjudices qui découlent habituellement de la contrefaçon sont essentiellement matériels (manque à gagner pour l’entreprise propriétaire de la marque, atteinte à son image et à ses droits de propriété intellectuelle), ils revêtent, avec la contrefaçon alimentaire, une dimension nouvelle, bien plus grave : celle de l’atteinte à la sécurité sanitaire.
Car ces « faux » produits de consommation courante entrent dans la chaîne alimentaire sans être contrôlés, de sorte que les consommateurs achètent, en toute bonne foi, des aliments non conformes aux normes européennes en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité, mettant ainsi leur santé, voire leur vie, en danger.
Le cadre juridique européen actuel ne permet pas de lutter efficacement contre ce fléau. Les seules règles harmonisées au niveau européen, que l’on pourrait envisager d’appliquer à la fraude alimentaire, ont trait à la propriété intellectuelle, aux pratiques du commerce et à la sécurité des produits, sans aucune harmonisation en termes de sanctions. Si le bilan de leur efficacité est déjà mitigé en ce qui concerne la contrefaçon « classique », elles sont, en toute hypothèse, inadaptées aux spécificités de la contrefaçon alimentaire, bien plus diffuse et intraçable. Les sanctions prévues par les États membres sont aussi loin d’être dissuasives pour l’agromafia, qui a ainsi vu dans la fraude alimentaire une alternative intéressante aux secteurs « traditionnels » d’activité du crime organisé, tels que le trafic de drogue.
Un projet de loi d’ici l’été
Dans ces conditions, le commissaire européen chargé des douanes et de la lutte antifraude, Algirdas Šemeta, s’est engagé à présenter un projet de loi d’ici l’été, afin d’harmoniser en Europe la législation criminelle relative aux fraudes alimentaires. Raffaele Guariniello, procureur spécialisé en matière d’infractions alimentaires auprès du parquet de Turin, préconise également la création d’un parquet européen, car l’Europe serait, selon lui, un « paradis pénal » pour les criminels qui ne sont limités, à l’inverse de ceux qui les poursuivent, par aucune frontière.
Les infractions étant clairement identifiées (tromperie, falsification, contrefaçon, mise sur le marché de produits d’origine animale ou végétale dont l’importation est prohibée, etc.), on pourrait imaginer, dans l’attente de ces projets et compte tenu du caractère alarmant de la situation, appliquer plus systématiquement les règles nationales ou européennes déjà en vigueur, mais plus générales. Cependant, dans le cadre de la contrefaçon alimentaire, les moyens techniques et financiers habituellement mis à la disposition des contrôleurs de produits alimentaires sont nettement insuffisants.
L’on peut craindre que l’agromafia n’ait encore de belles années devant elle, car comme l’indiquait le procureur italien, « le crime alimentaire voyage à la vitesse de la lumière, alors que la justice voyage encore en diligence ».
1. La marge bénéficiaire sur chaque produit est certes réduite, mais les volumes visés sont devenus immenses. La contrefaçon des produits de grande consommation génère un chiffre d’affaires supérieur à celui de la drogue, estimé à plus de 350 milliards de dollars.
2. Opson signifie « aliment » en grec.
3. Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni et Turquie.
4. Cette opération visait tous les niveaux de la chaîne : production, transformation, distribution.