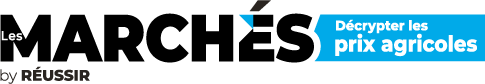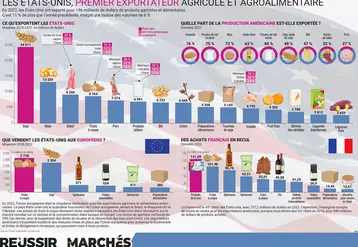Rompre une relation commerciale : un art difficile
Imaginée en 1996 pour appréhender les déréférencements abusifs de la grande distribution, la réglementation relative à la rupture des relations commerciales établies s’est rapidement trouvée appliquée par les tribunaux à des relations d’affaires qui n’avaient rien de commerciales, comme le contrat ayant uni un architecte à son client.
Le texte d’origine ne faisait qu’inclure dans le code de commerce une obligation générale de loyauté dans la rupture de relations commerciales avec un partenaire économique… alors même que l’article 1134 du code civil imposait déjà de faire preuve de bonne foi dans l’exécution des conventions.
Aujourd’hui, le texte issu de la loi LME (Article L.442-6-I-5° du code de commerce) implique de mettre fin à une relation commerciale établie en respectant un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation à laquelle il est mis fin.
La réglementation est d’ordre public, c’est-à-dire qu’elle peut être appliquée par le juge indépendamment de tout accord contraire, d’autant que la loi lui laisse un pouvoir d’appréciation très fort sur les deux points clés du système :
Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?
Après avoir fait preuve de largesse, on peut se demander si les tribunaux ne seraient pas en train de revenir à plus d’orthodoxie juridique : par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a refusé d’appliquer la notion à une société qui voyait sa relation reconduite d’année en année par des contrats indépendants les uns des autres sans avoir passé d’accord-cadre. La Cour de cassation constate qu’il n’avait pas été garanti à la société évincée de chiffre d’affaires d’année en année ou d’exclusivité. Dans la mesure où c’est non pas la rupture qui est fautive mais son caractère brutal, c’est-à-dire l’absence de préavis suffisant, il y a une certaine logique à vouloir contrôler le caractère plus ou moins automatique du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant le préavis par le partenaire évincé, même si la notion continue de s’appliquer au-delà des simples relations fournisseur/distributeur.
Quand le préavis est-il suffisant ?
Quant à la durée du préavis, le texte actuel implique de respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation et d’une durée minimale déterminée par les usages ou des accords interprofessionnels, à défaut desquels le ministre de l’économie peut prendre un arrêté.
Si la boucle paraît bouclée, c’est sans compter sur l’indépendance du juge qui conserve toute latitude pour fixer la durée d’un préavis qu’il pense suffisant, sans s’estimer lié par la lettre de ce texte.
Ainsi, le juge tient compte du degré de dépendance économique qu’avait suscité la relation pour le partenaire évincé, des investissements réalisés par celui-ci à la demande de l’auteur de la rupture, et des cycles de production.
Cette approche lui permet d’aller très loin dans l’indemnisation des préjudices : outre la couverture du préjudice commercial et financier, elle peut englober un préjudice moral, voire la couverture des investissements nécessités par la relation et anéantis par la rupture.
Ainsi, le juge s’est octroyé le pouvoir de fixer librement la durée du préavis et, par voie de conséquence, son quantum. Il en résulte une certaine insécurité juridique, d’autant que la sanction peut s’appliquer à une rupture totale comme partielle. Il est donc prudent d’employer la formule recommandée pour dénoncer une relation commerciale, et d’être généreux sur le préavis octroyé. Il reste que lorsque la rupture porte sur un contrat de fabrication de produits vendus sous marque de distributeur, le préavis doit être du double de celui des produits standard.
L’arrêt du 16 décembre 2008 nous éclaire à ce sujet : le fabricant de MDD aura nécessairement pris des dispositions spéciales pour traiter un tel contrat qui génère un certain volant de chiffre d’affaires.