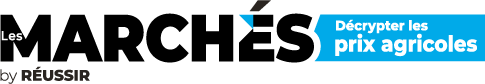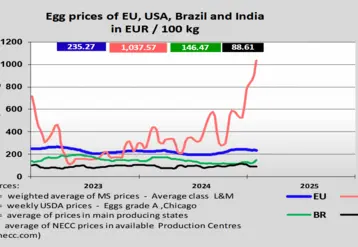Les « NBTs » devant la Cour européenne de justice

Dans 18 mois environ, la CJUE devra se prononcer sur l’application aux NBTs, de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, sur saisine du Conseil d’État français. Neuf associations et syndicats français demandent un moratoire sur les variétés de plantes obtenues par mutagenèse.
Le terme « new breeding techniques » (NBTs) se réfère aux techniques de modification du génome qui permettent l’introduction d’une séquence spécifique de changement dans le génome des plantes. Mais contrairement aux mutations génétiques obtenues par voie chimique ou radioactive, les NBTs interviennent sur les oligonucléotides et développent, ainsi, moins d’effets collatéraux. Cette technique est désormais connue et maîtrisée, et ses applications sont nombreuses.
Pour autant, les juristes et les scientifiques s’opposent quant à la réglementation qui doit lui être appliquée. D’un côté, certains scientifiques considèrent les NBTs, comme de simples alternatives aux méthodes traditionnelles, et, à ce titre, non soumises aux nombreuses barrières bureaucratiques et techniques liées au développement des organismes génétiquement modifiés (OGM). Leur principal argument réside dans le fait que les NBTs ne permettent pas – à la fin du processus – de distinguer les matériaux modifiés à travers la technique concernée (comme la « oligonucleotide-directed mutagenesis »), des matériaux qui auraient connu des mutations tout à fait naturelles. De l’autre, de nombreuses associations environnementales qualifient les organismes obtenus à travers les NBTs d’OGM, arguant du fait que la détectabilité de la technique utilisée est un prérequis pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché ; et le fait qu’un OGM ne puisse pas être détecté n’est donc pas pertinent.
Les questions du Conseil d’État français
Ce débat anime toutes les instances depuis plusieurs années et la Commission européenne, bien qu’ayant annoncé à de nombreuses reprises qu’elle allait prendre position, reste silencieuse. Étonnamment, c’est le Conseil d’État français qui pourra se targuer d’avoir fait avancer les choses, en demandant clairement à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de trancher ce débat, en répondant à plusieurs questions. Les organismes obtenus par mutagénèse constituent- ils des OGM soumis à la directive 2001/18 de l’UE ? L’exclusion des NBTs du champ d’application de la réglementation sur les OGM est-elle valide, notamment au regard du principe de précaution ? Les variétés obtenues par mutagènes constituent-elles des variétés génétiquement modifiées soumises aux règles posées par la directive 2002/53 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ? Les États membres disposent-ils d’une certaine discrétion pour définir le régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagenèse ?
Les juges de l’UE sont ainsi de nouveau appelés à combler les lacunes de la communauté scientifique et/ou carence à légiférer de la Commission européenne, en trouvant une solution aux divergences d’opinions concernant la nature, et donc, le régime applicable aux organismes obtenus par mutagenèse. L’exclusion des NBTs du champ d’application de la directive aurait pour conséquence de les soustraire aux procédures d’évaluation des risques, d’autorisations préalables, aux obligations d’information du public et surtout à l’étiquetage des OGM. La décision des juges de l’UE est donc très attendue.
Défaillance de la Commission européenne
Parallèlement le 30 septembre le médiateur européen a annoncé qu’il avait ouvert une enquête à la suite de la défaillance de la Commission européenne à répondre à une demande d’information concernant les micro-organismes développés en utilisant une autre NBTs, le CRISPR/Cas9. Il convient de rappeler que le médiateur européen enquête sur les plaintes pour mauvaise administration déposées contre des institutions ou organes de l’Union européenne. Si le médiateur formule des recommandations, l’organe ou l’institution concernée doit répondre dans un délai de trois mois. Eu égard au silence de la Commission européenne sur les NBTs jusqu’à présent, la procédure devant le médiateur pourrait donc la « forcer » à résoudre l’épineuse question de leur régime juridique.
LE CABINET KELLER & HECKMAN
Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate-associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne.