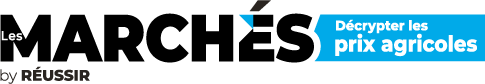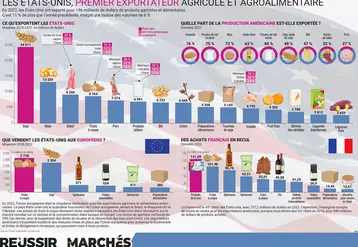Le cheval fait de la résistance

La viande chevaline est loin d’arriver en tête dans la consommation des ménages. Elle n’est toutefois pas tout à fait en perte de vitesse. Si elle subit, comme toutes les viandes de boucherie, les effets de la crise économique mondiale, elle tend à tirer son épingle du jeu.
Selon les dernières données du panel TNS-Secodip, les achats des ménages ont diminué de 1 % sur un an se terminant le 22 mars, par rapport à la même période de 2008. Le repli a été estimé à -2,9 % pour le bœuf, -2,3 % pour le veau et -16,8 % pour l’agneau. En volumes, la baisse est encore plus limitée, les volumes considérés étant bien plus faibles (de l’ordre de la centaine de tonnes seulement).
Le manque de points de distribution ne joue pas en faveur de la consommation. S’il existe des personnes réfractaires à manger cette viande, certaines en consomment régulièrement tandis que d’autres souhaiteraient en acheter mais ne s’en procurent pas facilement. Les boucheries chevalines se raréfient, et peu de points de vente dits « traditionnels » prennent le relais. Sans oublier que certains débouchés, comme la grande distribution, proposent cette viande à un prix très peu attractif pour le consommateur.
Dans ce contexte, Interbev Équin, qui souhaite que la viande chevaline se maintienne sur les étals, tente d’informer les professionnels de la viande pour les inciter à travailler ces produits. Des efforts d’autant plus importants que les a priori sur la viande de cheval restent nombreux. Selon Célia Pasquetti, responsable d’Interbev Équin, certains détaillants, qu’ils soient bouchers ou restaurateurs, imaginent notamment qu’ils n’ont pas le droit d’en proposer à leur clientèle. De telles obligations étaient valables historiquement : un édit papal datant du V e siècle a prohibé la consommation de viande chevaline, puis une fois cette interdiction levée, les bouchers conventionnels ont souhaité imposer la vente de cheval dans des lieux distincts des autres espèces. Un contexte qui n’est plus d’actualité depuis de nombreuses années maintenant !
Désormais, un détaillant est tout à fait autorisé à vendre cette viande, bien qu’il lui faille gérer certaines contraintes d’ordre psychologique imposées par une partie de sa clientèle (comme la nécessité pour les bouchers d’avoir en double certaines machines pour qu’il n’y ait pas de mélange de viandes).
Les viandes importées dominent le marché intérieur
Les freins à la consommation ne sont pas uniquement d’ordre psychologique et logistique. Un autre paramètre est à prendre en compte : l’organisation de la filière, plutôt complexe et aux objectifs multiples.
D’un point de vue professionnel, peuvent se distinguer deux groupes : les chevaux destinés aux loisirs (chevaux de selle et d’attelage) et les animaux élevés pour les produits carnés. Rien d’étonnant alors à ce que la qualité de la viande obtenue soit des plus diverses. Du côté de l’abattage, deux profils se confrontent également : les abattoirs travaillant régulièrement et en quantité cette marchandise, et les petits outils abattant ponctuellement des chevaux pour fournir des boucheries géographiquement proches. Ainsi, que ce soit sur le plan de la production ou de la commercialisation, la filière française est à deux vitesses, et manque encore un peu de lisibilité. Ce qui peut laisser certains bouchers et restaurateurs prudents quant à l’élargissement de leurs offres.
Ces incertitudes les incitent d’ailleurs à privilégier les viandes d’importation, en provenance surtout d’Argentine ou du Canada, ce qui leur permet d’avoir une sécurité et une régularité dans leurs approvisionnements, tant en quantité qu’en qualité. En 2008, selon Interbev Équin, près de 85 % des volumes consommés en France provenaient de l’étranger.
Enfin, notre production nationale reste majoritairement exportée, soit en vif (vers l’Italie, à hauteur de 66 %), soit en viande (dont 70 % à destination de la Belgique).
Un avenir entre incertitude et optimisme
L’avenir de la viande chevaline va en premier lieu dépendre de la tenue de la demande. Or, de ce côté, rien ne permet d’envisager une reprise des achats des ménages à court et moyen termes. Au contraire, l’effritement devrait rester la tendance de fond. Selon FranceAgriMer, la consommation calculée par bilan pourrait diminuer de 530 tonnes, soit un repli estimé à 2,5 %. Seuls les efforts de distribution de la filière pourront permettre de capter de nouveaux consommateurs. Interbev, conscient de cet enjeu, vient d’ailleurs de lancer une opération pilote auprès de la restauration hors foyer afin d’informer les chefs et les vendeurs et de récolter les réactions des consommateurs.
Plus en amont, les perspectives sont à un tassement de l’offre. FranceAgriMer envisage un repli de notre production de l’ordre de 420 t, mais une nouvelle hausse de nos achats, autour de 200 t. Dans le même temps, près de 310 t pourraient être expédiées. Interbev Équin estime d’ailleurs que nos ventes de vif vont une nouvelle fois se replier, la réglementation liée au bien-être accentuant les contraintes techniques et financières pour les exportateurs comme les éleveurs. Une tendance qui pourrait toutefois s’inverser si la filière française se montrait plus organisée.