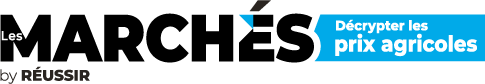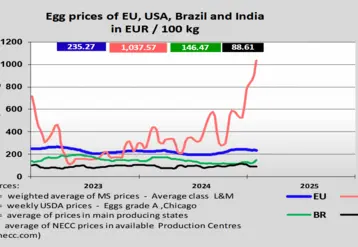Déséquilibre significatif : le ministre reprend le flambeau
Nous avons déjà beaucoup écrit dans cette revue sur la notion de déséquilibre significatif, véritable tarte à la crème aux contours juridiques non définis. Introduite dans notre droit par la loi LME de façon à obtenir par les prétoires une régulation que la loi n’a pas pu atteindre.
Pour bien comprendre les enjeux de ce dispositif, il suffit de rappeler que d’après notre Code civil, le contrat est réputé intervenu entre deux ou plusieurs parties, toutes également éclairées et conscientes. Selon l’article 1134 dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Force est de constater que dans bien des domaines, ce principe ne s’applique pas. La loi posant en principe qu’il existe une partie forte et une partie faible et qu’il y a lieu de protéger la partie faible. Le droit du travail comporte même un régime spécifique d’administration de la preuve puisque « le doute profite au salarié ».
Un fort et un faible ?
Jusqu’à présent, les relations entre commerçants ont réussi à échapper à ce mouvement protecteur, mais les offensives sont nombreuses et la notion même de déséquilibre significatif en fait partie. Très clairement, elle implique de considérer qu’il existerait dans les relations entre commerçants ou entre industriels et distributeurs, une partie forte et une partie faible. C’est ainsi qu’ont été analysées, depuis l’entrée en vigueur de la notion, de très multiples clauses contractuelles, le plus souvent au préjudice de la grande distribution. Néanmoins, un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en septembre dernier, au bénéfice du groupe E.Leclerc, a clairement montré que le juge n’était pas disposé à considérer que dans les relations industrie-commerce, il existerait une partie forte et une partie faible, et qu’il faudrait donc systématiquement protéger cette dernière.
C’est sur le terrain de la preuve que la position de stricte neutralité du juge est empreinte d’une grande fermeté alors que le ministre prétendait, dans cette affaire, que « le constat qu’aucun des 49 fournisseurs ayant signé les 118 contrats n’est parvenu à négocier une contrepartie au paiement de la CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics), qui aurait été le gage réel d’une véritable négociation, illustre on ne peut mieux la contrainte exercée par le Galec ».
Le juge demande des preuves
Mais pour le tribunal, le simple constat, que fait le ministre, de la souscription d’une obligation par une partie n’est pas la preuve qu’elle l’a faite sous la pression ou la contrainte. Autrement dit, le juge s’est refusé à considérer que le doute devait profiter au fournisseur dans sa relation contractuelle avec le distributeur. Ce faisant, il affirme que chaque partie au contrat dispose de la même autonomie de telle manière qu’elle est censée s’engager librement et sans contrainte. C’est à la partie qui allèguera l’existence d’une contrainte de la prouver. C’est donc ce fardeau qui pèse sur le ministre aujourd’hui et il est certain qu’il ne pourra pas s’agir, cette fois-ci, de se retrancher derrière de grands principes et des affirmations gratuites.
Le ministre considère que la clause contractuelle qu’il stigmatise priverait le fournisseur de la possibilité de ne pas intervenir au procès. Et le place dans la situation de devoir choisir entre : défendre ses propres intérêts, au risque de mettre en péril sa relation avec le distributeur, ou se ranger aux côtés de ce dernier, en allant à l’encontre de ses propres intérêts.
Soit le contrat a été librement négocié entre deux parties consentantes et la clause litigieuse ne saurait être réputée déséquilibrée ; soit le ministre apporte la preuve concrète d’une coercition ayant entouré l’engagement du fournisseur. C’est évidemment beaucoup plus dur que de poser en principe le fait qu’une partie au contrat commercial obtient l’engagement de son cocontractant, parce qu’elle impose la signature d’une clause sans négociation.