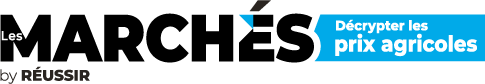Dossier endives : on reste sur sa faim

L’avocat général a rendu, le 6 avril dernier, ses conclusions dans l’affaire des endives pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. Décryptage.
On se souvient que la Cour de cassation, saisie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait annulé la décision de l’Autorité de la concurrence condamnant les endiviers pour pratiques anticoncurrentielles, avait décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) deux questions : l’une, portant sur le point de savoir si des pratiques de nature anticoncurrentielle d’organisations ou d’associations d’organisations de producteurs pouvaient échapper aux interdictions édictées par le droit de la concurrence au motif qu’elles seraient rattachées aux missions dévolues à ces organisations ; l’autre, visant plus précisément les pratiques rendues ou non possibles par les objectifs de régularisation des prix à la production et d’adaptation de l’offre à la demande fixés par les OCM successives.
L’avocat général, chargé de proposer à la CJUE son analyse et ses orientations, rappelle d’emblée que selon le droit de l’Union européenne, la Pac doit l’emporter sur les objectifs du traité en matière de concurrence. Mais il souligne également que le secteur agricole ne saurait constituer un espace « sans concurrence ». Il considère en définitive qu’il est nécessaire de reconnaître aux OP et AOP la possibilité d’échapper à l’application des règles de concurrence pour leur permettre d’accomplir certaines des missions qui leur sont confiées, mais sous certaines conditions.
Le rôle des AOP et OP réduit
Dans le même temps, l’avocat général réduit en effet singulièrement le rôle des AOP et OP, qu’il limite au renforcement de la position des producteurs et de leur pouvoir de négociation par le regroupement des ventes et la centralisation de la commercialisation des produits de leurs membres. À ce titre, elles doivent notamment disposer de la maîtrise des prix de vente.
L’avocat général précise ainsi qu’il ne suffit pas qu’OP et AOP concourent à la réalisation des missions qui leur sont confiées. Elles ne peuvent échapper aux règles de concurrence que si elles ont véritablement en charge de la commercialisation : il ne s’agit pas de favoriser la collusion entre producteurs ou OP au sein d’une AOP, mais de transférer à celle-ci la fonction même de commercialisation.
La réponse aux questions posées par la Cour de cassation s’évince tout entière de cette analyse : le droit agricole comporte à travers les OCM successives et les missions qu’elles confèrent aux AOP et OP des dispositions dérogatoires au droit de la concurrence. Mais ces missions ne peuvent être remplies que dans la mesure où les OP et AOP concernées sont chargées de la commercialisation des produits, aux lieu et place de leurs membres. Sans que la question de la propriété du produit et de son transfert soit évoquée, c’est bien elle qui est sous-tendue, même si, rappelons-le, la commercialisation sous mandat de vente reste possible.
Intérêt de la dérogation posée en principe ?
Sur la base de cette analyse quelque peu réductrice, l’avocat général ne pouvait aboutir qu’à proposer à la Cour de justice de considérer comme anticoncurrentielles, et sans dérogation, les pratiques de concertation constatées au sein d’une OP ou AOP, mais menées par des opérateurs commerciaux indépendants.
Ainsi, à partir d’une pétition générale du caractère dérogatoire de la Pac par rapport aux règles de concurrence, mais au travers d’une vision réductrice du rôle imparti aux OP et AOP par les OCM, on arrive à une position en tout point similaire à celle applicable à tous les secteurs : les entreprises constituant une entité économique unique échappent au droit des ententes. On se demande alors quels sont la nature et l’intérêt de la dérogation posée en principe.
Si elle suit son avocat général, la Cour de justice ne pourra que répondre en un sens qui entraînera une cassation de l’arrêt, favorable aux endiviers, rendu par la cour d’appel de Paris. Celle-ci devra à nouveau se prononcer en s’attachant à analyser plus finement les faits réellement reprochés. Mais la clarification attendue de la relation entre droit agricole et droit de la concurrence n’aura pas lieu si la cour de Luxembourg n’approfondit pas la réflexion.
LE CABINET RACINE
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents personnes en France (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Saint-Denis de La Réunion), il réunit près de soixante-dix avocats et juristes à Paris. Il dispose également d’un bureau à Bruxelles et à Beyrouth. Bruno Néouze, associé, y traite avec son équipe les questions relatives à l’agriculture et aux filières agroalimentaires. Il conseille et assiste de nombreuses entreprises agroalimentaires et organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles.
Racine - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris - www.racine.eu