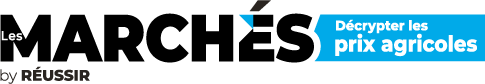Coopération commerciale : quelques rappels utiles
La coopération commerciale doit porter sur un service distinct de la simple obligation incombant à l’acheteur professionnel. Et il faut pouvoir le justifier. Explications.
Au moment où fournisseurs et distributeurs se préparent en vue de leur prochaine campagne de « contrats d’affaires » devant aboutir à la signature de conventions conformes à l’article L441-7 du Code de commerce d’ici au 1er mars 2017, la jurisprudence, et en particulier la cour d’appel de Paris, seule juridiction d’appel compétente en matière de pratiques restrictives, est régulièrement amenée à rappeler quelques principes de base sur la coopération commerciale.
Définie par l’article L441-7 2° du Code de commerce, la coopération commerciale désigne « les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent ».
Par conséquent, la coopération commerciale est, avant tout, un service que le distributeur s’oblige à rendre au fournisseur, et qui doit être précisément décrit dans la convention quant à sa nature, sa date et ses modalités de réalisation, son coût et les produits ou services auxquels il se rapporte. Cette exigence légale n’est ni anodine ni gratuite : il s’agit de faire ressortir, dès la convention, que le service attendu est distinct de la simple obligation qui incombe à l’acheteur professionnel de produits ou services qui souhaite les revendre.
Un service spécifique
Le service doit donc être propre à favoriser l’achat par le consommateur ou un autre professionnel, ce qui ne se limite pas à exposer les produits à la vente, sans mise en avant particulière. Or, en la matière, l’inventivité des rédacteurs est quasiment sans limite, de telle manière qu’il est parfois bien difficile de déterminer à quel service spécifique correspond la prestation de coopération commerciale prévue au contrat. C’est un cas de ce type que la cour d’appel de Paris a tranché le 29 juin 2016, en considérant qu’une « action de diffusion du tronc commun d’assortiment TAC » ne relevait pas de la coopération commerciale. Particularité de l’espèce, les faits dataient de 2004 !
La cour d’appel a rappelé, à juste titre, que le service qui donne lieu à rémunération dans le cadre d’une coopération commerciale doit être spécifique en ce qu’il donne un avantage particulier au fournisseur en stimulant la revente de ses produits. Or, selon la cour, les fournisseurs ignoraient le contenu exact de la prestation facturée ! C’était l’indice supplémentaire du caractère fictif de la prestation facturée. D’où répétition de l’indu (77 M€ tout de même), et une amende civile. Il faut donc que le service relève bien de la coopération commerciale.
Des preuves à apporter
Mais ce n’est pas tout ! Car, quand bien même le service décrit au contrat ne serait pas, en apparence, fictif, encore faut-il pouvoir justifier de ce qu’il a bien été rendu. À ce sujet, la loi spéciale (art. L441-7 alinéa 3 du Code de commerce) précise, de manière redondante par rapport au droit commun des obligations, que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait qui a produit son extinction. En d’autres termes, le service ne peut être facturé et payé que si le distributeur prouve que le service convenu a bien été rendu.
Nous sommes en matière commerciale, et la preuve est libre, mais le juge du fond apprécie souverainement les preuves soumises. Et s’il en vient à considérer que les preuves soumises ne sont pas suffisantes, la sanction est la même que précédemment, à savoir que la coopération commerciale est considérée comme fictive, et les sommes perçues doivent être restituées. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris dans une seconde affaire, le 29 juin 2016, également. S’agissant de prestations purement matérielles comme de la « tête de gondole », la constitution d’une preuve fiable et datée de sa réalisation effective conduit inévitablement au constat d’huissier.
Cette technique est d’ailleurs privilégiée depuis fort longtemps par les architectes et autres maîtres d’œuvre assujettis à une obligation d’affichage des permis de construire.
MAÎTRE DIDIER LE GOFF
Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années dont vingt ans au sein du cabinet LPLG Avocats, dont il fut associé, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise et à l’écoute de ses besoins, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international. Contact : dlegoff.avocat@gmail.com