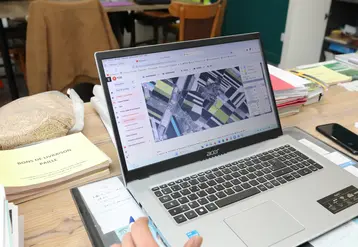Frédéric Beigbeder - " L'image de la vie simple à la ferme a repris de la force "

Entre l’écriture de son prochain roman et le bouclage du magazine Lui, Frédéric Beigbeder a pris le temps de se poser pour raconter sa vie mi-parisienne mi-campagnarde, son rapport à la terre et le marché de Guéthary. Interview fourche(tte) à la main.
Propos recueillis par Raphaël Turcat - Interview à retrouver dans le 1er numéro de Life&Farms
Il y a quelques années, vous avez choisi de quitter en partie Paris pour vous installer à Guéthary. Pourquoi ce choix ?
J’ai eu un besoin de nature et un souvenir de campagne, de bord de mer, de maison familiale, de jardins, d’arbres et d’animaux qui est remonté en moi. Quand j’ai écrit Un roman français à la fin des années 2000, ça a été un déclic : ai-je envie de passer ma deuxième moitié de vie dans les mêmes endroits absurdes que la première ? Passer une trentaine d’années dans les toilettes des boîtes de nuit m’a appris que j’avais peut-être droit à un peu de vert, de frais, de mer, de soleil. Et si j’ai beaucoup voyagé, il y a des endroits où je me sens bien. Guéthary en fait partie.
Ça ressemble à quoi une journée-type de Beigbeder gentleman farmer ?
Je suis à Paris pour travailler jusqu’au jeudi matin puis je pars au Pays basque jusqu’au lundi matin. Ce qui a beaucoup changé par rapport à la première partie de mon existence, c’est que j’ai eu un bébé qui m’a fait découvrir un concept : le matin. Ensuite, comme tout citadin qui s’installe à la campagne, j’ai découvert un autre concept : les saisons.
Maintenant, j’ai un jardin et je vois les arbres revivre ou dépérir. J’écris, je marche, je vais voir la mer, je fais les courses au marché de Saint-Jean-de-Luz ou aux halles de Biarritz. C’est là que je prends réellement conscience que la vie de citadin est une escroquerie : tout ici est moins cher et meilleur qu’à Paris ! Après les courses, j’aime manger tout ce que j’ai acheté. Il y a quelques trucs que je sais cuisiner comme le magret, les asperges à la sauce mousseline, les œufs brouillés aux truffes, aux cèpes, aux morilles, les moules… Ce ne sont pas des grands plats mais il n’y a pas de plaintes de ma famille. Le soir, je prends l’apéro en regardant le coucher du soleil.
À Guéthary, vous êtes en plein Béarn. Quelles sont les spécialités du terroir ?
Il y en a deux que j’aime beaucoup : la garbure et l’axoa. La garbure est une soupe délicieuse de légumes mélangés à du jarret de jambon et des manchons de canard ; l’axoa, du veau haché avec des poivrons, de l’oignon, du piment d’Espelette, c’est à tomber. Mais ce que je préfère, c’est la poule au pot nappée à la crème, qui est un plat assez roboratif. Ce qui est amusant, c’est que comme Guéthary est à la mode, quand des filles de Los Angeles habituées aux jus d’herbes arrivent ici, elles sont horrifiées par les portions qu’on leur sert. Les Espagnols ont trouvé la solution à tout ça : les tapas. Pour rester en forme, il ne faut pas grignoter entre les repas mais grignoter pendant les repas !
Quel est votre premier souvenir d’enfance lié à la campagne ?
La pêche à la crevette sur la plage de Cenitz avec mon grand-père. Et aussi la cueillette des mûres. En fait, la nature, c’est comme un self-service : ramasser des fraises des bois dans un chemin, cueillir des cèpes dans la forêt d’Iraty, c’est féérique quand on est enfant. Et cueillir des cèpes, des noix ou des fruits mûrs, c’est quand même plus poétique que d’empiler des yaourts dans un caddie !
D’ailleurs, de plus en plus de citadins partent vivre à la campagne…
Après la guerre, on nous a vendu un style de vie américain. C’était les Trente Glorieuses, c’était très amusant, les Français se mettaient à parler anglais… Depuis, on est revenus de cette illusion, qui était une utopie comme une autre, et l’image de la vie simple à la ferme a repris de la force.
Alors oui, c’est une vie dure mais l’image du monde agricole change. Entre l’exode rural, l’omniprésence des hypermarchés, le rêve européen, l’agriculture, c’était mort il y a quelques décennies. Aujourd’hui, l’image d’une ferme redevient une utopie : les gens ont compris la nécessité de sauver ce monde-là, de revivre près des saisons, près de la vérité, dans une simplicité qui est un luxe pas lié à l’argent puisque tout coûte moins cher à la campagne qu’à la ville. À partir du moment où les gens ont compris ça, c’est foutu pour les hypermarchés !
Le retour à la nature n’est pas non plus nouveau. Déjà, les hippies l’avaient imaginé dans les années 1960-70…
Oui, ils en avaient fait un rêve mais l’ont un peu ridiculisé et, finalement, c’est ma génération qui va le réaliser : une génération nihiliste qui découvre la beauté d’une poule en train de pondre un œuf. De toute façon, on n’a plus le choix : on n’a plus les moyens de se payer des appartements en ville et de suivre un mode de vie mauvais pour la santé. Bientôt, je vais quitter définitivement la ville, je ne vais plus vivre à Paris du tout.
N’est-ce pas une vision très romantique de la vie rurale ?
Oui, ma vision est assez idyllique mais vivre à la campagne, c’est aussi une utopie à défendre ! Cette image rousseauiste, c’est un combat à mener contre l’agriculture industrialisée et pour le bio. Ça va prendre quelques années mais je pense que nous ne sommes pas si loin d’un temps où les agriculteurs vendaient leurs bons produits à des consommateurs qui étaient autour d’eux, sans avoir à se développer à outrance.
Le Salon de l’agriculture, c’est votre came ?
J’y suis allé petit. Ce qui m’amuse, c’est tout le cirque des hommes politiques qui viennent y chercher des voix. On sentait que Jacques Chirac aimait vraiment l’événement, d’autres sont moins à l’aise… Mais je ne suis pas très Salon, de l’agriculture ou de la littérature, d’ailleurs.
Ce qui est dommage, finalement, c’est d’avoir déplacé les halles à Rungis. Les halles, c’était le Salon de l’agriculture permanent au cœur de Paris, son ventre, ce qui est très symbolique. J’aurais beaucoup aimé cette période si j’avais pu la vivre, il y a des photos incroyables de cette époque.
Vous avez la main verte ?
Pas vraiment. On a un jardinier qui vient deux fois par mois et avec qui je discute. Au début, je voulais un grand chêne dans mon jardin. Il m’a expliqué que ça ne prendrait pas, qu’il y avait d’autres arbres qui marcheraient mieux. À Guéthary, la terre est assez argileuse, il y a des arbres qui s’y implantent, d’autres, pas. Là, j’ai planté un olivier, qui est en train de prendre. On a deux platanes aussi, et un pin immense que j’adore. Il est très penché, c’est ma tour de Pise à moi.
Depuis votre nouvelle vie, avez-vous noué des liens avec des agriculteurs ?
Des producteurs du marché, plutôt. J’ai été intronisé à la confrérie du porc noir de Bigorre avec Edouard Baer, on en est très fiers. Ça consiste à rencontrer des éleveurs en goûtant du porc noir, en buvant du vin et en chantant des chansons. Je rencontre des vignerons aussi et j’ai eu l’honneur d’écrire une phrase sur le chasse-spleen. Chaque année, ils font appel à un écrivain et en 2014, c’était mon tour. J’ai écrit cette phrase : « Un chasseur de spleen finit par collectionner des trophées de mélancolie. » Sinon, pour assurer ma farm cred’, j’ai écrit 99 francs dans une ferme du Lot, entouré de cochons. Pas mal pour un livre aussi urbain !
Écrire, c’est transformer une idée brute en quelque chose de comestible. Écrivain et agriculteur, même combat ?
Oui, il y a une maîtrise du temps, une discipline qui relient ces deux activités et dont je prends de plus en plus conscience. Avant, j’écrivais bourré à l’arrière des taxis, j’avais une vision romantique de poète échevelé et alcoolisé. Et puis j’ai compris que tout ça était bidon et que ce qui compte, c’est de se réveiller le matin avec l’esprit clair et travailler sans allumer son téléphone jusqu’à ce que l’on ait écrit une page. Après, la matière d’un écrivain est moins palpable que celle d’un agriculteur : on dépend moins des saisons que de ses humeurs.
Il y a quand même des règles du jeu communes. Il y a un côté physique, terrien, on apporte notre produit fini au public. D’ailleurs, les grands écrivains sont des travailleurs forcenés : Honoré de Balzac, Marcel Proust qui en crève dans sa chambre… À la fin de sa vie, Léon Tolstoï rêvait même de devenir un moujik, un agriculteur, un serf.