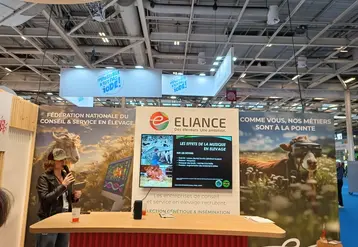En système maigre, « le choix des intrants pour générer du produit »
Rémi Louvrier, à la tête d’un troupeau de quatre-vingt-quinze mères charolaises à Saint-Léger-de-Fougeret dans le Morvan, a fait le choix d’une productivité pondérale élevée en misant sur les intrants. Sa proximité du marché au cadran de Moulins-Engilbert constitue un atout de taille pour valoriser ses broutards alourdis ainsi que ses génisses et vaches semi-finies au pré.
Rémi Louvrier, à la tête d’un troupeau de quatre-vingt-quinze mères charolaises à Saint-Léger-de-Fougeret dans le Morvan, a fait le choix d’une productivité pondérale élevée en misant sur les intrants. Sa proximité du marché au cadran de Moulins-Engilbert constitue un atout de taille pour valoriser ses broutards alourdis ainsi que ses génisses et vaches semi-finies au pré.










Nichée dans un vallon du Morvan dans la Nièvre, l’exploitation de Rémi Louvrier, qui a démarré en 2007, jouxte celle de son frère Thomas, installé depuis 2020. C’est un « copié-collé » de la sienne : même taille, même conduite d’élevage, mêmes surfaces fourragères, mêmes résultats. Les deux frères ont chacun leur structure, mais ils travaillent ensemble. « Nous avons nos propres bâtiments, mais nous partageons beaucoup de matériels comme le parc de contention et les aires de stockage, explique Rémi Louvrier. Pour limiter les coûts, nous faisons appel à la Cuma, en particulier pour les travaux de fenaisons. »
Un chargement très élevé sur prairies naturelles
Le parcellaire est morcelé. Il compte vingt îlots et des parcelles de 3 à 4 hectares où pâturent quinze vaches environ, voire moins. « Nous disposons de nombreux captages de source qui nous permettent de distribuer une eau fraîche de qualité. Il en reste encore à aménager pour ne plus avoir à charrier des tonnes à eau », indique Rémi Louvrier. 95 % des surfaces sont en prairies naturelles, dont 40 % sont plus facilement mécanisables. Chaque année, 3 hectares de prairies temporaires en rotation longue avec les céréales sont ressemés. Peu profond, le sous-sol granitique est séchant, d’où l’achat de fourrages régulier pour sécuriser un chargement très élevé pour cette petite région agricole. « Il atteint 1,30 UGB/ha de SFP, contre 1,03 en moyenne locale, soit 26 % d’écart », précise l’éleveur.
L’achat de paille et de fourrages complémentaires se fait chez un céréalier situé à trente kilomètres. Les quantités varient entre 150 et 200 tonnes de paille et 30 à 50 tonnes de foin selon les années. Rémi Louvrier fait usage régulièrement davantage d’engrais minéraux (19 N, 13 P, 9 K par ha) qu’en pratique locale et valorise au mieux les effluents d’élevage pour préserver la productivité de ses prairies. « C’est une nécessité pour maintenir un tel niveau de chargement », souligne-t-il.
La mise à l’herbe se fait mi-avril et les veaux mâles sont complémentés à partir de juin à raison de 600 à 700 kg par broutard jusqu’à la vente. Les femelles ne sont pas complémentées, hormis les laitonnes destinées à l’élevage et ce, à partir de la mi-juillet à raison de 400 à 500 kg de concentrés.
Une complémentation en fourrages inévitable
Les vêlages sont groupés de décembre à fin mars. La productivité numérique atteint 95 %. Le taux de renouvellement se situe quant à lui autour de 25 %, avec un premier vêlage à 36 mois. « Sur cette dernière campagne, l’intervalle vêlage-vêlage (IVV) de mon troupeau s’établit à 380 jours, au-delà des 365 jours d’avant les sécheresses qui ont particulièrement impacté le Morvan (2018, 2019 et 2020). Il tend à se réduire, car nous avons appris à mieux gérer les périodes alimentaires critiques, mais avec, toujours, l’apport de fourrages achetés pour boucler », explique Rémi Louvrier. Le taux de mortalité est relativement bas (4 %). Il résulte d’une surveillance accrue et de dépenses préventives élevées. « Nous avons fait le choix de systématiser la vaccination (FCO, BVD, diarrhées, maladies respiratoires…), ce qui induit des frais vétérinaires à l’UGB importants, mais cet apport est nécessaire », estime-t-il.
« Nous avons appris à mieux gérer les périodes alimentaires critiques », souligne Rémi Louvrier.
La repousse des broutards paye
La proximité du cadran de Moulins-Engilbert, dans la Nièvre, oriente la destination du type d’animaux produits dans la région. « C’est un super outil de valorisation dont je profite en produisant des animaux de qualité. J’assume les charges en face comme l’alourdissement au concentré », explique Rémi Louvrier.
Par exemple, en 2023, « j’aurais pu vendre mon dernier lot de broutards après sevrage, mais j’ai préféré lui faire prendre des kilos supplémentaires sous la mère. En 42 jours, à raison de 7,5 kg d’aliment complet à 18 % quotidien, j’ai obtenu des croissances avoisinant 2 400 g/j, soit un gain de 100 kg au total », expose l’exploitant. À 4 euros le kilo vif et 315 kg de concentré à 0,35 €/kg, Rémi Louvrier a réalisé une plus-value d’environ 300 euros par broutard.
Quant aux vaches, « elles sont toujours en état et je vends les réformes non pas « maigres » mais semi-finies au pré, « fleuries » dans notre jargon même si cette conduite coûte ». Les vaches sont à l’herbe en fin d’été pendant un mois à un mois et demi avec un aliment complet du commerce représentant les deux tiers d’une ration d’engraissement. En cas de sécheresse, elles sont préparées à l’auge en bâtiment avec un régime engraissement.
Les animaux du bassin de Moulins-Engilbert sont reconnus pour leur qualité, que ce soit pour l’export ou la finition dans d’autres régions françaises », souligne l’éleveur, aussi administrateur du marché au cadran.
La comparaison des bilans de campagne de 2023 et 2024 montre que les productions brutes de viande vive sont similaires et très élevées pour un système maigre. Elles atteignent plus de 380 kgv/UGB, contre 320 à 340 dans les références système correspondantes. Chez Rémi Louvrier, l’augmentation du prix du kg vif vendu représente 0,50 euro, soit + 16 % entre 2023 et 2024. À 3,72 € kg vif en moyenne en 2024, les animaux affichent une valorisation supérieure de 0,20 euro à ceux des systèmes analogues, confortant ainsi les choix stratégiques génétiques de l’éleveur (lire l’encadré).
Son inscription au herd-book depuis 2010 lui permet de valoriser quelques reproducteurs chaque année. Ce sont des animaux de type mixte viande qui lui sont demandés ainsi que des reproducteurs « vêlages faciles » issus d’insémination. En circuit court, Rémi Louvrier valorise également certains animaux d’exception comme ses deux bœufs classés E à 700 kg carcasse en 2024, ce qui contribue à l’amélioration globale du produit viande.
À la recherche du bon « éco-équilibre »
« Si mon système de production est très dépendant du prix des intrants, la maîtrise technique couplée à la très bonne valorisation commerciale de mes animaux permet toutefois de supporter les charges, ce qui est d’autant plus vrai aujourd’hui avec l’augmentation des cours », analyse Rémi Louvrier. Mais se pose la question de la durabilité de son système vis-à-vis du dérèglement climatique, entre autres les sécheresses. Le retour à un chargement de 1,10 à 1,15 UGB/ha est possible en diminuant le nombre de vêlages, mais il aurait un impact certainement négatif sur le revenu. S’agrandir n’est pas la priorité de Rémi Louvrier, qui préfère conserver une « exploitation à taille humaine ». Un agrandissement générerait par ailleurs une charge de travail supplémentaire alors que l’éleveur aspire à se dégager plus de temps libre. L’équation n’est pas simple à résoudre.
Rémi Louvrier a néanmoins trouvé des solutions depuis l’installation de son frère, Thomas. « Nous partageons les tâches telles que la surveillance des vêlages qui se fait indifféremment par l’un ou l’autre. Cette répartition conduit à une meilleure organisation du travail et permet de ménager du temps libre en famille », souligne l’exploitant.
Chiffres clés
SAU de 115 ha au total dont 109 ha de SFP à 95 % en prairies naturelles et 6 ha de cultures (5 ha de triticale et 1 ha de blé tendre autoconsommés)
Exploitation située à 420 m d’altitude, comptant une pluviométrie annuelle de 1 100 mm
95 vaches charolaises et leur suite, pour un total de 139 UGB
Chargement de 1,3 UGB/ha de SFP
1 UMO
Le niveau génétique en progression se ressent sur les performances des veaux
Le niveau génétique des femelles est correct (ISEVR à 97,2 et IVMat à 96,1) et en progression par l’utilisation de taureaux améliorateurs (ISEVR à 105 et IVMat à 105), ce qui se ressent sur les veaux. « J’insémine moi-même les génisses avec des taureaux issus du centre d’insémination animale (IA) et les vaches avec les doses prélevées de taureaux achetés. Pratiquement toutes les femelles sont pleines avant la mise à l’herbe. Je cherche des animaux de type mixte viande avec du potentiel de croissance et de la finesse d’os », développe Rémi Louvrier. Pour lui, le niveau génétique du troupeau ne s’exprime pas pleinement du fait du fort chargement. Le bilan génétique du troupeau allaitant (BGTA) montre que l’effet élevage sur l’expression des effets génétiques directs et maternels sur le poids au sevrage, à + 32,5 kg par rapport à la campagne précédente, fait aussi la différence sur les performances des veaux.
Frédérique Marceau, conseiller d’entreprise à la chambre d’agriculture de la Nièvre
« Une production impressionnante de 380 kg/UGB en système maigre herbager »
« Suivi dans le cadre du réseau de références Inosys, Rémi Louvrier montre de fortes capacités de gestion globale de son exploitation, qui reposent entre autres sur l’analyse de ses résultats technico-économiques consolidés. L’éleveur a souhaité conserver une dimension « maîtrisable », plutôt modeste au regard de la taille des exploitations nivernaises. Le troupeau fait l’objet de toutes les attentions, qui expliquent un niveau de charges opérationnelles supérieures par rapport aux systèmes similaires d’Inosys Réseaux d’élevage.
Cependant, comme il a été démontré dans nos études de groupe, l’amélioration de la productivité pondérale et du produit sans aides (en kilos vifs et euros par UGB) va de pair avec la hausse des intrants.
En principe, sauf cas particulier, l’augmentation des charges opérationnelles engagées (ramenées à l’UGB ou au nombre de vêlages) génère un accroissement du produit viande supérieur à celui des charges supplémentaires. Cela se traduit donc par une progression de la marge unitaire (à l’UGB ou au nombre de vêlages). C’est le cas pour le système de Rémi Louvrier qui enregistre une marge brute à l’UGB d’un très bon niveau (532 € par UGB en 2023 et 666 € en 2024). L’acte de production qui consiste à alourdir les mâles est toujours rémunérateur et c’est d’autant plus vrai avec la conjoncture de 2024. »