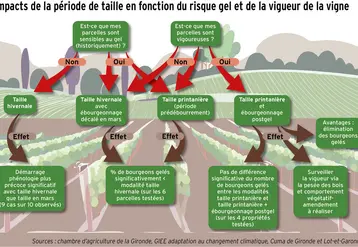Matériel agricole : quatre pistes pour l’entretenir à moindre frais
La maintenance du parc de matériel agricole représente un budget non négligeable. Voici quelques astuces et conseils pour diminuer le poids de ce poste.
La maintenance du parc de matériel agricole représente un budget non négligeable. Voici quelques astuces et conseils pour diminuer le poids de ce poste.

- Bien régler ses équipements agricoles
- Gonfler les pneus des engins agricoles à la pression route
- Adapter la vitesse de travail du matériel agricole au type de sol
- Nettoyer soigneusement ses outils agricoles et les ranger à l’abri
- Hiverner le matériel agricole sensible
- Stocker son matériel agricole à l’abri et le protéger
- Contrôler régulièrement ses outils agricoles
- Dénicher des pièces à moindre coût
- Privilégier l’achat de pièces en morte-saison
- Utiliser l’impression 3D pour façonner les pièces d’usures de son matériel agricole
- Diminuer le coût de la main-d’œuvre lors des réparations
- Faire appel à de petits artisans
- Se former pour réaliser soi-même l’entretien
Les bonnes pratiques d’utilisation de son matériel agricole
1. Bien régler ses équipements agricoles
Même si cela ressemble à un lieu commun, les conseillers en machinisme insistent sur le fait que pour diminuer les coûts d’entretien, le premier geste consiste à bien régler les outils. « Un déchaumage, c’est 5 cm de profondeur et non 10 ou 12, illustre Éric Canteneur, conseiller machinisme à l’Union des Cuma des Pays de Loire. Si la profondeur n’est pas respectée, on brassera davantage de terre, cela demandera des efforts supplémentaires, ce qui usera davantage le matériel et consommera plus. » Il recommande de consulter les livrets d’utilisation et d’entretien de chaque outil, fournis lors de l’achat. « Ce sont des mines d’informations, assure-t-il. Trop souvent, ils restent dans leur emballage plastique, c’est dommage. »
2. Gonfler les pneus des engins agricoles à la pression route
Même topo pour les pneumatiques. « Il faut veiller à avoir les bonnes pressions de gonflage pour éviter l’usure prématurée », insiste Christophe Auvergne, conseiller agroéquipement à la chambre d’agriculture de l’Hérault. Une opération difficile lorsque l’on effectue dans la même journée champ et route. Mais avant les gros chantiers, comme les vendanges ou les moissons, où les tracteurs vont réaliser beaucoup de trajets, il préconise de gonfler les pneus du tracteur à la pression route.
3. Adapter la vitesse de travail du matériel agricole au type de sol
Le respect des vitesses de travail est un autre point clé. « Avec l’évolution des puissances sur les mêmes outils, on a tendance à augmenter la vitesse de travail, regrette le conseiller ligérien. Or cela use davantage le matériel. Par exemple, passer une herse rotative à 10 km/h pour faire un lit de semences sera moins favorable au semis et usera plus l’outil. »
Ménager sa monture est donc un préalable nécessaire. Tout comme la bonne adéquation entre son outil et ses terres. « Certaines usent beaucoup, d’autres moins, résume Éric Canteneur. Il est donc souhaitable d'adapter ses pratiques culturales à ses sols. » À titre d’illustration, le recours à des pointes de carbure peut être intéressant sur des terres dures et usantes, mais sera contre-productif sur des terrains avec cailloux et roches car elles risqueraient de casser.
Par ailleurs, être vigilant, soigneux et attentif lors de l’utilisation des appareils permet d’éviter les casses et donc de limiter les frais de maintenance.
Les bonnes pratiques d’entretien du matériel agricole après utilisation
1. Nettoyer soigneusement ses outils agricoles et les ranger à l’abri
Un matériel bien nettoyé et bien protégé s’usera moins vite, aura moins de pannes et nécessitera donc de ce fait moins d’entretien. En ce sens, quelques précautions sont de mises après le nettoyage. Il faut notamment veiller à graisser les roulements ou à faire tourner le moteur afin de chasser l’eau. « Mais attention, certains roulements, comme les étanches, n’en ont pas besoin, relève Christophe Auvergne. Il faut suivre les préconisations des notices. »
2. Hiverner le matériel agricole sensible
De même, l’hivernage du pulvérisateur et de tous les matériels sensibles est primordial afin d’éviter le dessèchement et/ou l’éclatement de certaines pièces. « Je préconise de bien vider le pulvérisateur, puis de mettre 10 ou 20 litres d’antigel au fond de la cuve, décrit Christophe Auvergne. Puis on met le pulvérisateur en route jusqu’à ce que l’antigel commence à sortir. Ainsi, tout le circuit baigne dans l’antigel qui est un milieu un peu gras. Cela permet de préserver les pièces en caoutchouc, comme les membranes, les clapets de pompe, etc., et donc de prolonger leur durée de vie. »
3. Stocker son matériel agricole à l’abri et le protéger
Stocker son matériel à l’abri est un autre point clé. « De manière générale, laisser ses outils à l’extérieur fait qu’ils seront soumis aux intempéries, à l’eau, observe Éric Canteneur. Ils se défraîchiront beaucoup plus vite et les roulements, bagues, etc., peuvent rouiller. » Il invite également à protéger les matériels des rayons du soleil et de la lune, « qui ont un très mauvais effet sur le vieillissement, principalement du plastique », rapporte-t-il. En cas de manque de place, il faut en priorité protéger les automoteurs (tracteurs, machines à vendanger, moissonneuses-batteuses, etc.) puis les pulvérisateurs. Un bâchage des éléments à l’extérieur peut être effectué.
4. Contrôler régulièrement ses outils agricoles
Afin d’éviter de gros entretiens coûteux, vidanges, graissage, nettoyage des filtres, du radiateur, etc., doivent être effectués à intervalles réguliers, en respectant les préconisations des constructeurs. De même, inspecter régulièrement ses outils permet d’intervenir en amont, avant qu’une grosse casse ou panne ne survienne.
Les bonnes pratiques pour diminuer ses frais de maintenance
1. Dénicher des pièces à moindre coût
Une autre voie pour diminuer ses frais de maintenance est de s’approvisionner en pièces adaptables. « Certaines sont exactement les mêmes que les pièces d’origine, témoigne Éric Canteneur. Elles portent même parfois l’estampille du constructeur. » De cette manière, il est possible de payer ses pièces facilement 20 % moins cher. On peut en trouver chez Opus ou chez Landa.
De même, il existe toujours des forges qui fabriquent des pièces de seconde monte qui peuvent être moins chères. « Pour les pièces qui sont également employées dans l’industrie, comme les flexibles hydrauliques ou les roulements, on peut en racheter chez des industriels comme la Cir (Compagnie industrielle du roulement), signale Christophe Auvergne. Les différences de prix sont très importantes. » Certains concessionnaires sont également équipés pour fabriquer des flexibles à moindre coût.
2. Privilégier l’achat de pièces en morte-saison
Autre réflexe à adopter : celui d’acheter ses pièces en morte-saison. « Attention, la morte-saison ne sera pas la même pour tous les matériels, prévient Éric Canteneur. En hiver, c’est par exemple le moment d’acheter des pièces pour les machines à vendanger, les moissonneuses-batteuses ou pour les outils de travail du sol. » Se regrouper à plusieurs avant de passer commande ou encore acheter sur internet chez des fournisseurs sérieux, de type Promodis, permettent aussi d’alléger la facture. Opter pour des pièces renforcées (au carbure de tungstène) est également un bon calcul selon Christophe Auvergne. « Elles sont plus chères à l’achat, mais ont des durées de vie vraiment plus importantes, note-t-il. On s’y retrouve vite, et ce d’autant plus que l’on perd moins de temps en entretien, la fréquence de renouvellement diminuant. »
3. Utiliser l’impression 3D pour façonner les pièces d’usures de son matériel agricole
De même, avoir recours à l’impression 3D peut s’avérer une solution gagnante, notamment pour refaire certaines pièces d’usures, petits carters ou autres. « C’est surtout intéressant pour les pièces qui n’existent pas ou n’existent plus, nuance Christophe Auvergne. Mais sinon c’est un sacré investissement. » Il faut en effet mesurer toutes les cotes au pied à coulisse, connaître le fonctionnement de sa machine afin que les pièces s’emboîtent bien les unes dans les autres, savoir modéliser, imprimer dans le bon sens pour avoir la meilleure résistance, etc. « Par ailleurs, l’imprimante dépose des couches successives, pointe le conseiller en agroéquipement, ce qui fait que la résistance par exemple d’une main de pulvé sera moins forte qu’avec une pièce moulée ou injectée. »
4. Diminuer le coût de la main-d’œuvre lors des réparations
Effectuer toutes ses réparations soi-même revient évidemment moins cher que de passer par un concessionnaire. « Je vois certains agriculteurs qui sont démunis lorsqu’un phare est en panne, constate Christophe Auvergne. C’est dommage. C’est bien de savoir que sur un tracteur, le courant est continu, qu’on a un plus et une masse. Suivre une formation de base en électricité est utile (cf. encadré). De même, savoir utiliser un multimètre est pratique. Sur cet aspect, on peut se former en regardant deux ou trois tutoriels sur internet. »
Mais si certaines opérations sont simples, à l’instar du changement des pièces d’usure qui ne nécessite guère que d’être équipé d’une clé manuelle ou à chocs, d’autres sont ardues, voire impossibles. « Sur les tracteurs, il n’y a plus grand-chose de faisable, reconnaît Éric Canteneur. Même les vidanges ne sont pas évidentes, car si l’utilisateur a souscrit un contrat d’entretien, ce dernier doit être effectué en concession pour maintenir la garantie. Toutefois, des accords avec le concessionnaire sont possibles pour effectuer soi-même la vidange du moteur. » Pour ce qui est des vidanges des boîtes de vitesses, elles nécessitent bien souvent des équipements particuliers. Quant à l’électronique, ce n’est plus faisable sur le domaine.
5. Faire appel à de petits artisans
Faire appel à de petits artisans ou aux salariés des Cuma peut être un entre-deux intéressant. Le coût horaire peut ainsi passer de 70 ou 80 euros de l’heure en concession, à 25 ou 30 euros de l’heure. De quoi faire des économies substantielles ! Éric Canteneur recommande par exemple de faire appel aux artisans du réseau Scar (Société coopérative de l’artisanat rural). Dernier recours : il est aussi possible de faire jouer la concurrence entre concessionnaires ou encore de faire effectuer ses réparations ou son entretien en morte-saison.
6. Se former pour réaliser soi-même l’entretien
Semi continu, TIG, MIG… Ces techniques de soudure vous font rêver mais vous n’osez pas vous lancer ? Qu’à cela ne tienne ! De nombreux organismes, à l’image des chambres d’agriculture ou encore de l’Atelier paysan, proposent des formations permettant d’acquérir des bases en bricolage et notamment en soudure. Mécanique agricole, entretien du tracteur, électronique libre, hydraulique, travail du métal ou encore électricité sont aussi à la portée de tous grâce à ces organismes. La plupart de ces formations ne nécessitent aucun prérequis et sont finançables par Ocapiat pour les salariés ou Vivea pour les chefs d’exploitation.
L’entretien, à combien ça revient ?
Le coût de la maintenance des appareils dépend bien évidemment de leur âge et de leur surface d’utilisation. À titre d’exemple, selon le Guide des coûts de revient des matériels en Cuma, édition Est, 2023-2024, le coût d’entretien d’un tracteur vigneron sera de 1,50 euro par heure d’utilisation pour un véhicule de moins de trois ans. Ce coût montera à 4,60 euros par heure entre 3 et 5 ans, puis 5,20 euros par heure entre 5 et 7 ans et redescendra à 4,4 au-dessus de 7 ans d’âge.