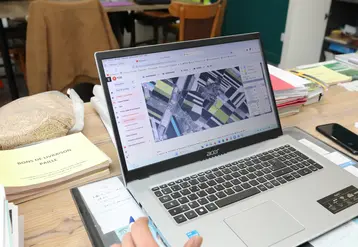Agrivoltaïsme : la loi AER précisée par un projet de décret
Très attendu par les professionnels agricoles, un projet de texte d’application de la loi Accélération des énergies renouvelables leur a été présenté fin juin. Il précise les conditions encadrant l’agrivoltaïsme.
Très attendu par les professionnels agricoles, un projet de texte d’application de la loi Accélération des énergies renouvelables leur a été présenté fin juin. Il précise les conditions encadrant l’agrivoltaïsme.

L’agrivoltaïsme est défini en France par la loi Accélération des énergies renouvelables (AER) du 10 mars 2023. Un texte fondateur pour cette nouvelle activité dont les détails doivent encore être précisés par les textes d’applications. Le 30 juin, un projet de décret très attendu a été dévoilé aux professionnels par la direction générale de l’énergie et du climat. Le texte a depuis fuité et nos confrères d’Agra Presse s’en sont procuré une version.
Que dit ce projet de décret visant à préciser les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers ?
Définition des services rendus par l’agrivoltaïsme
La loi AER indique que pour être considérés comme installation agrivoltaïque, les panneaux solaires doivent apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants :
- l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques
- l’adaptation au changement climatique
- la protection contre les aléas
- l’amélioration du bien-être animal
Le projet de décret définit « l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » comme « une amélioration des qualités agronomiques du sol et une augmentation du rendement de la production agricole », précisant qu’« à défaut d’une augmentation, le maintien voire la réduction d’une baisse tendancielle observée au niveau local suffit ». Pourrait également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation photovoltaïque permettant une remise en activité d’un terrain agricole inexploité depuis plusieurs années.
L’adaptation au changement climatique est définie comme « une limitation des effets néfastes du changement climatique débouchant sur une augmentation du rendement de la production agricole ». Elle peut s’apprécier par l’observation de l’un des effets adaptatifs suivants, selon le projet de texte :
- l’impact thermique : fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif
- l’impact hydrique : limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par l’irrigation ou diminution de l’évapotranspiration des sols, et confort hydrique amélioré
- l’impact radiatif : limitation des excès de rayonnement direct avec une protection contre les brûlures foliaires.
La protection contre les aléas peut être prise en compte si les panneaux photovoltaïques apportent une protection contre au moins une forme d’aléa météorologique ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation.
Quant à l’amélioration du bien-être animal, elle s’appréciera à la fois par l’amélioration du confort thermique des animaux (prouvée par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux) et l’accroissement de la production de biomasse pour le pâturage ou décalage de la pousse de l’herbe.
Activité agricole principale : un taux d’emprise au sol et une superficie à respecter
Selon la loi AER seules les installations solaires permettant à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole concernées pourront être considérées comme agrivoltaïques. Une condition respectée, selon la version du projet de décret consultée, si à la fois :
- le taux d’emprise au sol de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 30% sur parcelle pâturée et 45% sur culture végétale récoltée
- la superficie qui n’est pas cultivable du fait des panneaux agrivoltaïques est inférieure à 20% de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque.
- les panneaux permettent la circulation et l’abri des animaux et le passage des engins agricoles si les parcelles sont mécanisables.
Création d’une zone témoin pour évaluer la différence de rendement
La loi AER conditionne également l’installation de panneaux agrivoltaïques au fait qu’ « ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole » et qu’ils « garantissent à un agriculture actif une production agricole et un revenu durable ».
Pour encadrer cette notion, le projet de décret prévoit d’instaurer une zone témoin pour toute installation agrivoltaïque d’une puissance supérieure à 500 kWc (pour les projets inférieurs, les données historiques de l’exploitation ou à l’échelle départementale seront prises en compte). Cette zone témoin ne devra comporter aucune installation solaire et représenter au moins 10% de la surface agrivoltaïque exploitée.
Pour être considérée « comme significative », la production agricole de la parcelle concernée par l’agrivoltaïsme devra avoir un rendement par hectare n’étant pas inférieur de plus de 10% au rendement observé sur la zone témoin. Un rendement plus faible pourra être autorisé si l’installation agrivoltaïque « permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d’une production agricole ». Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, c’est la biomasse fourragère qui sera prise en compte.
Un projet de texte qui suscite des débats
Ce projet de décret suscite « notamment des débats autour de la notion d’activité principale des parcelles concernées », selon nos confrères d’Agra Presse qui citent « des sources syndicales ».
« Pourtant très insuffisant pour bloquer les projets-alibis et protéger le foncier agricole, ce projet de texte réglementaire a été attaqué de toutes parts par Chambres d’agriculture France, la FNSEA et la Coordination rurale », a déploré pour sa part la Confédération paysanne le 11 juillet dans un communiqué.
Pour aller plus loin
Agrivoltaïsme : un modèle économique et technique encore au banc d’essai
Des débuts prometteurs pour l'agrivoltaïsme en vigne
L’agrivoltaïsme se déploie en production ovine