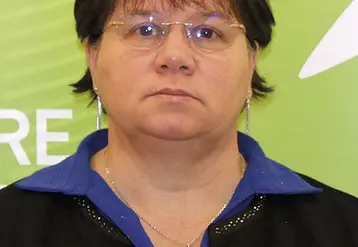JA
Michel Griffon a semé les graines de l’AEI en terres cantaliennes
Intervenant à l’assemblée générale des Jeunes Agriculteurs du Cantal, le chercheur et économiste Michel Griffon a convaincu avec son concept d’agriculture écologiquement intensive.

Il était en début de semaine en Normandie, puis en Anjou avant de rallier le Cantal et Maurs vendredi pour le congrès départemental des Jeunes Agriculteurs et une énième intervention sur l’AEI. Agriculture écologiquement intensive, un sigle, trois mots et une notion qui pourrait bien révolutionner l’agriculture française dans les décennies à venir. Michel Griffon en est l’un des fondateurs et promoteurs avec une dizaine d’autres chercheurs, qui, à travers le monde, ont planché sur ce concept destiné à réconcilier deux enjeux a priori irrémédiablement opposés : produire de façon intensive mais durable, en atténuant l’impact environnemental. Un modèle agricole d’avenir dont l’agriculture cantalienne n’est pas si éloignée, a convenu ce chercheur infatigable, qui a présidé aux destinées de plusieurs fonds et agences de recherches mais qui reste agronome avant tout.
Comment définir de façon simple ce qu’est l’AEI ?
Michel Griffon : “C’est faire de l’écologie scientifique et pas politique. L’écologie politique ne s’est jamais intéressée à la production. L’écologie scientifique propose elle une utilisation bien plus optimale des systèmes de production parce que, finalement, ces systèmes sont des éco-systèmes à part entière. Il s’agit donc d’utiliser au maximum leurs fonctionnalités naturelles, de les manipuler, de les amplifier et les diversifier pour produire autant, voire plus, à des coûts réduits, notamment en intrants, en minimisant les pollutions.”
Qu’entendez-vous par fonctionnalités naturelles ?
M. G. : “Ce sont les phénomènes écologiques élémentaires, comme la photosynthèse, le parasitisme, la compétition entre les plantes...” Comment l’AEI se démarque-t-elle de l’agriculture durable, raisonnée ou biologique ? M. G. : “Ces formes d’agriculture sont toutes fixées par des cahiers des charges. L’AEI est au contraire un processus global qui part du conventionnel en allant le plus loin possible dans l’amélioration de la productivité écologique, en empruntant un peu à ces différents types d’agriculture qui ont des limites ou n’aborderont qu’un volet.”
L’AEI est-elle déjà développée à travers le monde ?
M. G. : “Oui, de plus en plus dans l’Ouest de la France, en Bretagne, dans les Pays de Loire, en Aquitaine mais aussi au Brésil, un peu en Inde... C’est ce qu’on appelle aussi l’agroécologie, qui découle d’une forte volonté politique d’aller dans ce sens que ce soit de la part du ministre français que de la Pac. En France, le ministre n’a pas gardé “intensif” car c’est encore un mot tabou...”
Concrètement, quels changements l’AEI implique et permet sur les exploitations ?
M. G. : “On peut accroître la photosynthèse, donc la production végétale, par des moyens naturels, en faisant en sorte que les sols restent couverts, par des cultures intermédiaires, des cultures associées... On peut favoriser la dégradation de la biomasse pour améliorer la fertilité du sol. On peut aussi utiliser du charbon de bois sur le sol comme initiateur d’un stock de fertilité et d’eau. Autres processus qu’on peut intensifier : les mycorhizes qui contribuent, en alliance avec d’autres animaux, à l’humification, ou encore les combinaisons prédateur/proie/habitat.
Et en élevage ?
M. G. : “Les fonctionnalités sont un peu moins évidentes mais on peut optimiser l’alimentation des animaux, la production de fourrages. En bovins lait, l’objectif est le retour à l’autonomie protéique, à la valorisation maximale de l’herbe, à l’amélioration scientifique du pâturage par la diversification des espèces et un pâturage optimal en fonction de la pousse de l’herbe et du climat. Dans le domaine de la santé animale, il s’agit bien sûr de réduire l’usage des antibiotiques, d’éviter le forçage des animaux qui conduit à tout un tas de maladies métaboliques, d’améliorer la surveillance du troupeau, d’utiliser l’éco-pathologie pour comprendre la cause des maladies...”
Finalement, l’agriculture du Massif central ne répond-elle pas déjà à cette définition de l’AEI ? M. G. : “Le système bovins allaitant tel qu’il est pratiqué ici, et de manière générale l’élevage de montagne, sont des systèmes qui ont beaucoup de vertus d’un point de vue de l’écologie productive. Vous n’avez pas à faire beaucoup pour être dans l’AEI mais vous avez à faire du subtil et du très intelligent par exemple sur la composition floristique des prairies.” Ce sont pourtant des atouts encore difficiles à valoriser... M. G. : “Il ne faut pas trop compter sur les subventions publiques même s’il faut bien évidemment profiter au mieux de toutes les MAE(1). La seule vraie chance qu’on ait, c’est le marché. Il faut faire la démonstration que l’AEI améliore la qualité des produits et que les consommateurs consentent à la payer. Il ne faut pas s’adresser à l’estomac des consommateurs mais à leur intelligence et à leur plaisir.”
Quel est le pas de temps et le coût pour une transition à l’AEI ?
M. G. : “On estime qu’il faut en moyenne dix ans pour obtenir un système écologiquement intensif et efficace aux niveaux de la production, de l’écologie et de l’environnement. Cela n’exige pas d’effort financier particulier. Certes, au départ, il y a des risques dans la transition, le risque de mal contrôler par exemple l’enherbement ou les ravageurs mais on a toujours la possibilité de revenir périodiquement à des méthodes conventionnelles pour sauver la situation.”
(1) Mesures agro-environnementales.