La biosécurité, une démarche collective à partager
Selon Jean-Pierre Vaillancourt, enseignant-chercheur québécois, une biosécurité efficace repose avant tout sur la communication et sur la régionalisation de la démarche.
Selon Jean-Pierre Vaillancourt, enseignant-chercheur québécois, une biosécurité efficace repose avant tout sur la communication et sur la régionalisation de la démarche.
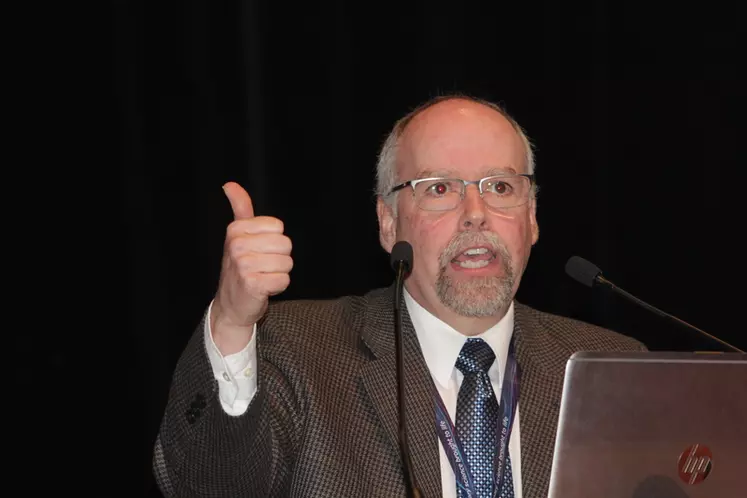
Depuis plusieurs années, les maladies animales liées aux virus, notamment influenza, prennent de plus en plus d’ampleur constate le vétérinaire canadien. « Et ce n’est pas près de s’arrêter. » Faute d’« arme fatale », la gestion des risques sanitaires par la biosécurité devient donc de plus en plus incontournable. Celle-ci s’appréhende dans un ordre précis : évaluer les risques d’entrée du pathogène (la bio exclusion), de sa diffusion interne (la bio gestion) et de sortie de l’élevage (le bio confinement) pour savoir précisément où agir, puis appliquer des mesures à travers un plan qui brise la chaîne d’infection et enfin communiquer.
Les facteurs de risque, sources de contamination d’un élevage, sont connus et reconnus depuis longtemps liste le vétérinaire : aérosols, nuisibles (insectes, rongeurs), faune sauvage, effluents, et surtout humains « qui sont les plus gros nuisibles… », plaisante-t-il. La proximité entre élevages est très importante. Deux sites espacés de quelques centaines de mètres, mais reliables par différents vecteurs, ne forment qu’une seule et même unité épidémiologique.
Il y a tout de même des moyens d’agir contre les virus influenza, « mais le diable est dans les détails », souligne Jean-Pierre Vaillancourt. Un sas sanitaire ou un pédiluve mal conçu ou mal utilisé ou non entretenu peuvent entretenir la contamination (cinq minutes de trempage sont nécessaires dans un pédiluve).
Raisonner un plan à l’échelle régionale
Le succès d’un plan de biosécurité repose en grande partie sur l’observance (1) stricte des mesures. « En élevage, les consignes sont respectées à 60-70 % au maximum, même quand on place de fausses caméras visibles. » Jean-Pierre Vaillancourt cite de nombreuses anecdotes de mauvaise observance, notamment d’éleveurs qui s’estiment eux-mêmes indemnes de pathogènes, contrairement à leurs visiteurs. C’est aussi une affaire de « personnalité » et de sexe (les femmes respectent mieux les règles). Pour augmenter l’observance, une formation adaptée est primordiale. « En 2017, nous sommes encore en train de chercher à convaincre de se laver les mains ou de changer de bottes. Il faut savoir adapter son message, être réaliste dans ses attentes, sans être négatif ou répressif. » Par ailleurs, l’approche individuelle ne suffit plus. Il y a 20 ou 30 ans, des mesures appliquées sur les fermes pouvaient être efficaces. Mais ce temps est révolu.
Pour avoir des chances de fonctionner, la biosécurité doit aussi s’inscrire dans une perspective à l’échelle régionale. Contrôler les pathogènes sur des zones très denses en élevages passe obligatoirement par des échanges d’informations entre les acteurs. « Il y a eu un changement de paradigme. Aujourd’hui il faut se parler, avoir un plan de communication en réseau, de manière à appliquer des mesures efficaces à une échelle régionale. » C’est couramment pratiqué aux USA entre des compagnies pourtant concurrentes. Cela va jusqu’au zonage de production, avec du « tout plein-tout vide » sur une douzaine de sites. Sans copier le système américain, Jean-Pierre Vaillancourt conseille néanmoins aux opérateurs français de microzoner, en partant d’une analyse des déplacements qui permettra d’établir une stratégie de biosécurité qui fonctionne.
(1) En médecine, façon dont un patient suit, ou ne suit pas, les prescriptions médicales et coopère à son traitement.










