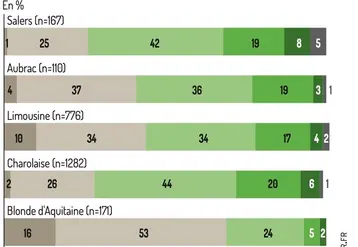Congrès de la FNB 2025 : le début d’une nouvelle ère ?
La Fédération nationale bovine (FNB) a tenu son assemblée générale les 12 et 13 février à La Rochelle, réunissant quelque 300 personnes. Malgré le contexte sanitaire difficile, l’ambiance générale était à la combativité et à l’espoir, sous les effets conjugués de prix porteurs, des filières qui se solidifient et d’un possible infléchissement des politiques européennes anti-élevage.
La Fédération nationale bovine (FNB) a tenu son assemblée générale les 12 et 13 février à La Rochelle, réunissant quelque 300 personnes. Malgré le contexte sanitaire difficile, l’ambiance générale était à la combativité et à l’espoir, sous les effets conjugués de prix porteurs, des filières qui se solidifient et d’un possible infléchissement des politiques européennes anti-élevage.

Bien sûr, il n’est pas question de faire de l’angélisme et de dire que tout va bien dans une filière largement éprouvée, depuis des années, par des crises économiques, sanitaires, sociétales, démographiques… Pourtant, lors de la dernière assemblée générale de la FNB, qui s’est tenue à La Rochelle, les 12 et 13 février, il y avait comme quelques rayons de soleil capables de traverser l’obscurité, et, qui sait, annonciateurs d’éclaircies.
Le premier de ces signes positifs, c’est, bien sûr, la flambée actuelle des prix des broutards : « C’est une révolution », assure Cédric Mandin, secrétaire général de la FNB. « Nous avons un marché qui tire et une offre qui se fait rare. Le broutard a pris un euro du kilo en une année, et peut-être prendrons-nous encore un euro dans les mois qui viennent », ajoute-t-il.
La relocalisation de l’engraissement a un prix
Ce qui est, certes, une bonne nouvelle, mais qui pose néanmoins la question de la pérennité des filières qui sont de plus en plus nombreuses à se constituer sur le territoire : « Nous avons créé des filières, il ne faut pas les perdre, car si nous ne prenons pas d’engagements, tout va partir en maigre », prévient Cédric Mandin. « Développons l’engraissement en France, mais à une seule condition : que cette activité rémunère mieux un éleveur qui vend actuellement ses broutards à l’export », tranche Emmanuel Bernard, président de la section bovine d’Interbev et membre de la FNB.
Car, pour attirer des jeunes dans la production, fournir les installations dont le pays a plus que jamais besoin pour assurer sa souveraineté alimentaire, il faut que les prix rémunérateurs soient durables et sécurisés par des contrats : « Plus jamais, nous ne voulons de tarifs en dessous des coûts de production », souligne Patrick Bénézit, président de la FNB. Censée garantir ce « plus jamais », la loi Egalim est encore insuffisamment appliquée, trop souvent contournée. Toutefois, l’élu estime que, là aussi, il est possible de voir du positif et d’espérer du mieux : « Nous arrivons à faire des accords intéressants. Nous avons réussi à endiguer des pertes de valeurs ». Sur le créneau de la restauration hors foyer, le président estime aussi que « la reconquête est en cours ».
Sur le volet sanitaire, et même si la situation est critique à bien des égards, Patrick Bénézit se satisfait malgré tout que l’impact sur le commerce ait réussi à être limité. Mais c’est sans doute autour de la politique européenne que le changement d’atmosphère était le plus notable lors de ce congrès 2025.
Spécialiste des questions européennes au sein de la FNB et président du groupe Viande bovine du Copa-Cogeca, Dominique Fayel a rappelé combien le mandat européen passé, celui du « pacte vert » du vice-président Frans Timmermans, avait été un « mandatus horribilis ». « Son postulat, c’était : vache égal carbone, viande rouge égal cancer. Il nous l’a martelé à coups de trique. Nous avons ressenti, éleveurs européens, qu’on ne voulait plus de nous ».
Tourner la page Timmermans
« Cela a été un mandat très dur pour les éleveurs », confirme Benoît Cassart, éleveur belge et eurodéputé fraîchement élu, qui s’exprimait en direct depuis Strasbourg le 13 février. Le seul départ de Timmermans constitue un motif d’espoir pour tous les éleveurs européens, une occasion de changer le cap actuel de l’Europe, qui était « à contresens des autres continents », selon Dominique Fayel. « La décapitalisation souhaitée par Bruxelles est allée trop loin, ils semblent enfin s’en rendre compte ! ».
Benoît Cassart a confirmé que l’obsession de diminuer la production de viande bovine semblait s’être calmée au sein de l’Europe, en espérant que cela se traduise concrètement dans la prochaine PAC. « Il ne faut pas confondre décarbonation et délocalisation. Si nous délocalisons notre production bovine pour diminuer nos émissions de carbone, nous perdons sur tous les plans : économique, environnemental et social. Davantage de durabilité, ça ne signifie pas moins d’éleveurs ».
Autre signe positif selon l’eurodéputé : la mise en place, au parlement, d’un intergroupe sur l’élevage durable, qui aura pour tâche de définir une stratégie pour l’élevage européen. Dans un contexte international bouleversé, les questions d’autonomie stratégique de l’Europe deviennent de plus en plus cruciales. « L’autonomie stratégique commence par l’alimentation », poursuit-il.
Dernier signal positif en provenance de l’Europe : sur l’accord avec le Mercosur, le combat continue. Agricultrice française et députée européenne, Céline Imart, qui était elle aussi en direct de Strasbourg, estime que le Parlement pourrait ne pas ratifier l’accord qui lui sera présenté au vote en fin d’année. Selon elles, les lobbys anti-viande sont toujours actifs, mais de plus en plus de députés, comme elles ou Benoît Cassart, semblent « prêts à se battre » pour convaincre leurs collègues de ne pas ratifier l’accord sur le Mercosur.

« Sortir du tunnel du carbone »
« Durant le congrès, dans notre groupe de travail « Valoriser les enjeux sociétaux de élevage », nous avons eu des échanges très intéressants avec Fréderik Jobert, du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Il nous a incités à mettre en avant nos atouts écologiques, nos « externalités positives » que sont nos vaches, nos prairies, pour la biodiversité, en sortant du « tunnel du carbone ».
Sur notre élevage bovin allaitant, il reconnaît que le levier carbone n’est pas celui devant être mis en avant : les arguments que nous portons depuis des années pour sortir des attaques anti-élevage infusent enfin. Frédérik Jobert veut travailler avec nous sur la notion d’élevage durable. Il nous demande de définir, entre nous, cinq critères qui le définissent. Et il est prêt à nous suivre, à apposer la Marianne et le drapeau sur les produits qui répondront à nos critères.
Le SGPE, qui est placé sous l’autorité du Premier ministre, et le ministère de la Transition écologique, serait d’accord sur ce principe d’une définition simple du « bœuf durable ». Et cette définition serait ensuite transmise à l’Ademe, au PNNS (programme national nutrition et santé). Nous allons tenir ce pari. Ce n’est, certes, pas ce qui va rapporter directement de la valeur à la filière, mais c’est ce qui va nous permettre d’éviter le pire. »
Prendre le pouls des régions
L’expression des régions illustre à la fois tous les points communs et toute la diversité des éleveurs de bovins allaitants sur le territoire national.
Traditionnel rendez-vous d’une assemblée générale, l’expression des régions est un exercice difficile, car limité à trois minutes par section, au cours desquelles il s’agit de faire remonter le ressenti du terrain, sans tomber dans un cahier de doléances.
Sans surprise, la plupart des sections ont mis en avant leur inquiétude face aux périls sanitaires, MHE, FCO 3 et 8, tuberculose, mais aussi les autres sérotypes de FCO et la fièvre aphteuse, « qui sont à nos portes ». Pour certaines sections, ce sont des menaces et préoccupations grandissantes, quand pour d’autres, c’est déjà « la misère, le désarroi » (Grand Est, Nord, Nouvelle Aquitaine…). Non seulement, les indemnisations ne sont pas suffisantes, mais surtout, les veaux vont manquer : « Il nous faudra trois ou quatre ans avant de retrouver la normalité ».
Du côté des inquiétudes partagées par tous figure aussi le renouvellement incertain des générations, avec notamment la question du financement des reprises à capitaux élevés et les règles de la future PAC qui se dessinent encore trop environnementales : certaines régions de plaine se sentent « sacrifiées ».
En revanche, il est d’autres points communs plus positifs : presque toutes les sections ont présenté des démarches de qualité, d’envergures diverses, comme la démarche nationale « Éleveur & Engagé », les Label rouge mais aussi des marques très locales. Tous les représentants de sections témoignent de l’excellent accueil que reçoivent ces démarches, de la part notamment des responsables politiques locaux et des acteurs de la restauration hors foyer, qu’elle soit collective ou commerciale (avec l’engagement de Metro par exemple). « Tous ces acteurs sont prêts à payer plus cher pour de la viande locale et pour maintenir l’élevage ».
Parmi toutes les démarches, on pourra noter celle du département accueillant, la Charente-Maritime, « Plus de 17 dans nos assiettes », qui a été lancée en 2020 par le département et la chambre d’agriculture. Elle rassemble plus de 130 producteurs issus du département et la viande bovine en est un pilier.