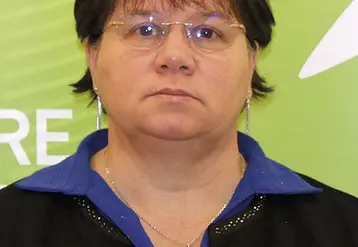1, 2, 3, stockez !
Les sécheresses à répétition de ces dernières années et les prévisions climatiques rappellent douloureusement l’importance de l’eau. Le stockage hivernal de l’eau pour un usage estival est une voie d’adaptation à explorer. Longtemps mis en avant par le monde agricole, le stockage de l’eau a dernièrement fait l’objet d’annonces favorables du Premier Ministre. Des aides de la Région ont été récemment mises en place et des aides du Département sont actuellement en réflexion.

La France n’est pas un pays sec : d’après les chiffres du Ministère de l’écologie sur les 180 milliards de m3 de pluie efficace qui tombent annuellement sur la France, seuls 3 milliards de m3 sont prélevés pour l’agriculture. Il parait donc logique de stocker de l’eau en hiver pour pouvoir en disposer l’été. Madame la Préfète de l’Allier a récemment organisé une rencontre des différents acteurs sur ce thème. Elle a souligné la volonté de l’État de faire aboutir des projets dans le département de l’Allier et rappelé la mobilisation de ses services. Malgré un cadre réglementaire contraignant, des solutions peuvent généralement être trouvées.
Stocker de l’eau : pour quoi faire ?
Lors de la réflexion autour de la création d’une retenue d’eau, il faut s’interroger sur l’objectif du projet. L’autonomie fourragère ou la sécurisation des rendements céréaliers sont généralement les premiers objectifs visés. D’autres opportunités doivent également être étudiées : introduction de nouvelles cultures, allongement des rotations, embauche d’un salarié… La création d’une retenue collective avec un ou plusieurs voisins peut également être envisagée pour réduire les coûts.
Pour les irrigants déjà installés sur des secteurs faisant régulièrement l’objet de restrictions d’irrigation, l’objectif peut également être d’abandonner le prélèvement existant pour sécuriser l’accès à l’eau. On parle alors de retenue de substitution.
Cerner ses besoins
Il est primordial de cerner les besoins en eau de son projet. En moyenne, il faut compter un minimum de 1 500 m3/ha pour irriguer du maïs ensilage. Bien évidemment, les besoins varient selon les situations. En année sèche, ils étalent de 1 200 m3/ha en sols profonds à plus de 2 000 m3/ha en sols très légers. Pour du maïs grain, il faudra augmenter les besoins de 500 m3/ha.
Une rapide comparaison entre le volume stockable et les besoins en eau de son projet permet de vérifier sa pertinence.
Choisir un site compatible avec la réglementation
Lors du choix du site, il conviendra autant que possible d’éviter les zones humides et les cours d’eau. L’implantation d’une retenue d’eau sur une zone humide et/ou sur un cours d’eau n’est pas systématiquement interdite par la réglementation, en revanche les procédures d’autorisation sont nettement plus lourdes et bien plus coûteuses. De plus, l’obtention de l’autorisation finale n’est pas garantie.
Demander un avis préalable à la DDT
Concrètement, si un exploitant dispose d’un site qu’il juge adapté à un projet de création de retenue d’eau, le premier réflexe est de demander un avis préalable aux services de la DDT. Il est fortement conseillé de contacter la Chambre d’agriculture qui vous aidera à renseigner le document. Cette demande d’avis déclenche généralement une visite sur site de la DDT et/ou de l’AFB (ex-ONEMA). La présence de cours d’eau ou de zone humide sera recherchée. À l’issue de cette première démarche, les services de la DDT vous renseigneront sur la faisabilité juridique du projet et le type de procédure à suivre.
Évaluer et faire évaluer la viabilité économique
La création d’une retenue d’eau est un chantier important qui doit être confié à un professionnel. Son coût est très variable et dépend du volume de terre à bouger, mais aussi des spécificités techniques. Pour une retenue classique il faut compter entre 3 et 5 € du m3 stocké. Mais la facture peut grimper en fonction des caractéristiques de la retenue. À titre d’illustration, si l’étanchéité nécessite la pose d’une géomembrane, le chantier augmentera de 10 à 12 € du m2 de bâche posée.
Le coût du chantier est à mettre en relation avec les bienfaits escomptés pour évaluer la viabilité économique. Attention, le calcul n’est pas simple puisqu’il nécessite de prendre en compte l’ensemble des investissements (de la retenue au matériel d’irrigation) mais également de nombreux autres paramètres : changement d’assolement, évolution des rendements, changement de stratégie d’alimentation du troupeau… Il est indispensable de se faire accompagner. Les services de la Chambre d’agriculture peuvent vous accompagner dans votre projet.
Et si on utilisait les retenues existantes ?
Le département de l’Allier dispose d’environ 7 000 plans d’eau. La plupart d’entre eux sont anciens et n’ont aujourd’hui plus d’usage. Le pompage direct dans un plan d’eau existant est une solution pour démarrer l’irrigation avec des investissements mesurés. Il existe alors deux cas de figure :
si le plan d’eau n’est pas alimenté par un cours d’eau, la procédure est rapide et très simple. Si le plan d’eau est alimenté par un cours d’eau, il faudra envisager de dériver le cours d’eau. Dans tous les cas, un contact préalable avec la Chambre d’agriculture ou la DDT est indispensable pour étudier son mode d’alimentation et son statut.
Attention toutefois à ne pas surévaluer le volume disponible. Sur les plans d’eau anciens, la profondeur exploitable n’est généralement pas supérieure à 1 mètre.