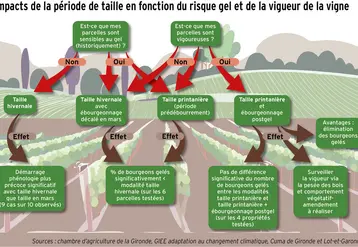Le débat entre marque et IG est relancé
La création de valeur dans la filière passera-t-elle par
le développement de marques, notamment à l’international ou faut-il continuer à miser sur les indications géographiques (IG), voire sur la seule origine France ?
Le débat revient sur le devant de la scène.

« Faire rejaillir le débat entre marque et IG aurait semblé très banal, il y a quinze ans. A cette époque, on pariait sur la fin des IG, incapables d’innover, incapables de faire du marketing et l’on prenait une grande leçon de libéralisme de la part des pays du Nouveau Monde. Et une grande baffe au passage : il fallait se lancer dans les marques. Depuis, le contexte a complètement changé et le modèle IG s’en est trouvé conforté. Même si on peut avoir de grand doute sur le modèle du tout IG dans lequel la France s’est engouffré. Avoir plus de 85 % de sa production en IG est sans doute excessif », indique Hervé Hannin, directeur de l’IHEV (Institut des hautes études de la vigne et du vin) qui s’exprimait lors du colloque organisé par l’Observatoire viticole de l’Hérault : « Marques, indications géographiques : vers un nouvel ordre mondial ? », le 5 décembre dernier. Excessif ? Certainement, pour Jean-Marie Barillère, président du CNIV (Comité national des interprofessions viticoles). « Si l’on observe comment est structurée la production française, avec 54 % en AOP, 36 % en IGP et 10 % autres, on ne peut que constater que l’on est assis sur une pyramide à l’envers et l’on peut donc s’interroger sur sa stabilité. »
Pour Jean-Marie Barillère qui tenait ses propos à l’occasion des deuxièmes assises des vins du Sud-Ouest, le 10 décembre, il faut distinguer la vente de vin en France en circuit court et le fait de vendre à l’export. « Ce sont deux métiers différents qui demandent des structurations d’entreprise différentes et qui nécessitent d’adopter des discours distincts sur le vin. À Toulouse, on parle des AOP du sud-ouest. A Paris, cela commence à devenir difficile de localiser ces AOP et aux Etats-Unis ou en Chine, on ne parle plus que de l’origine France, de Bordeaux et de Champagne. Plus le business s’internationalise et plus la France devient une origine. Je pense d’ailleurs que d’ici 25 ans, le marché international aura fait le ménage. Il y aura les vins de France avec des marques et des vins issus de trois ou quatre régions à forte notoriété. Et c’est tout. »
L’exemple chilien : « Notre marque, c’est le Chili »
Dans cette mouvance, on peut citer l’exemple chilien. « Notre marque, c’est le Chili », indique Alvaro Arriaga, de Wines of Chile, la structure de promotion des vins de ce pays. Même si ce dernier s’est récemment doté de dénominations mais qui sont plutôt destinées aux journalistes et aux acheteurs et non pas aux consommateurs. En Grande-Bretagne, selon une étude réalisée par Olivier Dauvers, du magazine Rayon Boissons, l’IG serait de moins en moins une clé d’entrée pour le consommateur. « Elle n’est plus qu’une variable d’ajustement. Pour la trouver, il faut aller la rechercher soit sur la contre étiquette, soit tout en bas de l’étiquette où elle est écrite en tout petit. La clé d’entrée est désormais le prix, les vins étant souvent rangés selon qu’ils coûtent plus ou moins de huit livres. »
« L’IG : une indication de provenance, pas de valeur »
Par contre, aux Etats-Unis, on assiste à un mouvement inverse : deux bouteilles sur trois revendiquent une origine dans ce pays où historiquement, la clé d’entrée était le cépage, souligne encore Olivier Dauvers. « En tout cas, le coup de force qu’ont réussi les Chiliens à s’identifier par leurs vins tranche avec notre vision française de vouloir donner à tous les producteurs une appellation considérée comme un ascenseur à valeur ajoutée. Même si celle-ci ne porte pas pour autant, de façon automatique, la notion de valeur. Ni la marque d’ailleurs », estime Hervé Hannin.
Et Jean-Marie Barillère de s’interroger justement sur la création de valeur par les IG. « L’essentiel des vins de Bordeaux est vendu au prix d’un vin IGP ou d’un vin de France. Vu du consommateur, il appartient donc à la même catégorie. Dans un tel contexte, nous ne sommes pas sûrs de gagner. » Et de citer le rapport de Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence économique intitulé « Développer une influence normative internationale stratégique pour la France », à propos des AOP et pour lequel il s’agit d’un système en fin de compte pénalisant. Hors Champagne, pour tous les produits, il entraîne des coûts supplémentaires, entretenant une activité normative importante sans créer de la valeur. Un rapport qui a été peu diffusé, souligne Jean-Marie Barillère. « Quand 90 % de la production a une IG, cela a-t-il encore une valeur ? Une IG à moins de trois euros, est-ce encore une IG ? L’IG est en fait juste une indication de provenance mais pas de valeur. »
Et Jean-Marie Barillère de s’interroger encore sur le fait que 70 % des IG sont vendues en grande distribution. « Nous appartiennent-elles encore ? »
Pour Pierre Mora, professeur de marketing à Kedge Business School, quand cinq entreprises de la grande distribution concentrent l’essentiel du chiffre d’affaires de la filière, elles ne sont plus que des loueurs d’étagères. « D’autant plus que la GD a ses beaux jours derrière elle, que c’est un modèle en difficulté, que le rayon vin n’est pas le plus rentable, elle se pose simplement la question de la place. » Son rêve serait ainsi d’avoir un linéaire composé de quatre grandes marques nationales, locomotives du marché, le reste étant réservé au maquis touffu des IG au lieu des 900 références actuellement présentes et à faible rotation.
Il existe déjà des relations fortes entre IG et marque, note Hervé Hannin. « Il y a aujourd’hui, la volonté de rechercher comment donner un sens à cette relation. Mais sans oublier que les grandes vertus des IG sont qu’elles sont indélocalisables et inaliénables. Avec les marques, qu’en est-il ? Une marque pourrait détourner la valeur d’une IG tant celle-ci est un empêcheur de développement par son sourcing limité. Pour que l’une et l’autre créent de la valeur, il leur faut un marketing approprié. Et de ce point de vue, c’est une révolution marketing que propose Cahors. »
« Les vins de Gaillac sont inexportables »
Néanmoins, pour Michel Defrancès, président de l’IVSO (Interprofession des vins du sud-ouest), « les vins de Gaillac sont inexportables ». Non pas parce que leurs vins seraient de piètre qualité. « Mais parce que quand on parle d’export, il faut une masse critique c’est-à-dire le niveau de production qui donne une confiance et une assurance au client de pouvoir s’approvisionner. Les petites AOP individuellement ne peuvent atteindre cette masse critique. Par contre, collectivement, nous pouvons l’atteindre avec la marque sud-ouest France, en déclinant sous cette ombrelle toutes les AOP. Il ne s’agit pas d’une marque à l’état pur mais bien d’un collectif à laquelle il s’identifie. La marque, seule, ne pourra pas résister. Elle doit être associée à une origine. JP Chenet ou Castel sont plus forts quand leur marque est attachée à l’origine. Il ne s’agit pas d’opposer les deux. Il nous faut les deux. »
Voir plus loin : les vins de grandes zones
« Au milieu de cette pléthore de vins à IG, il y a ce qu’on pourrait appeler un signal faible à savoir la création de vins de grande zone, ce que l’on appelle en termes prospectifs, des vins de biotope », souligne Hervé Hannin. Il s’agit par exemple, des vins de montagne que l’on trouve désormais en Argentine. « Nous avons fait des études pour trouver les meilleurs sols. Ce doit être pour nous, un élément différenciant pour une meilleure valorisation des vins », explique Leo Borsai, œnologue consultant argentin.
En France aussi commencent à apparaître ces vins de biotope avec l’exemple des vins de schistes dans l’Hérault.
La stratégie cadurcienne
Tandis que de grandes appellations comme la Bourgogne résistent encore à afficher la mention du cépage, Cahors a choisi pour stratégie marketing de mettre en avant le malbec, de communiquer dessus pour créer de la valeur. Pour Hervé Hannin, il s’agit, ni plus, ni moins, que d’une révolution marketing, alliant cépage et IG avec la volonté de l’étendre au niveau international, grâce à cette vibration, venue d’Argentine. « Car sans le travail de promotion du cépage malbec qu’ont mené les Argentins, nous n’aurions pu engager ce travail », reconnaît Jérémy Arnaud, directeur de l’UIVC (Union interprofessionnelle des vins de Cahors). « Nous proposons ainsi une offre complémentaire à celle de l’Argentine. C’est l’association d’une IG à un cépage qui fait office de marque. » Cette vision de l’AOP, selon Hervé Hannin, est loin des archétypes et du musée dans lequel certains voudraient les enfermer. « Le vin de Cahors ne ressemble pas à ce qu’il était hier et à ce qu’il sera demain. »