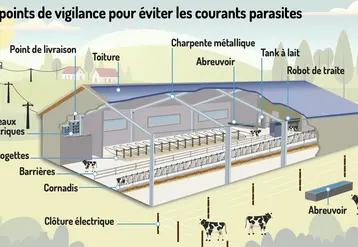FENAISON
FENAISON - FENAISON - L’andaineur soleil refait son apparition
Disparu des campagnes
depuis de nombreuses
années, l’andaineur soleil
séduit à nouveau par
sa simplicité, son débit
de chantier et son coût.

le réglage de la largeur de travail et réduit la longueur de l’andaineur
lorsqu’il est déplié. Sur ce modèle, les deux petits soleils fixés à l’avant
de la poutre centrale permettent de travailler la zone de l’andain.
[Mis à jour le 19 novembre 2021]
Sous l’impulsion du constructeur historique Tonutti, l’andaineur soleil fait son retour sur le marché français depuis quelques campagnes. Un second constructeur italien, Enorossi, l’a rejoint récemment sur le marché français.
Abandonné depuis de nombreuses années au profit des andaineurs à rotor, le soleil intéresse à nouveau certains utilisateurs à la recherche de débit de chantier, qui ne souhaitent pas investir dans des andaineurs à double rotor, plus coûteux et plus complexes techniquement.
« L’andaineur soleil n’avait disparu que dans certains pays d’Europe de l’Ouest. Il est resté très répandu en Amérique du Nord, dans l’Est de l’Europe ainsi qu’en Italie et en Espagne, notamment pour la récolte de la luzerne », assure Pierre Guillaume, responsable commercial Tonutti pour la France.
Le constructeur italien a toutefois développé une gamme « Pro », spécifique aux marchés d’Europe de l’Ouest, afin de s’adapter à leurs contraintes: topographie accidentée, puissances élevées, diversité des produits à andainer, exigences de réglage…
Des soleils adaptés à la diversité des fourrages
« Sur ces appareils, la qualité et l’épaisseur des matériaux sont revues à la hausse, la liaison tracteur-outil est repensée avec un attelage semi-porté sur les bras de relevage, la précision et la facilité de réglage sont améliorées. »
Concernant la polyvalence qui faisait défaut aux anciens soleils, le constructeur l’a améliorée en travaillant sur des soleils spécifiques. « Ces soleils disposent de dents avec un angle différent et d’une flasque centrale. Ils sont très efficaces pour andainer de la paille enfouie dans les chaumes. Nous nous sommes aperçus par la suite qu’ils étaient également adaptés au regroupage des andains d’herbe d’une faucheuse-conditionneuse. Nous réussissons même à andainer des matières lourdes et volumineuses comme les cannes de maïs, le chanvre ou encore le miscanthus », argumente Pierre Guillaume.
Le réglage de la pression au sol détermine la qualité de travail
Mais pour arriver à ce résultat, le réglage de la pression au sol des soleils est déterminant. « Il faut que les dents travaillent de manière libre. Car si elles sont trop plaquées au sol, la matière est tirée ce qui provoque l’enroulement de l’andain et les pierres sont ratissées. » Précaution confirmée par Pierre Lépée, conseiller à la chambre d’agriculture de la Creuse : « L’outil étant auto-animé, si la pression au sol n’est pas ajustée précisément, les soleils auront tendance à travailler par arrachement. »
Les utilisateurs insistent sur l’aspect décisif de ce réglage. Jean-Michel Bloino, éleveur à Noyal-Muzillac (Morbihan) vient de renouveler son andaineur Tonutti. « Il faut prendre le temps d’ajuster la pression au sol pour un travail de qualité. Je ramasse mon foin à l’autochargeuse sans aucun souci : il n’y a pas de pierres. Toutefois, pour éviter de trop enrouler le fourrage, je ne travaille pas à pleine largeur, 7 mètres au lieu de 8,50 mètres. »
Une fois la technique maîtrisée, c’est la vitesse de travail qui fait la différence. Dans des conditions optimales, elle peut atteindre les 25 km/h, mais la moyenne se situe plutôt entre 8 et 15 km/h. « Le suivi du sol est facilité par une suspension individuelle de chaque soleil avec un débattement de 25 cm et par un châssis articulé à grand débattement », précise Pierre Guillaume.
Autre intérêt de cet outil autoanimé, la qualité de travail est indépendante du régime moteur du tracteur. Il est ainsi possible de travailler à bas régime et avec un tracteur de taille modeste (70- 80 chevaux pour un 8,50 m) pour limiter la consommation de gazole. Etant donné le débit élevé, le chantier s’avère très sobre.
Hormis la contrainte du réglage de la pression au sol, les utilisateurs apprécient la simplicité d’utilisation de l’andaineur soleil. La largeur de travail est réglable hydrauliquement en continu pour s’adapter à la configuration de la parcelle et au volume de fourrage. Quant à la largeur de l’andain, elle s’ajuste indépendamment de la largeur de travail.
Moins cher à l’achat mais aussi à la revente
Dernier argument et pas des moindres, à largeur de travail égale (mais avec un débit de chantier supérieur), « le prix d’un andaineur soleil est 15 à 20 % inférieur à celui d’un andaineur double rotor et près de 50 % à celui d’un quadruple rotor, estime Pierre Guillaume. Les acheteurs sont également rassurés par la simplicité d’entretien. » En revanche, les concessionnaires notent un sérieux manque d’image de ce type de matériel sur le marché de l’occasion, qui se solde par une décote rapide.
Deux autres alternatives aux rotors
Si l’andaineur soleil est apprécié pour préserver la qualité du fourrage délicat comme la luzerne, il n’atteint pas le niveau de l’andaineur à tapis. Très utilisé aux États-Unis et de manière intensive (le spécialiste Oxbo propose un automoteur d’andainage), ce dernier est également apprécié des entrepreneurs et des grosses exploitations en Allemagne, au Danemark, en Tchéquie, etc, d’après Jean-Marie Christ, chef produits fenaison chez Kuhn. Avec le spécialiste italien Roc, le constructeur alsacien est le seul à fournir ce type de matériel en Europe.
« L’andaineur à tapis sert principalement à la récolte de luzerne, de paille et d’ensilage d’herbe. Sa conception combinant un pick-up et des tapis groupeurs préserve la qualité et la propreté de la matière. L’absence de terre et de cailloux est notamment très importante pour l’ensilage destiné aux unités de méthanisation. »
Avec des vitesses de travail de 15 à 20 km/h, l’andaineur à tapis s’illustre également par son débit de chantier. Il montre toutefois ses limites dans des fourrages trop denses et volumineux. En France, la taille des structures ne permet pas de rentabiliser ce type de matériel qui embarque un important équipement hydraulique et une gestion électronique évoluée. Seul Roc est présent dans les zones de luzerne déshydratée. L’investissement est en effet conséquent, Kuhn affiche son Merge-Maxx 900 de 9,10 mètres à environ 100 000 euros.
Le râteau faneur à entraînement hydraulique
Inspiré, comme le soleil, de l’andaineur de nos grands pères, le V-Twin (750 ou 600) du constructeur finlandais Elho reprend le principe de fonctionnement des anciens râteaux faneurs. Il se compose de deux éléments montés sur un châssis traîné pour le modèle 750 de 7,50 mètres et porté (arrière ou frontal) pour le 600 de 6 mètres, qui rassemblent le fourrage sur un andain central. Les dents montées sur insert caoutchouc soulèvent le fourrage, ce qui préserve sa qualité tout en limitant la présence de pierres et de terre dans l’andain.
« Cet andaineur me semble moins agressif que le soleil car il n’a pas besoin de pression au sol pour être animé », estime Pierre Lépée. L’entraînement des râteaux est hydraulique, la puissance nécessaire étant de seulement 55 ch et le débit hydraulique de 25 l/min. La largeur de travail du modèle traîné s’ajuste hydrauliquement de 4,50 à 7,50 mètres. Son prix débute aux alentours de 25 000 euros. Quant au modèle porté, il s’affiche à moins de 20 000 euros.