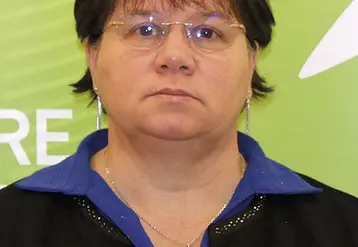Québec : le pays où il fait bon vivre pour les éleveurs laitiers
Deux jeunes futurs agriculteurs, l’un Québécois, l’autre Cantalien, livrent leur vision de l’agriculture du pays de l’autre où chacun a fait son stage.

Trente-cinq degrés à l’ombre dans ce coin du Veinazès, soit 60 de plus que les minima courants en hiver à Tingwick,une commune de la province d’Arthabaska au centre du Québec, dont est originaire Andy Roberge. “Il y a quatre ans, on est descendu à- 42 °C”, précise ce fils de producteur laitier qui a choisi de réaliser un stage de plusieurs semaines en France, dans le Cantal, sur l’exploitation du Gaec Monier-Arnal. Un point microscopique sur Google Maps dont le jeune Québécois a eu connaissance par des éleveurs voisins qui avaient accueilli voilà quelques années, Gilles Arnal, aujourd’hui salarié du Gaec de Lacapelle-del-Fraïsse. L’occasion d’un regard croisé sur l’agriculture de ces deux régions transatlantiques distantes de près de 5 500 km.
Qu’est-ce qui vous a marqué en arrivant ici le 12 mai ?
Andy Roberge : “Le relief ! Chez nous c’est vallonné, mais ici ça l’est vraiment ! Et puis les routes, très étroites, en serpentins... Au Québec nous avons l’influence des Anglais, les chemins sont tracés au carré.”
Et vous Gilles qu’est ce qui vous a frappé au Québec ?
Gilles Arnal, 26 ans, salarié du Gaec Monier-Arnal : “Quand je suis descendu de l’avion à Montréal le 15 août 2008, paradoxalement à la fois la chaleur et la moiteur ! Et puis c’est vrai, les villes sont construites avec des rues en quadrillages. Montréal c’est un peu New-York en petit, hormis le centre ancien.”
Et sur le volet agricole ?
A. R. : “L’importance du pâturage ici. Chez nous, on fait pâturer les vaches la nuit seulement, sachant que nos animaux sont à l’attache. Actuellement,le gouvernement est en train de légiférer pour imposer des aires d’exercices extérieures l’été. Et puis il y a aussi la “régie” des animaux : ici les vêlages ont lieu à 24 mois en moyenne, nous c’est un peu plus bas encore. Ce que j’ai aussi découvert, c’est l’irrigation. Chez nous ce n’est pas aussi sec, on n’en a pas besoin. Nous travaillons aussi des sols limoneux alors qu’ici c’est du sablo-limoneux avec pas mal de cailloux.”
G. A. : “J’ai été frappé par le prix du lait (voir plus loin, NDLR), la main d’oeuvre dont ils disposent et le rythme de travail : dans l’élevage où j’étais, qui comptait six personnes, tout le monde était debout à 4 h 30 et dans l’étable à 5 heures. Comme les animaux sont à l’attache, le temps passé aux soins des animaux est beaucoup plus long surtout qu’il faut rentrer les animaux tous les matins. Le travail est aussi beaucoup plus méticuleux. L’étable était nettoyée régulièrement, la queue des 60 vaches lavée tous les matins, les animaux tondus tous les deux mois. Comme l’élevage où j’étais vendait de la génétique et accueillait pas mal de visites, tout était nickel en permanence.”
A. R. : “Sans aller jusque-là, c’est vrai que nous sommes attentifs à la propreté et qu’on passe régulièrement un coup de balai.”
Quel est le visage d’une ferme type dans votre région ?
A. R. : “Notre exploitation compte une quarantaine de laitières en lactation. C’est un peu moins que la plupart des fermes du coin. Nous exploitons 400 acres (162 ha) dont 300 de cultures (le reste est boisé) dans une région d’élevage, principalement laitier.”
Quelle est l’alimentation du troupeau ?
A. R. : “Du foin sec, du concentré à base de maïs grain concassé et des minéraux. Sachant que chez nous, le prix des matières premières commele soja, le colza, est moins élevé, mais on trouve ça cher quand même.”
Comment gérez-vous le froid hivernal pour le troupeau ?
A. R. : “Nos bâtiments sont fortement isolés du froid et nous stockons le fourrage dans la partie haute de l’étable. En hiver, les vaches en fin de lactation peuvent quand même rentrer et sortir, malgré le froid.”
Comment sont fixés vos quotas de production ?
A. R. : “L’exploitation de mon père bénéficie d’un quota journalier de 1 200 litres (43 kg/jour) qu’il a acheté en même temps que les terres, la maison et le matériel dans les années 70. Nous sommes dans un système de régulation de l’offre en fonction du marché national. Il existe une bourse des quotas. S’il y a des quotas disponibles, on peut en acheter, mais le gouvernement a plafonné leur montant à 25 000 dollars canadiens (CAD) le kilo journalier (soit 17 700 €/kg journalier par vache).”
Et le prix du lait ?
A. R. : “Nous sommes payés au kilo de matière grasse produite, à la matière protéique avec un système également de primes. Présentement, le prix du lait est autour de 76 cts CAD/kg (soit plus de 530 €/tonne, NDLR). Étant dans une production sous gestion de l’offre nous n’avons pas d’aides du gouvernement. Notre lait est transformé par Lactancia (NDLR, détenu par Parmalat) en beurre, lait de consommation, glaces, yogourts, fromages.”
Quel est votre regard sur les manifestations actuelles des producteurs français ?
A. R. : “Les manifestations, les grèves, ce n’est pas vraiment dans nos mentalités. Ce qui est vrai, c’est qu’en France vous avez davantage de contraintes comme le passeport bovins, les plans d’épandage, l’équarrissage obligatoire... chez nous, c’est les coyotes qui s’en occupent...”
Un prix du lait élevé, des charges contenues, le Québec fait figure d’eldorado pour vos collègues français...
A. R. : “Oui, sauf qu’on commence à avoir peur de perdre nos quotas en raison de l’accord de libre échange en discussion avec l’Union européenne. Ce qu’on craint, c’est le doublement du quota sur les fromages de l’UE exportés vers le Canada... et donc une concurrence déloyale avec des producteurs européens qui bénéficient d’aides. Pour notre part, nous n’avons pas fait le choix d’aller à l’export car nous ne sommes pas compétitifs. C’est pourquoi on défend notre marché intérieur.”
Quel est le statut des agriculteurs dans la société québécoise ?
A. R. : “La fédération des producteurs de lait du Québec fait de plus en plus de communication, de portes ouvertes pour redorer l’image de ce métier pas très réjouissante et pour avoir de la relève sur les exploitations. Depuis cinq-six ans, ça repart à la hausse mais il faut rester prudent.”
G. A. : “Les agriculteurs sont beaucoup mieux perçus qu’en France. Ici quand tu dis que tu es au lycée agricole, tu es tout de suite catalogué, avec pas mal d’a priori.”