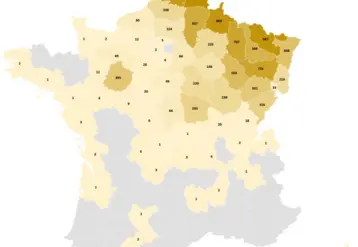Revenu : « Nous dégageons plus de 4 Smic par UMO avec du pâturage toute l’année en système laitier bio dans le Finistère »
Au Gaec Le Corre, dans le Finistère, l’objectif est simple : optimiser la production laitière avec ce qu’offre le territoire, c’est-à-dire surtout de l’herbe. Les vaches croisées, en système bio, pâturent quasiment toute l’année. L’excellente maîtrise des charges et la bonne valorisation du lait assurent la rentabilité.
Au Gaec Le Corre, dans le Finistère, l’objectif est simple : optimiser la production laitière avec ce qu’offre le territoire, c’est-à-dire surtout de l’herbe. Les vaches croisées, en système bio, pâturent quasiment toute l’année. L’excellente maîtrise des charges et la bonne valorisation du lait assurent la rentabilité.


À Brasparts, dans les monts d’Arrée, l’herbe pousse en abondance toute l’année. « Il pleut, il ne fait jamais ni très chaud, ni très froid et les zones vallonnées se prêtent bien au pâturage » soulignent Christian et Bernard Le Corre, associés du Gaec Le Corre. Depuis toujours, l’élevage y est donc très herbager. Mais l’exploitation de l’herbe est passée à une échelle supérieure en 2019, à l’installation de Christian avec son père Bernard, et sa mère Lydie, salariée du Gaec.
« Le parcellaire était très morcelé, avec des routes, des rivières, ce qui ne facilitait pas le pâturage, explique Christian. Nous avons pu reprendre les bâtiments et le foncier d’un voisin qui partait en retraite. Nos parcelles étaient très imbriquées. En louant ces terres, nous avons pu regrouper le parcellaire et augmenter la surface accessible aux vaches, ce qui nous a permis de passer en bio. Notre objectif aujourd’hui est d’être le plus économe et autonome possible. »
Du pâturage toute l’année même l’hiver
Le Gaec compte désormais 125 vaches et 140 hectares, dont 13 hectares de maïs, le reste en herbe. « Le maïs fournit de l’énergie, un problème en bio, précise Christian. Malgré l’apport de 50 à 60 unités d’azote par hectare en fumier et 40 tonnes par an de fientes de volailles, nous ne récoltons toutefois que 9 tonnes par hectare. » L’essentiel des terres est constitué de prairies permanentes et de prairies temporaires de ray-grass anglais-trèfle blanc.

Pour faciliter le pâturage, le Gaec a créé 3 km de chemins, un pont et créé des paddocks de 1,3 hectare. Chaque paddock a de l’eau et une entrée et une sortie différenciées pour éviter le piétinement. « Les vaches pâturent un paddock par jour. Elles ont toujours de l’herbe fraîche et cela facilite le travail. »
Fiche élevage
2 associés et 1 salarié
125 vaches croisées holstein x rouge norvégienne x normande
570 000 l de lait
4 600 l par vache
140 ha, dont 13 ha de maïs, 4,5 ha de luzerne, le reste en prairies temporaires et permanentes
Les prairies pâturées reçoivent 20 m³/ha de lisier, soit 20 à 25 unités d’azote (UN). Du 1er avril à mi-novembre, les vaches pâturent jour et nuit, sans complément jusqu’à début septembre, puis avec un peu de maïs. Du 15 novembre au 1er avril, elles sont en bâtiment la nuit, mais sortent en général la journée pour pâturer. « Même l’hiver, il y a de l’herbe, souligne Christian. Et nous avons la chance d’avoir des parcelles de fond de vallée, intéressantes l’été, et des parcelles en pente, plus séchantes, mais plus portantes l’hiver. En deux à trois heures, les vaches peuvent manger 3 à 4 kilos d’herbe, ce qui fait quelques kilos de lait. Nous veillons toutefois à ne pas compromettre l’herbe de printemps. Les vaches ne sortent pas pendant environ un mois. »
Pas d’achat de concentré
L’hiver, la ration se compose de 3 à 4 kg MS d’herbe pâturée, 4 kg MS de maïs ensilage, 10 kg MS d’enrubannage d’herbe ou de luzerne et de minéral. L’essentiel de l’herbe stockée est enrubannée. « Avec l’enrubannage, plus riche en énergie et protéines que le foin, nous n’avons pas besoin d’acheter de concentré, analysent les éleveurs. Du fait de la météo, il est aussi plus facile à Brasparts de faire de l’enrubannage que du foin. Et comme nous avons notre matériel de récolte, nous faisons quatre à cinq coupes par an, au meilleur stade, ce qui fournit un enrubannage de qualité. » Les prairies fauchées reçoivent 50-60 UN/ha en fumier. Environ 1 000 balles d’enrubannage sont récoltées chaque année.

Avec ce système, le Gaec parvient à produire 4 600 litres de lait par vache sans achat de concentré, mis à part du minéral et un peu d’aliment pour les veaux. Le coût alimentaire des vaches est ainsi très bas, de 5 €/1 000 l l’été à 70 €/1 000 l l’hiver, soit en moyenne 25 €/1 000 l. « Le concentré bio coûte très cher, souligne Christian. Nous préférons produire moins de lait, mais être plus économe. Nous allons d’ailleurs remplacer le concentré des veaux, qui coûte 750 à 800 euros par tonne, par du maïs grain bio acheté à un voisin à 330 euros par tonne. » La forte part d’herbe dans la SAU permet aussi au Gaec de bénéficier de la MAE autonomie fourragère qui lui apporte 24 000 euros par an.
Croisement trois voies pour la reproduction et les taux
Le troupeau repose sur le croisement trois voies holstein x rouge norvégienne x normande. « L’objectif de ce croisement, pratiqué par mon père depuis 2013, est d’abord d’éviter les tares liées à la consanguinité en holstein en croisant avec des races fonctionnelles, pour faciliter les vêlages et améliorer la fertilité, indique Christian. La holstein apporte du lait, la rouge de la fertilité et de la santé et la normande du gabarit et des taux. » De 40 % de réussite en première IA en 2013, le troupeau est passé à 66 % de réussite aujourd’hui. « Et il n’y a plus de fièvre de lait ni de non-délivrance, juste un ou deux vêlages difficiles par an, et beaucoup moins de boiteries. »

Les vaches s’avèrent aussi très adaptées au pâturage et vieillissent mieux. Et le croisement produit de très bons taux : 45 de TB et 32,5 de TP en 2023. « Notre laiterie, Eurial, valorise très bien les taux, notamment la matière grasse, précisent les éleveurs. Le point de TB est payé 5 euros et le point de TP est payé 7 euros. » Le Gaec ayant par ailleurs peu de cellules et pas de butyriques, la valorisation du lait atteint 529 €/1 000 l en 2023. En 2024, les éleveurs ont toutefois commencé à inséminer avec de la montbéliarde à la place de la normande. « Le schéma Procross, que mes parents avaient découvert au Royaume-Uni, repose sur le croisement entre holstein, viking red et montbéliarde, précise Christian. Au départ, mon père était réticent à la montbéliarde et a voulu tester la normande qui, comme la montbéliarde, apporte du gabarit et des taux. Mais la normande est proche de la holstein, il y a moins d’effet d’hétérosis. C’est pourquoi, nous la remplaçons désormais par la montbéliarde. »
Regrouper les vêlages pour mieux valoriser l’herbe
En 2024, le Gaec a aussi choisi de regrouper les vêlages. « Les vêlages sont actuellement étalés sur l’année, explique Christian. Les génisses ont des détecteurs de chaleur. Mais comme elles sont toujours dehors, cela nous obligeait à aller chaque jour au pré et, si une génisse était en chaleur, à ramener tout le troupeau pour une insémination. Nous avons décidé d’assurer leur reproduction au pré avec un taureau hereford, qui est calme et fait de petits veaux. Et nous avons choisi de regrouper les vêlages en deux lots, au printemps et à l’automne, ce qui simplifiera le travail. »
Les veaux seront vendus en contrat à Bigard qui a créé une filière d’engraissement à l’herbe de veaux croisés Angus ou hereford. Cette évolution permettra aussi de grouper les vêlages des vaches sur un mois au printemps et un mois à l’automne, permettant une meilleure valorisation de l’herbe.
Un autre objectif est de rationaliser le renouvellement, pour en limiter le coût en élevant moins de génisses et limiter la charge de travail. « Les génisses de renouvellement naissent uniquement des multipares, ce qui est plutôt intéressant car nous connaissons les qualités de nos vaches, précise Christian. Nous n’allons garder que 15 à 20 génisses de renouvellement au printemps et 15 à 20 à l’automne. Les autres vaches seront inséminés en blanc bleu belge pour une meilleure valorisation des veaux. »
Un passage récent à la monotraite
Autre évolution depuis septembre 2024 : le passage en monotraite. « Nous y sommes passés suite à l’arrêt pour raison de santé de ma mère, explique Christian. Mais nous y pensions déjà pour faire face au départ en retraite en 2026 de mes parents, qui seront remplacés par ma conjointe. Les calculs montrent que la monotraite va entraîner une baisse du chiffre d’affaires annuel de 35 000 à 40 000 euros, ce qui représente le coût d’un salarié. Nous avons choisi de rester à deux et de garder la monotraite qui limite le temps d’astreinte et donne plus de souplesse pour les travaux des champs, les réunions. »
Les premiers mois, la production a diminué de 25 %. « Il y avait beaucoup de vaches en fin de lactation, qui se sont taries rapidement, analyse l’éleveur. À terme, la baisse devrait être de 15 à 20 %. Mais le TB est passé de 45 à 50 et le TP de 32 à 37,5. Vu la bonne valorisation des taux, cela conforte le passage en monotraite. Nous pourrons éventuellement avoir quatre ou cinq vaches de plus pour compenser la baisse de production. Nous sommes en période de transition et nous allons devoir trouver un nouvel équilibre. »
Priorité aussi aux conditions de travail
Une priorité pour le Gaec Le Corre est d’avoir un revenu correct, mais aussi de bonnes conditions de travail et du temps libre pour la famille, les formations…
« Notre objectif est de finir le travail vers 18 h et de prendre une semaine de vacances l’hiver, deux semaines l’été et un week-end sur deux », indique Christian Le Corre.
À l’installation de Christian, le Gaec a investi 250 000 € pour l’achat et l’aménagement du bâtiment en logettes paillées avec racleurs, la création d’une salle de traite, d’une nurserie, d’une fumière, d’un silo à maïs et la couverture de la fosse et de la fumière. L’hiver, le travail d’alimentation et le paillage nécessitent 30 à 45 minutes. « Mais près de la moitié du temps, les vaches sont dehors et nous n’apportons rien. » Le semis, le binage et la récolte du maïs sont faits par entreprise. Le Gaec a installé une salle de traite 2x16 postes simple équipement avec sortie rapide. « Pendant que 16 vaches sont branchées, je peux en faire entrer 16 autres. Avec les nettoyages, je trais 105 vaches en 1 h 15 ou 1 h 30 en monotraite. »

La nurserie très fonctionnelle, exposée au sud et bien ventilée, est constituée de 9 cases individuelles et 3 cases de 10 places séparées les unes des autres par un mur ou un couloir. « Nous voulions pouvoir curer et désinfecter les cases, pour éviter les problèmes sur les veaux, sans déranger les autres cases. » Comme l’exige le cahier des charges bio, chaque case s’ouvre sur une aire d’exercice stabilisée à laquelle les génisses accèdent dès 15 jours. « Lorsque les veaux ont entre 1 et 2 mois selon la saison, nous élargissons l’aire d’exercice pour qu’ils aient accès à l’herbe et s’habituent au pâturage et à la clôture. »
Avis d’expert : Isabelle Pailler, chambre d’agriculture de Bretagne
« Un système simple et économe »

« Le Gaec Le Corre a mis en place un système économe très efficace. Un point fort est d’avoir regroupé le parcellaire et de l’avoir aménagé pour développer le pâturage. Le troupeau croisé valorise bien la ration uniquement à base de fourrage. La marge brute de 544 €/1 000 l, supérieure au prix du lait, montre que les charges sont bien maîtrisées. La production par vache est aussi plus élevée que la moyenne du groupe. Et le Gaec bénéficie d’un meilleur prix du lait grâce aux taux, notamment au TB qui est bien valorisé par le collecteur et permet une plus-value de 35 €/1 000 l. Un autre atout est la MAE autonomie fourragère, cumulable avec le crédit d’impôt bio. Au final, le Gaec dégage 4,2 Smic/UTH, pour faire face aux prélèvements privés et à l’autofinancement. L’outil permet aussi de travailler dans de bonnes conditions et de maîtriser le temps de travail. La rentabilité horaire atteint 28 €/h, alors que la moyenne du groupe est de 23 €/h. »