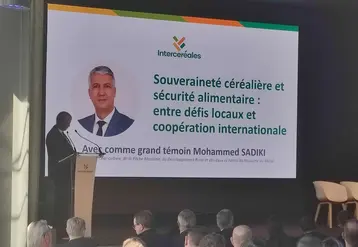Syncopac : baisse contenue de la production d’aliments composés
La perte de tonnage a été moins marquée en 2004 que ces deux dernières années et les cours des matières premières sont revenus à des niveaux «plus favorables aux éleveurs».
«APRÈS LA SITUATION de crise qu’ont connue la plupart des productions animales ces dernières années, le monde de l’élevage auquel nous appartenons est morose et déboussolé. Naturellement notre activité en subit les effets !» résumait le président du Syncopac, Daniel Rabiller, lors de l’assemblée générale de la fédération des producteurs d’aliments du bétail coopératifs qui s’est tenue le 13 avril à Paris. Cédant 1,3% sur un an, la production française d’aliments composés s’établit en retrait pour la troisième année consécutive. Cette tendance frappe l’ensemble de l’UE et la France reste leader européen sur ce secteur. La baisse globale enregistrée en 2004 dans l’Hexagone résulte d’une diminution de 150.000 t des aliments bovins et de 140.000 t de ceux pour porcs. Au-delà des volumes fabriqués, la composition même des aliments a évolué ces dernières années, un aspect mis en avant au cours de ce rendez-vous annuel.
La production d’aliments composés a chuté de plus d’1 Mt depuis 2001
A 22,32 Mt, la production nationale d’aliments pour animaux en 2004 est inférieure de 288.000 t à celle de 2003. Cela porte à 1,2 Mt la perte d’activité totale depuis le sommet de 2001. Une note positive néanmoins : la baisse s’avère moins conséquente que ce qu’auraient pu craindre les professionnels. De plus, la tendance au repli semble s’essouffler par rapport aux deux années précédentes. Cependant «l’activité des premiers mois de 2005 n’est guère porteuse», tempère Daniel Rabiller.
A 4,31 Mt, les aliments bovins enregistrent un retrait de 3,3% sur 2003 où ils avaient bondi de 5,3% sur l’année. L’impact de la sécheresse est estimé à près de 400.000 t d’aliments composés supplémentaires sur l’ensemble de la campagne 2003/2004 (+250.000 t sur le 2nd semestre 2003 et 150.000 t sur le 1er de 2004). En faisant abstraction de cette hausse conjoncturelle, la production d’aliments bovins 2004 s’établirait à 4,2 Mt, soit un niveau proche de celui de 2002. Les tonnages porcs se replient, eux, de 2,1% pour s’établir à 6,7 Mt. Cette filière a concédé 350.000 t sur trois ans. Les autres familles d’aliments affichent une relative stabilité. C’est notamment le cas en volailles qui représentent le plus gros poste avec 9,24 Mt fabriquées. Après avoir frôlé les 10 Mt, ce secteur a été amputé de près de 500.000 t sur 2002 et 2003. «Cette érosion des volumes nous inquiète car elle est en corrélation avec celle des productions animales», confie le président du Syncopac.
Par ailleurs, les volumes fabriqués par les entreprises coopératives ont reculé de 0,8% quand celles du secteur commercial chutent de 1,9%. Les coopératives sont en effet souvent impliquées dans la commercialisation des produits animaux de leurs sociétaires et pérennisent ainsi leurs débouchés.
Détente des matières premières
La surenchère des matières premières a atteint 50% entre juin 2003 et avril 2004. Le marché des céréales s’est enflammé sous l’effet de la sécheresse et, dans le même temps, les tourteaux de soja se sont envolés. Les cours se sont détendus au 2nd semestre 2004 et l’IPAA, qui s’est maintenu à un niveau proche de 120 de novembre 2003 à avril 2004, a concédé 30% en quelques mois. «Cela a permis de récupérer des prix plus favorables pour les éleveurs».
L’enquête triennale du ministère de l’Agriculture atteste de l’évolution du profil des matières premières incorporées en alimentation animale depuis 2000. L’interdiction des farines animales s’est soldée par un recours accru aux acides aminés et aux tourteaux de soja. Leur utilisation a progressé de 600.000 t en volumes (+18%) et de 2,8 pts en taux d’incorporation (17,4% en 2003). Les 160.000 t d’huiles et graisses animales ont été en partie remplacées par 80.000 t d’huiles végétales, de palme notamment. La mise en place de l’Agenda 2000, provoquant un recul des prix des céréales, a également changé la donne. Leur utilisation a encore progressé. De 45% en 2000, elle se situe à 50% en 2003 (30% en 1991). Enfin, le moindre soutien aux cultures de pois a conduit à une chute de la production et donc de la consommation par les Fab qui est passée de 1,25 Mt à 500.000 t en trois ans. Au niveau des cours des matières premières, l’IPAA a baissé de 13% sur dix ans, avec une chute de 27% du prix du blé et une augmentation de 11% en soja. Un constat illustrant la situation de dépendance de l’Europe en matière d’approvisionnement en protéines végétales.
Des évolutions réglementaires
Sur le plan législatif, 2004 a été marquée par la mise en œuvre du règlement européen sur la traçabilité, applicable depuis le 1er janvier 2005, et la mise en place, pour 2006, de celui sur l’hygiène des aliments pour animaux. Plusieurs démarches professionnelles ont incité les adhérents à s’y préparer : application de la norme Iso 9000, mise en place de cahiers des charges matières premières, démarche Reseda avec l’Ania et application du guide de bonnes pratiques de la fabrication des aliments composés, incluant les aspects relatifs au transport. «Ces démarches doivent être confortées et c’est pourquoi nous demandons le soutien des pouvoirs publics pour la reconnaissance officielle de notre Guide comme référentiel unique pour l’audit des cahiers des charges concernant les produits sous signe officiel de qualité» afin d’en limiter le nombre et le surcoût qu’elle représente pour les entreprises.