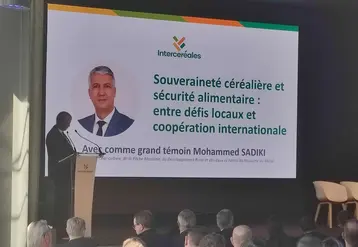Gnis : quel système de rémunération pour les semences de blé certifiées ?
Le modèle français de rétribution des semenciers est solide, mais loin d’être universel, ont noté les participants à la journée filière du Gnis, le 4 avril à Paris.
Avec les professionnels de la filière, le Gnis s’est demandé si la baisse d’utilisation des semences de céréales certifiées remettait en cause son modèle. Christophe Dequidt, économiste, distingue six modes de perception des royalties sur les semences. Il existe des pays où une redevance serait envisageable, mais sa collecte impossible, comme la Chine, l’Inde ou l’Iran. La traçabilité est inexistante, la qualité des grains inconnue. Pour l’heure, l’État indien fixe le prix de la semence, et le pays évolue vers un système d’instituts privés. En Chine, a lieu une vente occulte des variétés.
Modèles anglo-saxons
Aux États-Unis et en Amérique latine, des royalties par brevets se pratiquent. Les obtenteurs vendent à des “dealers”, intermédiaires qui multiplient et demandent la certification. L’utilisation de ces semences varie d’un État à l’autre, avec 58 % de céréales certifiées en Oregon, contre 20 % au Texas. Le principal multiplicateur de Pioneer au Kansas s’inscrit, pour sa part, dans un système différent de paiement de droits à l’usage. La traçabilité répond aux exigences du client.
En Australie et au Canada existe un 3e modèle. L’obtenteur distribue gratuitement les semences, et les royalties sont proportionnelles à la collecte. Cependant, les semences de ferme ne sont pas prises en compte. Les Australiens consomment 10 % de semences certifiées. La fin des Canadian et Australian Wheat Boards a concentré les collecteurs et abouti à la privatisation de la recherche.
En Finlande, les agriculteurs financent équitablement la recherche, selon leurs surfaces déclarées et leur stratégie culturale. Les semences à la ferme sont facturées.
Le Royaume-Uni affiche 58 % d’usage de semences certifiées. Les trieurs à façon font 80 % de la collecte, les 20 % restants sont déclarés en direct. Cela rapporte 10 à 15 €/ha. Un dixième des surfaces y échappe.
Le 6e modèle est français, avec la contribution volontaire obligatoire. Ce mécanisme de financement de la recherche serait menacé par ce qui se fait à l’Est de l’Europe, où le système de royalties n’existe pas. « Arrêtons d’être les naïfs du village », a réagi Jérémy Decercle, président des Jeunes agriculteurs.