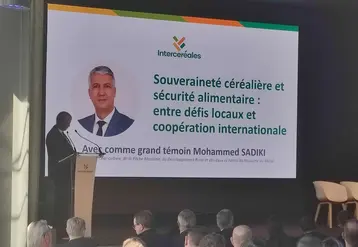Fnams : un cinquantenaire sous le signe de l’inquiétude et de l’espoir
Le ministre de l’Agriculture a entendu les préoccupations de la Fédération, mais les multiplicateurs de semences attendent des décisions.
C’EST A LA MAISON de la chimie à Paris que la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (Fnams) a fêté son cinquantenaire réunissant près de 400 personnes venues de la France et de l’étranger, le 14 avril dernier. Ce fut l’occasion pour les agriculteurs multiplicateurs de semences de faire une rétrospective de ces cinquante années passées et de rappeler au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales, Dominique Bussereau, leurs inquiétudes liées à la nouvelle Politique agricole commune (Pac), et leurs souhaits concernant la loi d’orientation et la recherche variétale et technique.
Le cinquantenaire de la Fnams
L’histoire de la Fnams a été rappelée par Jean-Pierre Monod, vice-président de la Fnams. Il a salué le travail des chercheurs, agronomes, agriculteurs sélectionneurs et agents du ministère de l’Agriculture qui ont su négocier ce qui constitue aujourd’hui le socle de l’interprofession de la semence et le cadre de l’exercice du métier d’agriculteur multiplicateur.
Henri de Benoist, président d’honneur de l’Association générale des producteurs de blé (AGPB), a rappelé que «la commission Semences et Progrès techniques de l’AGPB a donné naissance en 1955 à la Fnams, organisme technique et syndical car Jacques Benoist, premier président de la Fédération, considérait que les agriculteurs avaient besoin d’être représentés». Depuis ces années, la vie de la Fnams et de l’AGPB technique devenue ITCF, puis Arvalis, sont étroitement liées.
Jean-Pierre Monod a également précisé la nécessité, à l’époque, de structurer rapidement la Fnams en sections spécialisées, pour encadrer les diverses productions semencières dans une convention type définissant l’agréage des lots de semences et fixant le mode de rémunération des productions.
Jacques Alétru, ancien ingénieur, a quant à lui rappelé les grandes étapes de la vie des équipes techniques de la Fnams, peu nombreuses et sans matériel au début, et constituant aujourd’hui un service technique spécialisé sur la multiplication des semences, unique au monde.
Enfin, Henri Nallet, conseiller d’Etat et ancien ministre de l’Agriculture, a exprimé avec conviction sa foi dans l’avenir de l’agriculture française.
Sa réussite dépendra néanmoins de l’aptitude de l’Union européenne à définir un véritable projet agricole et à le soutenir, et de la capacité de notre société à encourager la diffusion du progrès en agriculture. A ce titre, le secteur Semences détient l’une des clefs de l’avenir agricole en France.
Éviter les distorsions de concurrence et valoriser l’organisation de filière
Robert Pellerin, président de la Fnams, a profité de la présence du ministre de l’Agriculture, pour lui faire part des préoccupations actuelles de la Fédération.
Concernant la nouvelle Pac, il a rappelé que le secteur Semences a été le grand oublié de cette réforme et que celle-ci risque d’amener des distorsions de concurrence entre agriculteurs et entre pays de l’Union européenne si aucun aménagement n’est réalisé.
Robert Pellerin a ainsi cité le cas des semences potagères et de betteraves qui ne se voient pas attribuer de Droits à paiement unique (DPU), mais aussi celui des semences fourragères qui ne peuvent pas appliquer un découplage partiel, comme les grandes cultures. Les semences fourragères seront aussi pénalisées dès la récolte 2005 par une potentielle baisse des aides, due à un dépassement de l’enveloppe française attribuée aux semences.
Au sujet de la loi d’orientation agricole, la Fnams souhaite être associée aux dispositions qui la compléteront. Reste que le pouvoir des interprofessions doit être renforcé en matière d’organisation et de contractualisation. Cette loi doit également permettre aux interprofessions de progresser dans le domaine de la protection et des assurances.
Enfin, le président de la Fnams a insisté sur l’importance stratégique de la multiplication. La poursuite des investissements dans la recherche variétale et les études techniques doit être encouragée. En matière de semences, la France est deuxième producteur et troisième exportateur mondial. Le maintien des performances du secteur de la multiplication de semences, et par conséquent de l’agriculture française dans son ensemble, dépendra de la capacité des pouvoirs publics à préserver cette recherche.
Le ministre de l’Agriculture adapte la mise en œuvre de la Pac
Dans sa réponse, Dominique Bussereau a précisé le calendrier de mise en œuvre de la Pac. Dans les toutes prochaines semaines, les règles de gestion des Droits à paiement unique (DPU) seront arrêtées en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et en relation continue avec la Commission européenne. A cause des délais techniques, les exploitants recevront les notices et les références historiques au début de l'été. Ils pourront actualiser leur référence auprès de leur DDAF à partir du mois de juillet. Pour le cas des semences non aidées, «je veillerai bien entendu à maintenir un traitement équitable entre les producteurs de semences qui n’auraient pas accès aux aides directes, compte tenu des références historiques et les autres producteurs», a déclaré le ministre de l’Agriculture. Une réflexion est également menée sur l’écart de compétitivité possible entre les producteurs de semences fourragères et les cultures de céréales et oléoprotéagineux. Propos auxquels les multiplicateurs sont très sensibles, mais qui doivent encore être traduits par des décisions concrètes.
Le ministre de l’Agriculture a de nouveau réaffirmé son souhait de simplifier les dispositions réglementaires et les contrôles relatifs à la mise en œuvre de la conditionnalité des aides. Il a notamment relevé les paradoxes qu’il pouvait y avoir entre l’interdiction d’application de produits phytosanitaires sur les bandes enherbées et la nécessité de maîtriser les sources de pollinisation étrangères dans les périmètres d’isolement de certaines parcelles de semences. Il a exprimé le souhait que des solutions puissent être négociées. «La loi d’orientation agricole place au cœur de ses priorités les missions de l’interprofession dont elle promeut le renforcement», a poursuivi le ministre d’Agriculture. Il souhaite ainsi «élargir le socle des actions possibles et finançables par voie de cotisations volontaires rendues obligatoires», notamment en matière d’aléas climatiques. Le ministre d’Agriculture a terminé son intervention en exprimant le souhait que son ministère soutienne avec force «les actions collectives de recherche privée et publique». Il en a profité pour annoncer que 10 à 20 projets de contrats de branche sont prévus pour 2005-2007. En matière d’OGM, le ministre de l’Agriculture est convaincu que la France ne doit pas déserter l’espace expérimental, en particulier dans le domaine de l’agronomie : «J’ai souhaité lancer la procédure d’autorisation des expérimentations d’OGM pour l’année 2005.»
Le dynamisme de la filière semence a une fois de plus été souligné. En 2004, 340.000 ha étaient consacrés à la production de semences en France, soit 22.120 agriculteurs répartis sur tout le territoire. Le chiffre d’affaires au stade multiplication est estimé à 423 M# (moyenne 2001-2003). La France est troisième exportateur mondial, soit 30 % de la valeur de la production de semences.