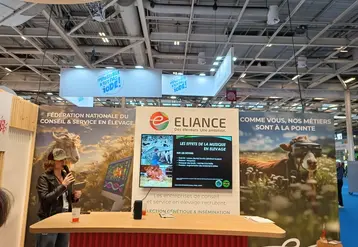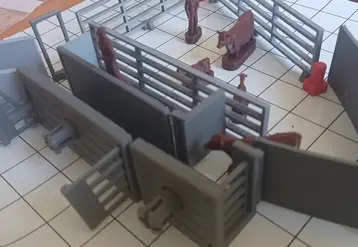« Nous devons assurer la rémunération des éleveurs du naissage à la finition », selon Maryvonne Lagaronne, de l’Idele
Maryvonne Lagaronne, présidente du comité de filière bovins viande à l’Institut de l’élevage (Idele) et éleveuse de bovins allaitants, revient sur les conditions nécessaires pour pérenniser l’engraissement en France.
Maryvonne Lagaronne, présidente du comité de filière bovins viande à l’Institut de l’élevage (Idele) et éleveuse de bovins allaitants, revient sur les conditions nécessaires pour pérenniser l’engraissement en France.

Pensez-vous que le rebond de l’engraissement français observé ces deux dernières années va se pérenniser ?
C’est ce que l’on souhaite. La France doit se fixer pour objectif de valoriser au maximum la production issue de son cheptel. Cet objectif ne peut être atteint en se cantonnant au naissage ; il faudrait, dans l’idéal, que les veaux nés en France aillent au maximum de leur expression de valeur ajoutée : jusqu’à la finition. Dans la réalité, ce sont les marchés qui décident de ce que l’on produit, selon une logique de rentabilité. Le résultat est un effet « dents de scie », qui se voit bien ces dernières années : l’an dernier avec la MHE, les ateliers français se sont remplis de veaux parce qu’il y avait des broutards disponibles, à des tarifs plutôt bas, en raison des blocages du commerce à l’export liés au contexte sanitaire. Cette année, le prix du broutard est remonté, impliquant moins de mises en place. Si aucune contractualisation n’a été engagée pour sécuriser l’approvisionnement de la filière. Si l’on veut pérenniser notre production, le naisseur ne peut pas continuer d’être la variable d’ajustement. Nous devons trouver la stratégie qui permette d’intégrer dans l’approche du marché les coûts de production et la rémunération des éleveurs, du naissage à la finition, plutôt que de raisonner uniquement à l’échelle d’un atelier.
Le naisseur ne peut pas continuer d’être la variable d’ajustement.
Sur quels piliers peut se construire cette stratégie permettant de dégager des marges pour l’ensemble de la chaîne ?
En premier lieu, il faut miser sur une contractualisation qui intègre la méthode Egalim, et un engagement des distributeurs à maintenir ces accords. C’est essentiel pour sécuriser la rémunération des éleveurs et faire que nos jeunes s’orientent vers la production de viande bovine.
Ensuite, nous avons besoin de sortir du paradigme actuel où les coûts de production sont soumis à une inflation permanente. Cela passe en partie par l’amélioration de l’efficience technique, sur laquelle portent les travaux de l’Institut de l’élevage (Idele). Mais la maîtrise des coûts de production ne peut reposer uniquement sur les épaules de la profession. Si la France souhaite conserver son autonomie alimentaire, elle devra s’en donner les moyens et mettre en place les orientations politiques nécessaires.
Quelles approches existent pour améliorer l’efficience technique de la production ?
Au niveau de l’Idele, nous travaillons sur des techniques de finition les plus efficientes possibles, et surtout basées sur notre capacité d’autonomie alimentaire française, protéique notamment. Des itinéraires techniques s’appuyant sur les intercultures, les méteils, qui valorisent les ressources fourragères et entre autres de légumineuses fourragères, peuvent être une partie de la solution. Les études doivent intégrer un volet économique pour offrir de réelles perspectives de rentabilité. Nous voulons que ces approches, qui se développent un peu partout dans les territoires français, soient accessibles au plus grand nombre. Pour cela, les prescriptions techniques doivent être reproductibles, transposables sur la majorité des fermes, et durables dans le temps. Elles doivent s’appuyer sur la recherche d’autonomie fourragère des systèmes herbagers afin d’éviter la concurrence avec l’alimentation humaine, sans aller jusqu’au dogme de la finition à l’herbe, qui n’est pas durable au vu des aléas climatiques de plus en plus fréquents.
Vous évoquez la nécessité de s’appuyer sur une stratégie politique nationale. Quels outils pourraient soutenir la rentabilité de la production de viande bovine ?
Limiter les charges liées aux bâtiments ou à l’énergie, par exemple en défiscalisant l’énergie nécessaire à la production bovine, est un levier fort pour améliorer les marges des exploitations. Nous avons également besoin de sécuriser l’accès aux matières premières agricoles dans les zones où la concurrence du secteur énergétique est importante, pour l’accès aux coproduits par exemple. Si la stratégie de la France est clairement portée sur la finition, les décideurs feront ce qu’il faut pour poser des limites, comme ils l’ont déjà fait sur l’usage du sol sur les méthaniseurs. Nous devons être capables d’appuyer et de porter politiquement ces propositions.