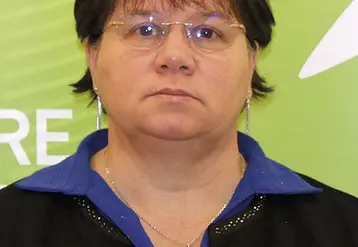Ministre de l'Agriculture
Marc Fesneau : « Nous avons construit un PSN équilibré »
Dans un entretien accordé à Agra Presse, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau explique ses récents arbitrages
sur la déclinaison nationale de la future Pac et livre sa feuille de route.
Dans un entretien accordé à Agra Presse, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau explique ses récents arbitrages
sur la déclinaison nationale de la future Pac et livre sa feuille de route.

Quel est votre bilan, après quelques semaines d’exercice ? Êtes-vous le ministre de la réconciliation avec les ONG qui étaient en froid avec Julien Denormandie ?
Le ministère de l’Agriculture est à la fois un ministère du temps long, mais aussi de la gestion de crise à laquelle il faut faire face aux côtés des agriculteurs. Dès mon arrivée, je suis allé aux côtés des agriculteurs touchés par la sécheresse et la grêle, pour répondre aux urgences de ceux qui ont eu des récoltes touchées, et fixer en parallèle des perspectives de long terme. À la question de savoir si je suis le ministre de la réconciliation, je ne sais pas, mais je ne pense pas que nous opérions les grandes transitions dont nous avons besoin pour notre agriculture, avec les objectifs de souveraineté, sans se mettre tous autour de table, y compris avec les ONG avec qui il peut y avoir débat et c’est normal. Cela nécessite que l’on pose le cadre de référence : où on est et où on veut aller. C’est de la planification. Or, ce que j’ai posé comme cadre à la fois aux organisations agricoles et aux ONG, c’est que nous arrivions à nous mettre d’accord sur le cadre de référence et l’objectif auquel nous voulons aboutir et le chemin que nous voulons emprunter. On a parfois trop entendu du déclaratif et déclamatif, on a besoin de rentrer concrètement dans un certain nombre de sujets. Cela passe par un dialogue en responsabilité avec un seul objectif : pouvoir avancer. C’est la méthode que j’ai toujours utilisée. Je me souviens avoir monté un projet Natura 2000 dans la communauté de communes dont j’étais président, j’avais réuni autour de la table agriculteurs, associations environnementalistes et chasseurs et nous avons réussi à avancer.
Votre premier grand dossier a été la déclinaison française de la Pac, le PSN, dont vous avez dévoilé la seconde version, le 1er juillet. Quelle a été votre ligne ? Que répondez-vous à la FNSEA qui vous accuse de ne pas avoir su résister à Bruxelles ?
Le sujet n’est pas celui-là. Le premier PSN a été envoyé en décembre avec une architecture que je partage totalement, qui vise à avoir un ensemble le plus inclusif possible et cela n’est pas remis en question. Son architecture et ses grands équilibres n’ont pas été remis en cause. Deuxièmement, ce n’est pas une négociation franco-française, c’est une discussion avec la Commission, qui a fait des remarques auxquelles nous sommes tenus de répondre. Sur bien des sujets, nous avons trouvé des points d’atterrissage qui correspondaient à la vision française de la Pac. Il en reste un en finalisation sur la BCAE 7, sur la rotation des cultures, parce qu’il y a un sujet d’applicabilité qui n’est pas valable qu’en France. C’est un sujet sur lequel la Commission est particulièrement exigeante et qui pose des problèmes en particulier pour les cultures de maïs. Nous sommes en train de trouver un chemin.
Sur la HVE (Haute valeur environnementale, NDLR), certains ne le trouvaient pas assez exigeante. Nous avions anticipé ce point. Conformément aux engagements pris dès mai 2021, nous avons fait un travail de reformatage pour monter en termes d’exigences, avec notamment la suppression de la voie B. Il y a eu un comité récemment pour valider le nouveau cahier des charges qui va être mis en débat pendant deux mois de consultation publique. Ces changements, nous les avons construits pas contre mais avec les professionnels.
Vous arrivez en pleine période d’aléas climatiques, et en pleine réforme de l’assurance, qui doit être arbitrée d’ici fin-juillet, pour une entrée en vigueur en 2023. Où en sont les arbitrages ? Quelle est votre ligne ?
L’objectif est une mise en œuvre au 1er janvier 2023 d’un texte qui a été publié en mars 2022. C’est un engagement fort pour nos agriculteurs qui sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique. J’ai conscience que c’est un temps très court, mais je suis confiant pour que nous tenions les délais. Nous ne pouvons pas nous retrouver avec une année de plus sans avoir modifié profondément le système assurantiel et les calamités, des systèmes qui sont à bout de souffle. Nous sommes dans un certain nombre d’impasses liées à la multiplication des aléas climatiques (grêle, gel, sécheresse…). Il y a trop peu d’assurés et un système de calamités agricoles qui ne répond plus aux problèmes. C’est la base de cette réforme pour construire un système dans lequel l’État mette plus de moyens pour faire en sorte que la couverture assurantielle soit meilleure, en particulier pour les secteurs les plus mal couverts.
Nous allons réunir la conférence des filières pour définir les taux de couverture filière par filière. Nous devons nous mettre d’accord sur ce qui est financé par l’État, par les assureurs et la part que peuvent prendre en charge les agriculteurs, dans le cadre budgétaire qui a été fixé dans la loi, c’est-à-dire jusqu’à 600 millions d’euros par an, soit deux fois plus à terme, que le système actuel, en mobilisant la solidarité nationale.
Comme les contrats d’assurance se signent en général au mois d’août, on a besoin d’un cahier des charges qui permette aux assureurs de proposer rapidement des contrats d’assurance pour la saison à venir.
Une ordonnance doit être publiée en septembre. Et en amont, j’insiste sur la nécessité de mettre en œuvre tous les outils de prévention et d’adaptation au changement climatique, notamment face au gel et à la grêle, en faisant appel à la technologie et à de nouvelles pratiques. Tout ce que l’on peut faire doit être développé, et il faut aider à le financer. C’est ce que l’on a fait dans le cadre du plan de relance avec plus de 200 millions d’euros, mais nous travaillerons aussi avec les Régions pour renforcer la résilience des exploitations.
Un chèque alimentaire a été annoncé pour la fin d’année. Comment voyez-vous la sélection des produits et la distribution ? Et avec quel budget ?
Le chèque alimentaire a une vocation sociale : permettre aux personnes qui ne peuvent accéder à une alimentation durable et de qualité de précisément pouvoir y accéder sans pour autant faire baisser les prix au détriment des agriculteurs. D’ailleurs, dans l’idéal, il faudrait que, d’une part, l’État mette une certaine somme, car c’est un dispositif public, et que la grande distribution prenne aussi sa part. Ce n’est pas arbitré, mais cela me semble cohérent. La question sera débattue durant l’examen de la loi de finances cet automne. Il nous reste, par ailleurs, à définir le champ des produits éligibles à ce chèque alimentaire – produits frais, sous Siqo (signes d’identification de la qualité et de l’origine), bio, fruits et légumes, circuits courts. Nous allons rentrer dans un débat intéressant. Il faudra en parler avec tous : agriculteurs, banques alimentaires, distributeurs, consommateurs… Et chercher un compromis.
Emmanuel Macron avait promis une loi d’orientation agricole pour l’installation. Qu’en attendez-vous ? Avec qui la construirez-vous à l’Assemblée ?
Rappelons que cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu de grande loi touchant la formation, l’installation et la cession, depuis la loi Rocard de 1984. Le sujet, c’est que 60 % des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite dans les dix ans, ce qui pose un sujet de remplacement et de renouvellement des générations, mais aussi de souveraineté.
Nous aurons aussi à répondre aux questions des transitions agroécologique, énergétique, sociétale qui sont indispensables. Ouvrons tous les sujets qui touchent à l’installation : la formation, la transmission, l’innovation, le foncier, les conditions économiques, la résilience des exploitations face au changement climatique. Avec tous les opérateurs, nous allons regarder l’ensemble des problèmes qui se posent et décliner une boîte à outils.
La consultation devrait débuter à la rentrée, pour un horizon à l’été 2023. Ce texte mérite de prendre le temps, mais je ne doute pas, au regard des enjeux et des attentes sociétales fortes, que nous trouvions un chemin de consensus…
Les émissions agricoles de gaz à effet de serre ont stagné en 2021, alors que l’objectif fixé par la SNBC à 2030 est de -20 %. Comment y parvenir ? Les leviers principaux sont connus, l’élevage et les engrais. Faut-il accélérer notamment la déconsommation de la viande, qui est techniquement le plus facile à mettre en œuvre ?
Ce n’est pas qu’un sujet uniquement technique et paramétrique, car à ce compte, il faudrait arrêter immédiatement les voitures thermiques. Il ne s’agit pas de prendre des virages qui nous feraient sortir de la route. Rappelons aussi que le Haut Conseil pour le climat souligne que les trajectoires d’émissions du secteur sont respectées, signe que nous allons dans la bonne direction. Je suis en train de recevoir les filières pour convenir avec elles de la feuille de route que nous pourrons nous donner. Et tout ne peut pas reposer sur les agriculteurs, il faut que l’amont et l’aval se mobilisent aussi pour accompagner les agriculteurs, donner les technologies adéquates et garantir des débouchés. Et il ne faut pas oublier le consommateur dans tout cela, qui a aussi sa part de responsabilité à assumer.
Sur les engrais, c’est probablement plus facile qu’en élevage. Il faut regarder les solutions comme l’alimentation des bovins, le stockage et la réutilisation des fumiers… Il faut aussi raisonner en termes de balance et regarder les types d’élevage de bovins qui stockent le plus de carbone. À ce titre, le modèle français a des vertus, de l’exemplarité et entretient le paysage. À ce sujet, il y a un travail de concertation à mener au niveau européen, où certains pays du nord de l’Europe affirment que leur modèle est le plus vertueux. Pour moi, il n’y a pas seulement des schémas mathématiques qui doivent nous dire vers quel modèle aller. C’est aussi une question de société et d’accompagnement de tous. Et ce sont d’immenses défis, c’est vrai.
NDLR : Retrouvez l'intégralité de cette interview sur la version papier de votre journal.
Propos recueillis par Nathalie Marchand, Nicole Ouvrard et Mathieu Robert