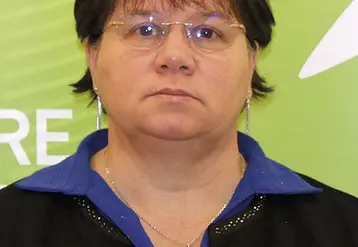Des variétés d’orge tolérantes à la jaunisse
La jaunisse de l’orge peut fortement impacter les rendements de la céréale. La recherche variétale représente une alternative à l’absence de traitement autorisé.

La recherche variétale s’inscrit dans la stratégie de lutte alternative. C’est le cas pour prévenir la jaunisse nanisante de l’orge (JNO) qui est une virose transmise à l’automne par un puceron. Le blé tendre peut aussi, à une moindre échelle, être sensible à ce virus. Sur l’orge d’hiver, les conséquences, qui se traduisent par un aspect « moutonné » ou un jaunissement du bout des feuilles au printemps, sont une perte de plantes ou d’épis. « Jusqu’en 2018, le traitement de semences avait un effet sur la maladie », explique Yann Janin, conseiller à la chambre d’agriculture de l’Isère. Mais le retrait des produits à base d’imidaclopride (insecticide) en 2018 a rendu la lutte plus délicate.
Reculer la date de semis
Une des stratégies mises en place peut être « le recul des dates de semis pour limiter le temps de cohabitation entre le puceron et la culture », détaille Yann Janin. Si elles sont à moduler en fonction des secteurs, les dates optimales de semis seront de toute façon comprises entre le 1er et le 20 octobre. Mais le levier génétique permet d’accéder aujourd’hui à un catalogue de variétés tolérantes, une dizaine en six rangs, plus rares en deux rangs. La disponibilité des semences limite cependant pour l’instant l’accès à ces nouvelles variétés. « L’environnement de la parcelle et le précédent jouent sur la pression », ajoute Thibault Ray, d’Arvalis-Institut du végétal. Les graminées peuvent par exemple être un facteur de risque. Quant à l’orge brassicole, elle est aussi sujette à la JNO, ce qui peut être de nature à remettre en cause sa production en France. Cependant, signale Arvalis, certaines orges tolérantes sont désormais reconnues par les malteurs et les brasseurs.
Semer sous couvert sans herbicide
- Rapportée des États-Unis, la technique est connue en France depuis une dizaine d’années. L’école d’agronomie Isara-Lyon poursuit ses essais en région Aura avec l’appui des Chambres d’agriculture. Comparé au désherbage mécanique, il s’agit là de ne rien faire, ou presque. Le semis (seigle et/ou triticale pour soja, féverole et/ou seigle pour maïs) est réalisé à la fin de l’été/début de l’automne. Il est roulé au printemps avec un rouleau cranteur qui blesse le couvert et permet de constituer le paillis. La culture est alors semée avec un disque ouvreur en semis direct « et il ne passe plus rien jusqu’à la récolte », indique Joséphine Peige de l’Isara.
Cette technique est particulièrement réservée aux cultures de printemps salissantes. Lætitia Masson, de la chambre d’agriculture de l’Isère, précise que le couvert est semé perpendiculairement à la culture pour éviter les bandes claires. Il est semé dense : 200 kg /ha, de même que le soja, car les pertes à l’arrivée sont de l’ordre de 30 à 40 %. Les pertes de rendement liées à cette pratique sont estimées à 8 %. En revanche, le nombre de passages est divisé par deux et le temps de travail par deux tiers. Le volume de biomasse attendu est de 8 tonnes, en deçà, la technique est moins intéressante. Enfin, elle se révèle être un bon système de gestion contre l’ambroisie.