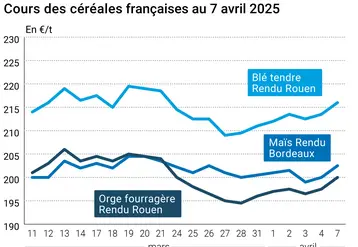Le Japon importe les trois quarts de ses besoins en alimentation animale
Au Japon, le taux d’autosuffisance en nutrition animale est très bas. De 25 % en 2018, le gouvernement voudrait qu’il passe à 34 % en 2030 en soutenant la production agricole et en autorisant des matières premières issues de l’alimentation humaine.
Au Japon, le taux d’autosuffisance en nutrition animale est très bas. De 25 % en 2018, le gouvernement voudrait qu’il passe à 34 % en 2030 en soutenant la production agricole et en autorisant des matières premières issues de l’alimentation humaine.

Pour produire ses 24,2 millions de tonnes (Mt) d’aliments composés, le Japon importe chaque année plus de 13 Mt de céréales destinées à ses usines de nutrition animale, dont 11,6 Mt de maïs et 3,2 Mt de soja. Pour dresser un panorama complet, il faut aussi compter les 2 Mt de foin importées. Les États-Unis dominent largement les importations de maïs (8 Mt) et celles de foin (60 % des volumes). L’Australie, lui, prend toutefois des parts de marché sur ce dernier produit (près de 26 % l’an dernier). Les unités de production sont logiquement localisées à proximité des ports dans leur immense majorité et les formules d’aliments sont dominées par le modèle très américain « maïs-soja », ces deux ingrédients représentant respectivement 47 % et 13 % des utilisations de matières premières.
Concentration des fabrications
La nutrition animale nippone compte 134 usines, dont 67 non-coopératives appartenant à 44 compagnies (indépendantes ou filiales de groupes industriels) qui représentent près de 70 % des volumes auxquels il faut ajouter les rations totales mélangées (TMR) destinées principalement aux vaches laitières, en progression : sur l’île d’Hokkaido, les unités de TMR enrubannées sont ainsi passées de 25 en 2003 à 76. Les industriels assurent souvent aussi l’importation des matières premières, le mélange et la distribution d’aliments spéciaux (comme les aliments d’allaitement) dans un rayon géographique limité, et peuvent aller jusqu’à assurer la récolte des fourrages des éleveurs laitiers en manque de main-d’œuvre.
Trois quarts des aliments pour animaux sont issus de cinq groupes : Kumiai feed (filiale de JA Zen-Noh, le réseau des coopératives avec 7,2 Mt au 17e rang mondial du classement de Feed Strategy en 2022), Feed One (filiale du groupe Mitsui & Co au 38e rang mondial avec 3,6 Mt), Chubu Shiryo (indépendant avec 2,9 Mt au 49e rang mondial), Marubeni Nisshin (filiale de Marubeni Corporation à 2,42 Mt – 65e rang) et Nosan (filiale de Mitsubishi Corporation à 2,24 Mt – 68e rang). Quelques entreprises ne produisent que des aliments pour vaches laitières comme Zenrakuren, Meiji Feed et la filiale nutrition animale de Snowseed Group.
Un cheptel diversifié
Les espèces dominantes restent les poules pondeuses et les porcs, aux environs de 23,4 % chaque, suivies par les poulets de chair (15,9 %) et les bovins viande (19,1 %). Les vaches laitières sont un peu plus loin à 13 %.
Concentré surtout sur deux principales zones, Hokkaido tout au nord pour les ruminants, Kyushu au sud pour les monogastriques, l’élevage s’érode tant en nombre de fermes que d’animaux, sauf en bovins. L’augmentation de la taille des fermes en porcs, notamment, ne suffit pas à maintenir la production.
Hokkaido compte le plus grand nombre d’usines d’aliments pour animaux (20 des 134 usines japonaises pour 16,6 % du volume national), suivi par Kagoshima qui se situe au sud de Kyushu (13 usines, 17,8 % des volumes), et Ibaraki, au centre de l’île principale d’Honshu (nord/nord-est de Tokyo) avec également 13 usines, mais 16,9 % des volumes.
Des défis accentués par la faiblesse actuelle du yen
« Les challenges auxquels est confrontée la nutrition animale japonaise sont nombreux, en commençant par l’explosion des cours de toutes les ressources, dont les matières premières importées », explique Mayuko Morita, responsable marketing Japon d’Alltech.
Le prix des aliments composés a commencé à croître dès le second semestre 2020, la hausse s’accentuant début 2021 comme dans l’UE sous l’effet de la demande chinoise, puis de la guerre en Ukraine. La dépréciation du yen, toujours très faible sur les marchés des changes, accentue cette situation, alors que pour les consommateurs, les produits animaux importés sont meilleur marché. Les traités de libre-échange signés depuis 2015 ajoutent de la pression : l’accord de partenariat transpacifique de 2018, le traité de libre-échange avec l’UE (2019) et celui signé avec les États-Unis en janvier 2020. Le gouvernement a mis en place un système financier qui compense partiellement l’augmentation des coûts, mais ce système a atteint les limites qui lui avaient été fixées.
Le pays est également confronté aux épizooties : sur la saison 2022-2023, il a dû abattre plus de 18 millions de poules pondeuses en raison de l’influenza aviaire. Il se montre particulièrement vigilant pour la fièvre porcine africaine, que ce soit par le contrôle des touristes tentés d’apporter leurs aliments contenant du porc ou par la protection des élevages.
Le manque de main-d’œuvre agricole ainsi que son vieillissement constituent un défi majeur. La réglementation sur le temps de travail des routiers constitue un autre défi. « En 2024, la réglementation va donner plus de droits aux chauffeurs, mais, à l’échelle de tout le pays, cela va se traduire par un déficit d’environ 30 % d’heures de route ; ce qui, naturellement, va poser beaucoup de problèmes dans notre secteur très dépendant des importations et donc des ports », résume Shuichi Tanaka, président de Nosan Farm.
De nouvelles perspectives
Le public est également de plus en plus sensible aux questions environnementales, dont les émissions de gaz à effet de serre. Les matières premières issues de la nutrition humaine intéressent donc de plus en plus les usines. Certains élevages de porcs s'étant positionnés sur les « écofeed » en captant une partie de ces ressources dès la sortie des usines agroalimentaires, la nutrition animale industrielle consomme déjà 160 000 t de coproduits de la confiserie et s’intéresse aux coproduits de la fabrication de tofu, de jus de fruits, de saké comme aux drêches de whisky ou de brasserie.
Certains fournisseurs, comme le brasseur Asahi, déclinent une gamme de produits techniques issus de leurs coproduits. C’est le cas de la Calsporin, probiotique autorisé au Japon pour les porcs et les bovins depuis 1995, pour les volailles depuis 1996 (et depuis 2006 dans l’UE). Autorisées en alimentation piscicole, les protéines transformées de bœuf pourraient être réautorisées pour les volailles et les porcs. La question des déchets alimentaires de la restauration est également débattue en raison du risque présenté par l’éventuelle présence de produits animaux, assorti de l’obligation d’un traitement d’au moins 90 °C pendant plus de 60 minutes. Actuellement, le gouvernement voudrait aussi que les usines utilisent les poudres de lait excédentaires afin de soutenir le prix du lait pour les éleveurs.
Une très faible autosuffisance alimentaire
Le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon s’affiche à 46 % en matière de calories et 69 % en valeur avec des objectifs respectifs de 53 % et de 79 % à l’horizon 2030. La question des importations pour la nutrition animale est cruciale. Ainsi, en tenant compte des achats pour nourrir les bovins viande, l’autosuffisance nippone n’est que de 10 % en bœuf, contre 36 % sans tenir compte de ce critère. Idem en lait : 26 % vs 60 % (les importations de produits laitiers atteignent 5 Mt contre les 7,3 Mt de production laitière nippone). L’écart est encore plus marqué pour les volailles de chair : le taux d’autosuffisance est de 64 % sans tenir compte des importations de matières premières mises en œuvre par les fabricants d’aliments contre 8 % en tenant compte de ces volumes (respectivement 96 % et 12 % pour les pondeuses ; 49 et 6 % pour les porcs).