Prospective filière aval
DuALIne : état des lieux des systèmes alimentaires durables
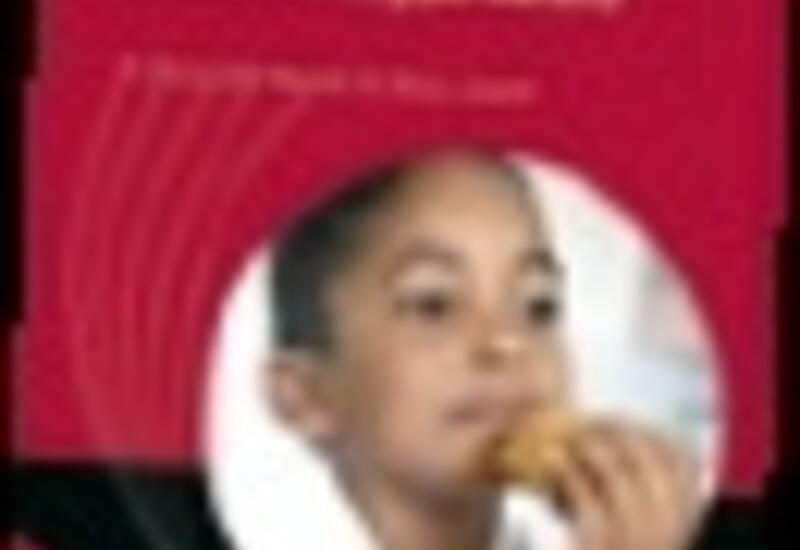
Comment assurer à la population une alimentation répondant aux besoins qualitatifs et quantitatifs dans un contexte de développement durable ? Tel est le sens de DuALIne, une autosaisine de l’INRA et du Cirad rassemblée en un ouvrage à dix entrées*. « L’aval de la filière est peu considéré dans la notion de durabilité alimentaire. Nous avons voulu définir les enjeux du champ jusqu’au consommateur en tenant compte de l’élimination des déchets », a expliqué Catherine Esnouf (INRA), coordinatrice du projet. « Ce qui se passe après l’achat dans la distribution est méconnu, or l’enjeu actuel c’est de labelliser les produits », lâche Nicolas Bricas. Aussi, Nicole Darmon (INRA) a annoncé que l’effet quantité était tout aussi important sur l’environnement que l’effet qualité nutritionnelle. « Si on baisse la consommation de viande de 50 g/jour/personne, on réduit l’impact carbone de 12 % mais ce qui est intéressant c’est de simuler la compensation. Si celle-ci se fait au profit des f&l, l’impact carbone augmente de 2,7 %. » Pour repenser les filières, Louis-Georges Soler (INRA) indique : « Les filières agro-industrielles ont conduit à une standardisation des matières premières agricoles, qui sont ensuite assemblées et fractionnées par l’industrie. Si on veut plus de variabilité des matières, cela jouera sur l’ensemble du secteur. Il est donc nécessaire de repenser l’interface entre milieu agricole et milieu industriel en utilisant au maximum les qualités intrinsèques des produits. » Le “minimal processing” est à surveiller sur le plan sanitaire. Avec une DLC abaissée, le gaspi risque d’augmenter. Le consommateur serait-il prêt à réapprendre la variabilité du goût des aliments qu’il a l’habitude d’acheter ? Quant à la notion de proximité, « 50% de la population mondiale vit en ville. Pour 10 millions d’habitants, il faut 6 000 t de denrées/jour, soit 3 millions d’hectares de terres agricoles c’est six fois la SAU agricole d’Ile-de-France par exemple !, évalue Bertrand Schmitt (INRA). Tout relocaliser près des villes ne va pas tout régler. Le mode de transport, l’organisation spatiale de la distribution et la concentration de la production sont les facteurs déterminants à analyser. » Et de rappeler qu’il existe des règles historiques d’organisation de marché, « l’arbitrage doit être fait, l’analyse n’a pas encore été faite sur les circuits courts. »
*Réflexion stratégique duALIne, Catherine Esnouf, Marie Russel et Nicolas Bricas, éditions Quae.










