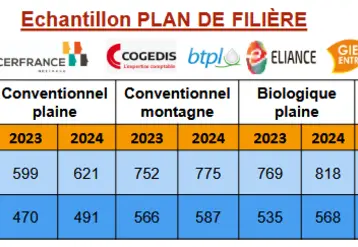Comment bâtir une lutte raisonnée contre les strongles digestifs
Une bonne prévention passe par une gestion fine du pâturage et un usage adéquat des strongylicides. Tout l’enjeu consiste à trouver le bon équilibre entre immunité et performances zootechniques.
Une bonne prévention passe par une gestion fine du pâturage et un usage adéquat des strongylicides. Tout l’enjeu consiste à trouver le bon équilibre entre immunité et performances zootechniques.



Eliminer tous les strongles digestifs étant illusoire et pas forcément souhaitable, pour éviter les effets indésirables de ces vers ronds pratiquement invisibles à l’œil nu, il faut répondre à deux questions essentielles : quels animaux traiter ? et quand les traiter ? Les bonnes réponses sont propres à chaque élevage. Et pour compliquer le tout, elles varient chaque année en fonction des conditions météorologiques, de la conduite du pâturage… Mais une chose est sûre : le recours systématique aux traitements anthelminthiques est tout sauf bon pour votre trésorerie et l’environnement. Pire, il peut conduire, comme pour les antibiotiques, à diminuer l’efficacité des produits en favorisant la sélection de populations résistantes de parasites.
« Les traitements anthelminthiques exercent une pression de sélection sur les vers. En cas d’usage inapproprié, on peut sélectionner les vers résistants, et cela peut conduire à terme à des baisses d’efficacité, voire des échecs de traitement », insiste Nadine Ravinet de l’Inra-Oniris. Pour assurer la durabilité des méthodes de contrôle du parasitisme, il faut donc limiter le développement de la résistance des parasites. Cela passe notamment par le maintien d’une population refuge de parasites, ces derniers restant par définition sensibles aux traitements strongylicides puisque non sujets à la pression de sélection.
Un contact suffisant mais pas de pression trop forte
Raisonner les traitements suppose donc de poser un diagnostic fiable sur la situation de votre élevage afin de cibler les animaux et les périodes à risque. Le raisonnement s’appuie sur une bonne connaissance du cycle de développement des strongles. L’enjeu consiste à trouver un bon équilibre entre d’une part un contact suffisant des génisses avec les strongles pour favoriser l’installation d’une immunité durable, et d’autre part faire en sorte que la pression parasitaire ne soit pas trop forte.
« Pour que l’immunité s’installe, il faut que les génisses de première et deuxième années aient un contact répété avec les parasites. Mais il faut que ce contact reste modéré pour qu’il soit sans conséquences sur la santé et la croissance des animaux. Il faut donc traiter à bon escient : autant que nécessaire mais le moins possible, explique la scientifique. Il est très difficile d’évaluer précisément le niveau d’immunité acquise. Mais le temps de contact effectif (TCE) avec les strongles au pâturage avant le premier vêlage peut permettre de l’estimer indirectement, même s’il est loin d’en être un reflet parfait. » Vous pouvez le calculer vous-même.
Prenez le temps pendant lequel, de sa naissance au premier vêlage, le bovin a consommé de l’herbe. Retirez le temps pendant lequel il est protégé par un traitement anthelminthique rémanent. Puis retirez le temps pendant lequel il a reçu une forte complémentation au pâturage (fourrage en période de sécheresse par exemple…) Plus le TCE est élevé (au-delà de 8 mois), plus la probabilité d’un bon développement de l’immunité est forte, et plus la nécessité d’avoir à traiter les adultes est faible.
Cibler des animaux et périodes à risque
Pour que l’immunité perdure dans le temps, il faut que les bovins continuent à ingérer des larves L3. Cette immunité dite « concomitante » n’est pas totale. Le bovin reste infesté mais à un niveau faible et donc insuffisant pour provoquer des troubles de la santé.Compte tenu de ces enjeux, le ciblage des périodes à risque est nécessaire. De plus, l’idéal serait aussi de pouvoir faire du traitement sélectif : on ne traite pas tout le lot, mais seulement les animaux qui sont le plus infestés et/ou qui supportent mal le parasitisme. Pour bien cibler les périodes à risque, on peut utiliser des simulateurs comme le logiciel Parasit’Info.
Pour sélectionner les génisses à traiter, on pourrait se baser sur le GMQ. « Une étude a montré que des pesées effectuées à la sortie de bâtiment puis deux à quatre mois plus tard permettraient de limiter les traitements aux génisses ayant le moins bon GMQ. Mais cette approche peut être bien sûr très contraignante puisqu’elle nécessite un suivi de croissance. »
Des gains de production laitière pas systématiques
Faut-il traiter les vaches laitières ? Certaines sont traitées sans qu’il y ait un impact positif sur leur production laitière. « Une vache adulte exprime très rarement des signes cliniques. En revanche, une baisse de production laitière est possible. Mais cette baisse est très variable selon les troupeaux et animaux. Il est par conséquent inutile de traiter systématiquement tous les animaux et tous les troupeaux », insiste Nadine Ravinet.
La scientifique mène des recherches pour élaborer un arbre décisionnel permettant d’identifier les vaches laitières et les troupeaux à risque justifiant un traitement. « Nous avons mené nos travaux à la rentrée à l’étable, c’est-à-dire après un contact prolongé avec les strongles pendant la saison de pâturage. Pour autant, il ne faut pas toutes les traiter à cette période parce qu’il n’y a pas de population refuge de parasites dans le bâtiment. » La part de l’herbe dans la ration, le temps de contact effectif (TCE) et le dosage des anticorps dans le lait de tank semblent être les critères les plus intéressants à combiner pour cibler les troupeaux à risque. Le raisonnement des traitements est bien sûr indissociable de l’optimisation de la conduite du pâturage.
(1) Vers un traitement sélectif des génisses contre les strongles.
Impacts possibles d’une forte infestation
Baisse de la production laitière
Baisse de la croissance
Expression de signes cliniques de gastro-entérite parasitaire
Baisse de l’immunité
Baisse de la qualité du colostrum
Des pistes pour limiter le niveau d’exposition
. Ne pas laisser les animaux plus de trois semaines sur une parcelle pour limiter une nouvelle excrétion d’œufs dans la pâture
. Sortir les jeunes animaux non immuns après mai ou juin
. Sortir les jeunes animaux non immuns sur prairies saines (nouvellement semée, repousses après fauche)
. Un chargement peu élevé en animaux
. Éviter le surpâturage
. Faire pâturer les prairies les plus infestées par des animaux immunisés
. Un bon niveau de supplémentation au pâturage : plus il est élevé moins les animaux consomment d’herbe
. Une alternance d’animaux réceptifs et non réceptifs. Les animaux non réceptifs (ovins, équins ou des animaux immuns) ingèrent les L3 qui ne se développent pas et inhibent la ponte d’œufs.
. Le gel
. Un été sec et chaud
. L’implantation de plantes à tanin ayant une activité strongylicide (sainfoin…)
. L’ébousage
. Le labour
Mise en garde. Attention ! Si vous faites une rotation sur quatre pâtures mais que les animaux ne restent qu’une semaine dans chaque paddock, cela équivaut en termes de charge parasitaire à une parcelle pâturée en continu.
A savoir. Un vaccin chez les bovins ? Chez les ovins, un vaccin contre l’haemonchose ovine est utilisé en Australie et Nouvelle-Zélande, mais son utilisation n’est pas autorisée en France. Le développement d’un tel vaccin pour les bovins semble très compliqué et par conséquent peu probable à court terme.