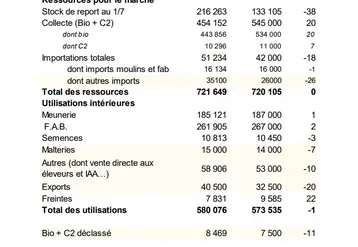Formation ingénieurs
Une nouvelle dynamique
Des centaines de kilomètres séparent l’école d’ingénieurs de sa partenaire technologique, l’Ensmic. Les ponts ne sont cependant pas coupés

RENOUVEAU. Le départ de l’Ensmic (école nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières) pour Surgères (Charente-Maritime) n’a pas été sans susciter des interrogations quant au devenir de l’école d’ingénieurs qui lui est associée. Les enseignements techniques et travaux pratiques, dispensés dans le cadre de la spécialité “industries céréalières” proposée par l’université Pierre et Marie Curie, étaient en effet assurés par des professeurs de l’Ensmic dans leurs locaux. Pas d’inquiétudes. La formation, qui a acquis une nouvelle identité en devenant la filière agroalimentaire de Polytech’Paris-UPMC, va survivre au déménagement de l’école de meunerie avec laquelle elle entend conserver « un lien fort, même s’il n’est plus fusionnel », comme l’assure son directeur, Jean-Marie Chesneaux. Ce bouleversement des habitudes aura même eu un effet dopant pour la formation ingénieurs qui a été totalement remise en cause, comme l’explique, Françoise Corbineau, responsable pédagogique.
Nouveau nom, nouvelle dimension
Il y a deux ans, l’université Pierre et Marie Curie décide de réunir ces deux écoles d’ingénieurs – dont l’IST (Institut scientifique et technique) qui proposait notamment la spécialité agroalimentaire – en une unique structure réunissant sept filières. Un décret officialise, fin août 2005, la naissance de l’école polytechnique universitaire (EPU). Ce pôle de 750 élèves est baptisé Polytech’Paris-UPMC.
Le changement ne se résume pas à un nom, mais élargit les perspectives de l’école qui se retrouve intégrée à un réseau national de onze écoles d’ingénieurs. « Avec 9.000 élèves, il est le plus important de France », explique Jean-Marie Chesneaux qui y voit l’opportunité d’ « une véritable montée en puissance ». Si l’agroalimentaire n’est pas une spécialité majoritaire du réseau, Lille et Montpellier la proposent. Celles-ci sont néanmoins plus axées sur le domaine de la microbiologie que l’école parisienne, « orientée sur le végétal ». Les élèves peuvent modeler leur formation en changeant de site au cours de leur cursus.
Enseignement articulé autour du végétal
La formation a repensé son organisation, il y a trois ans, pour « lui donner plus de lisibilité pour l’étudiant et la profession », explique Philippe Roussel, coordinateur des études. «Il fallait aussi lui permettre d’être identifiable par elle-même et non plus par rapport à l’Ensmic. » Le programme des deux premières années « part de la connaissance de la graine pour s’étendre à celles de la matière puis des procédés de transformation industrielle ». Si « les céréales restent au cœur de l’enseignement », comme le précise Jean-Marie Chesneaux, les oléagineux sont plus largement intégrés. De nombreux intervenants sont sollicités pour assurer les différents modules. Pour coller aux attentes du terrain et proposer des approches techniques, « nous nous appuyons sur le réseau des anciens élèves », souligne Philippe Roussel. La formation agroalimentaire propose deux options, “industries céréalières” et “qualité et sécurité alimentaire”. Elles ne se distinguent que par 120 h en 3 e année, leur donnant « une coloration différente ». La première porte « sur la conduite et la maîtrise des processus de transformation », la deuxième sur « la sécurité alimentaire et les risques environnementaux entourant les industries céréalières ». Une troisième, consacrée aux biocarburants, est à l’étude. Si le fond de l’enseignement reste le même, de nouveaux modules, de rhéologie ou de caractérisation sensorielle notamment, ont été intégrés. Autre nouveauté en 2 e année, les étudiants mènent en groupe un projet technologique sous tutorat industriel. Ce travail combine approche bibliographique, démarche expérimentale et traitement et analyse statistiques des données. En 2005, les élèves ont par exemple bûché sur la caractérisation technologique des farines pour pâtes liquides ou la stabilisation des levures crèmes. Ils ont pour cela passé deux semaines en entreprise.
C’est au niveau technologique que le déménagement de l’Ensmic pose des problèmes. En effet, les élèves ingénieurs profitaient, au cours de leur apprentissage, des installations de la rue Nicolas Fortin. Pour y remédier, « nous cherchons à engager des partenariats avec des structures complémentaires ». Une réflexion est en cours avec l’Ensia de Massy – sur le point de fusionner avec deux autres écoles, dont l’InaPG, au sein de l’INS – qui dispose d’une importante plate-forme technique. « Ils travaillent sur les problèmes de cuisson/extrusion des produits céréaliers avec une approche rhéologique, analytique et texturale, mais voudraient mieux appréhender la dimension boulangère. Notre spécialisation dans le domaine du végétal et la modularité de notre formation les intéressent aussi.» Il est également envisagé de solliciter la région, avec l’INS, pour acquérir de gros équipements. Pour la meunerie, différentes pistes sont à l’étude, comme celle d’envoyer toute la promo s’exercer à Surgères.
Côté embauche, l’optimisme prévaut
D’une cinquantaine d’élèves pour les trois années, la spécialité agroalimentaire table sur « un régime de croisière de 35 ingénieurs par an », explique Françoise Corbineau. L’ANMF assurant que le secteur meunier peut absorber des promotions de 40, « nous n’avons pas d’inquiétude sur les besoins industriels. En revanche, nous devons attirer les jeunes vers nos filières ». Une préoccupation qui s’étend à toute la formation : l’Ensmic ne forme plus qu’une petite vingtaine de techniciens supérieurs par an, contre près de 90 il y a quelques années. La proportion d’élèves ingénieurs issus du BTS a donc beaucoup baissé. L’EPU va néanmoins « continuer de leur réserver une place prioritaire ». Bonne nouvelle puisque « l’horizon n’est pas mauvais pour les futurs ingénieurs. Une pénurie s’annonce avec les départs en retraite liés au baby-boom. »