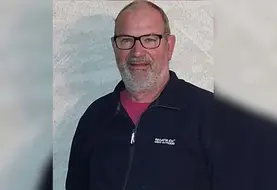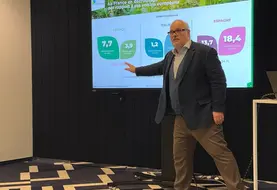Adventices : les agriculteurs bio combinent les leviers contre les vivaces
Adapter sa rotation, utiliser des cultures étouffantes, épuiser les racines avec du travail du sol répété, s’adapter à la biologie de l’espèce : la lutte contre les vivaces en agriculture biologique passe par la combinaison de leviers.
Adapter sa rotation, utiliser des cultures étouffantes, épuiser les racines avec du travail du sol répété, s’adapter à la biologie de l’espèce : la lutte contre les vivaces en agriculture biologique passe par la combinaison de leviers.

Les vivaces ont une forte capacité de concurrence de la culture en place, en agriculture biologique, comme en conventionnel. Une densité de 10 chardons par m2 induit des pertes de rendement de 20 % sur céréales et de 10 % en colza. À 20 pieds par m2, la diminution atteint respectivement 30 à 50 % et 25 %.
Depuis dix ans, Agro-transfert ressources et territoires et ses partenaires (1) étudient les moyens de gérer les vivaces majeures en bio : chardon, rumex et laiteron des champs en Hauts-de-France. « Avec leur capacité à se reproduire par graines et par organes souterrains, les vivaces se développent rapidement », introduit Julie Leroy, chargée du projet agriculture biologique d’Agro-transfert. Les vivaces assurent leur développement grâce à leurs organes végétatifs qui stockent l’énergie et permettent la reproduction par multiplication végétative. L’expansion racinaire des chardons peut atteindre jusqu’à 2 mètres par an (m/an) si elle n’est pas contrôlée. Celle du laiteron des champs de 0,5 à 2,8 m, avec une multiplication accélérée en cas de travail du sol, le pire étant les outils qui le fragmentent et qui sont animés comme la fraise rotative. Quant au rumex, chaque pied a un potentiel de production de 40 000 à 50 000 graines, qui vivent de 50 à 80 ans sous terre ! Agir rapidement reste donc la première règle.
Déchaumages répétés et cultures étouffantes contre le chardon
« En cas de forte infestation, il faut épuiser les réserves des vivaces, détaille Julie Leroy. Les agriculteurs bio réalisent des déchaumages répétés l’été et/ou au printemps avant les cultures le permettant, comme le maïs ou certains légumes. Ils binent les maïs et les plantes sarclées. » Mais cela ne suffit pas. Il faut combiner les moyens d’action sur la rotation, notamment avec des cultures nettoyantes.
« La luzerne implantée pour trois ans reste le levier majeur de la lutte contre le chardon en agriculture biologique », précise Gilles Salitot, conseiller en agriculture bio depuis 20 ans à la chambre d’agriculture de l’Oise et participant au projet d’Agro-transfert. Plus la période d’implantation de la luzerne est courte, plus l’effet sera fugace. Elle doit être très couvrante, avec une fertilisation organique suffisante pour obtenir une biomasse importante au moment où les vivaces commencent à se développer. Objectif : empêcher le chardon d’accèder à la lumière pour faire de la photosynthèse et reconstituer ses réserves. « Une prairie temporaire fauchée régulièrement fonctionne aussi », complète Julie Leroy. En revanche, certaines cultures comme les pois protéagineux ou le blé favorisent le développement du chardon.
Depuis quelques années, le laiteron des champs devient un réel problème dans les systèmes légumiers bio et dans les cultures de maïs et de tournesol. Il profite de la lumière disponible. « Sa dynamique de développement peut remettre en cause la pérennité des systèmes légumiers bio intensifs », estime Gilles Salitot. Intercaler des céréales fait baisser la pression. La luzerne ou les associations protéagineux/céréales apportent peu d’effet nettoyant sur le laiteron.
Scalpages combinés à des extractions de racines pour le rumex
Quant au rumex, il semble plus inféodé aux sols assez humides, estime le conseiller. L’ensilage de méteil début juin peut améliorer la situation. Le sarrasin peut avoir un léger effet bénéfique, de même que les légumes de printemps sarclés. « En cas de faible infestation, l’arrachage manuel reste le plus efficace, estime Julie Leroy. Il faut agir dès l’apparition des premiers pieds en parcelle. »
Pour des plus grandes populations, des scalpages supérieurs à 10 cm de profondeur combinés à une extraction de la racine seront plus adaptés. Ils permettent d’extraire la partie haute de la racine comportant tous les bourgeons du rumex. Si la profondeur des scalpages est insuffisante, les bourgeons plus enfouis repousseront. Il est préférable d’exporter les racines, selon Agro-transfert. Quant au labour, l’enfouissement des racines affaiblit la plante, mais les racines enterrées profondément parviennent à repousser et le rumex deviendra beaucoup plus difficile à arracher.
« Sur la globalité des adventices vivaces, ces protocoles ne fonctionnent pas à tous les coups, tempère Gilles Salitot. Il faut vraiment raisonner la problématique sur des rotations longues, avec des combinaisons de leviers agronomiques. La réglementation sur les Cipan complique la donne pour atteindre une pression acceptable de ces mauvaises herbes sur la rotation. »
Intervenir au point de compensation avec un outil adapté
L’idéal pour épuiser les réserves des racines est d’intervenir au point de compensation, stade à partir duquel les vivaces deviennent autonomes grâce à l’énergie de la photosynthèse et commencent à reconstituer leurs réserves. Cela correspond à 6-8 feuilles pour les chardons et 4-8 feuilles pour le laiteron. Pour le chardon, les déchaumages du printemps jusqu’à fin mai et ceux de l’été jusqu’à fin août sont les plus efficaces. Pour le laiteron, le travail doit s’effectuer avant fin août, période où il entre en dormance. Ensuite, il faut privilégier un bon outil avec un recouvrement maximal entre les dents. Les déchaumeurs à dents droites avec des socs à ailettes horizontaux apportent satisfaction. En revanche, les rouleaux des déchaumeurs peuvent parfois rappuyer les fragments racinaires des vivaces et entraîner leur repiquage.