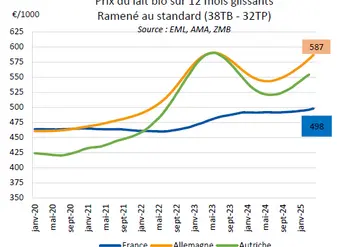En Haute-Maurienne : Développer l’irrigation des prairies pour sécuriser les exploitations laitières
Une irrigation raisonnée des prairies permet de renforcer l’autonomie fourragère des exploitations en AOP beaufort tout en préservant les écosystèmes qui font sa spécificité.
Une irrigation raisonnée des prairies permet de renforcer l’autonomie fourragère des exploitations en AOP beaufort tout en préservant les écosystèmes qui font sa spécificité.

En Haute-Maurienne, l’irrigation contribue depuis longtemps à la survie des exploitations de ce versant de la vallée de l’Arc affecté par les pluies faibles pluviométrie des Savoie (700 à 800 mm/an). Plus de 60 % produisent du lait pour la filière beaufort. Avec la multiplication des aléas climatiques, elles sont de plus en plus fragilisées par les déficits fourragers. Irriguer de manière ciblée les prairies est plus que jamais nécessaire pour préserver ou améliorer l’autonomie fourragère. D’autant plus que le cahier des charges de l’AOP beaufort impose un minimum de 75 % de fourrages produits sur la zone.
Quelque 430 hectares sont actuellement irrigués sur quatre communes de Haute-Maurienne (40 irrigants). L’une d’entre elles, Sollières-Sardières, a piloté pendant trois ans (2015-2018) un projet labellisé GIEE(1) pour rationaliser les pratiques d’irrigation et promouvoir une gestion économe de la ressource en eau.
Un gain de rendement d’au moins 2 tMS/ha

La période d’irrigation peut s’étendre de mai à septembre avec un pic de besoin en juillet. Les besoins en eau pour les prairies de Haute-Maurienne sont estimés à 2 000 m3/ha/an dont 40 % en juillet (80 mm) et 30 % en août (60 mm), mois où le risque de déficit est le plus fort. La réserve utile de ces sols sablo-limoneux peu profonds est faible : 40 à 50 mm, soit une réserve facilement utilisable de 30 mm. Il faut donc arroser « peu et souvent » en faisant des apports de 30 mm au maximum.
« L’irrigation peut permettre d’une part de limiter les pertes de rendement en années sèches, mais également d’améliorer le rendement moyen des prairies. Elle contribue aussi à réaliser une seconde coupe de foin dans certains secteurs ou à assurer un pâturage aux animaux lors de leur descente d’alpage. On peut en effet raisonnablement espérer un gain de rendement minimum de 2 tMS/ha grâce à l’irrigation », affirme l’association de Sollières-Sardières dans le rapport de bilan du GIEE. « L’irrigation, si elle est bien gérée permet de maintenir des espèces, et donc une diversité plus importante, notamment en dicotylédones : sauge, sainfoin, lotier etc. Sans irrigation, seules les espèces de milieu sec résistent », ajoute-t-elle.
Éviter un développement excessif des prairies temporaires
Outre un volet investissement, pour étendre et moderniser le réseau et acquérir des équipements plus économes, le projet prévoyait des expérimentations et l’acquisition de références techniques : suivi des volumes et débits d’eau utilisés, pratiques (fertilisation, irrigation, fauche, rendements…), analyses de sol, relevés d’espèces. « Le but de ces expérimentations est de toujours mieux irriguer, avec le meilleur résultat pour les prairies et tout en consommant le moins d’eau possible. Ceci aussi pour maintenir les paysages caractéristiques de haute montagne propres au territoire. » L’irrigation, principalement des praires temporaires, ne doit pas conduire à une intensification des pratiques et à leur développement excessif au détriment des prairies naturelles.
L’ensemble de la conduite technique de la prairie est pris en compte afin d’anticiper les impacts de l’irrigation sur les pratiques et de conserver une cohérence. Les essais ont montré par exemple la nécessité de cultiver des mélanges d’espèces plus pérennes et plus résilients faces aux fortes chaleurs. Des essais sont conduits également sur la hauteur de fauche pour permettre aux prairies de repartir dans les meilleures conditions, sur le temps d’arrosage après fauche ou encore le passage de herse après irrigation pour réduire l’assèchement du sol. Ce projet va se poursuivre. Un nouveau GIEE est à l’étude. Son objet sera élargi « aux pratiques agro-environnementales des prairies » et son territoire étendu à la Haute-Maurienne et à la Moyenne-Maurienne où les conditions pédoclimatiques sont très différentes et l’irrigation peu pratiquée.
Lire aussi : "Nos prairies produisent 13 t de matière sèche par hectare avec l'irrigation"
Des essais vont débuter dans le Cantal
Convaincus par l’exemple de la Haute-Maurienne, la chambre d’agriculture du Cantal et l’association des irrigants vont débuter cette année un essai d’irrigation de prairies. Les conditions (altitude, sols, pluviométrie) sont assez proches du territoire savoyard. « Nous nous donnons deux à trois ans pour créer des références techniques locales que nous pourrons ensuite intégrer aux cas-type pour évaluer l’intérêt économique d’irriguer des prairies », prévoit Marc Peilleron, conseiller agronomie.
« Nous avons affiné nos techniques d’irrigation »

Claude Favre exploite 22 ha de prairies et un alpage de 74 ha en Haute-Maurienne. Il élève 22 vaches de race tarine et produit 110 000 litres de lait pour la filière beaufort. Il a fait partie du GIEE de Sollières-Sardières.
« Le GIEE nous a permis de rénover et faire une extension du réseau d’irrigation. Aujourd’hui, je peux arroser 20 ha dont les 8 ha de prairies temporaires et luzernes. Il nous a permis aussi d’affiner nos techniques d’irrigation et de les vulgariser auprès des autres villages. Nous suivons les préconisations du bulletin d’irrigation hebdomadaire publié par le Gida de Haute-Maurienne. En règle générale, nous faisons au moins trois passages mais avec des quantités d’eau plus faibles qu’auparavant (30 à 50 mm selon les cultures et les années). En année normale, j’arrose après la première coupe pour favoriser les regains ou après un premier tour de pâturage sur les 7 ha qui sont déprimés par les vaches avant la montée en alpage. Cela permet de refaire un deuxième passage plutôt que de faire manger des parcelles de fauche.
Sur les luzernes, pour ne pas les dégrader, on limite les arrosages et les doses (30 mm maxi) et il ne faut pas irriguer immédiatement après la fauche. En 2019, année exceptionnellement chaude et sèche, j’ai démarré l’irrigation début mai et je l’ai poursuivi jusqu’au 25 septembre. Sur la première coupe, j’ai gagné 30 % de rendement par rapport à des prairies non irriguées. L’irrigation permet aussi de maintenir la diversité de la flore des prairies naturelles. J’utilise un enrouleur et deux petits jets pour les petites parcelles et les pentes. Pendant la période d’irrigation, j’y consacre une heure à une heure et demie par jour. »